Fragment Vanité n° 15 / 38 – Papier original : RO 83-5
Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Vanité n° 32 p. 7 / C2 : p. 20
Éditions savantes : Faugère I, 203, LXXIII / Havet XXIV.89 / Brunschvicg 354 / Tourneur p. 170-5 / Le Guern 25 / Maeda I p. 125 / Lafuma 27 / Sellier 61
_________________________________________________________________________________________
Bibliographie ✍
CROQUETTE Bernard, Pascal et Montaigne, p. 4. MILLEPIERRES François, La vie quotidienne des médecins au temps de Molière, Paris, Hachette, 1964, p. 59 sq. PASCAL, Préface au Traité du Vide, OC II, éd. J. Mesnard, p. 781. SERRES Michel, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Paris, P. U. F., 1968, p. 685. |
✧ Éclaircissements
La nature de l’homme n’est pas d’aller toujours. Elle a ses allées et venues.
L’idée générale du fragment doit être liée à celle de l’inconstance. Voir le fragment Misère 3 (Laf. 55, Sel. 88), qui compare l’homme à des orgues « bizarres, changeantes, variables ».
Voir le fragment Laf. 771, Sel. 636, qui invoque aussi l’idée du flux et du reflux. L’éloquence continue ennuie.
Les princes et rois jouent quelquefois. Ils ne sont pas toujours sur leurs trônes. Ils s’y ennuient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être sentie. La continuité dégoûte en tout. Le froid est agréable pour se chauffer.
La nature agit par progrès. Itus et reditus, elle passe et revient, puis va plus loin, puis deux fois moins, puis plus que jamais, etc. ![]() .
.
Le flux de la mer se fait ainsi 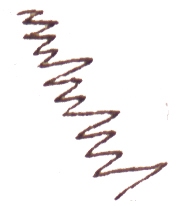 , le soleil semble marcher ainsi.
, le soleil semble marcher ainsi.
Croquette Bernard, Pascal et Montaigne, p. 4. Renvoi à Montaigne ; voir p. 134 : le fragment est composé d’une mosaïque de passages des Essais ; Croquette donne notamment les références II, 12, p. 415 ; II, 12, p. 417 ; III, 6, p. 673.
Montaigne, Essais, II, 12, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 600. « Je ne fais qu’aller et venir ; mon jugement ne vire pas toujours avant, il flotte, il vague ». La première citation est une réflexion de Montaigne sur lui-même. Plus précisément il parle de sa manière d’écrire.
Montaigne, Essais, II, 12, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 603. « Les fièvres ont leur chaud et leur froid : des effets d’une passion ardente, nous retombons aux effets d’une passion frileuse ». La seconde citation touche un tout autre domaine : Montaigne vient de parler des passions de l’amour.
Serres Michel, Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, Paris, P. U. F., 1968, p. 685. ✍
La fièvre a ses frissons et ses ardeurs. Et le froid montre aussi bien la grandeur de l’ardeur de la fièvre que le chaud même.
Le Dictionnaire de l’Académie définit la fièvre comme une « maladie provenant de l’intempérie du sang ou des humeurs, et dont l’état, l’augmentation et la diminution se connaissent par le battement du pouls ». La définition moderne fait de la fièvre un symptôme de la maladie. Voir Millepierres François, La vie quotidienne des médecins au temps de Molière, Paris, Hachette, 1964, p. 59 sq. La fièvre est une « intempérie chaude qui vient du cœur », dont il existe plusieurs sortes, avec des nuances. Cureau de la Chambre dit que « c’est un effort de la nature pour cuire les humeurs corrompues ». Il serait intéressant de savoir si la formule de Pascal est l’écho d’une opinion commune, ou si c’est une thèse médicale.
Montaigne, Essais, II, 12, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 603. « Les fièvres ont leur chaud et leur froid : des effets d’une passion ardente, nous retombons aux effets d’une passion frileuse ».
Voir Philosophes 8 (Laf. 146, Sel. 179), sur les mouvements fiévreux.
Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même. La bonté et la malice du monde en général en est de même.
Voir la Préface au Traité du Vide, OC II, éd. J. Mesnard, p. 781 où Pascal traite du progrès des inventions humaines, mais où il souligne plutôt la continuité du progrès des inventions, alors qu’ici, ce sont plutôt l’irrégularité de ce progrès et ses à-coups qui sont remarqués : « Les expériences qui nous en donnent l’intelligence multiplient continuellement ; et, comme elles sont les seuls principes de la physique, les conséquences multiplient à proportion. C’est de cette façon que l’on peut aujourd’hui prendre d’autres sentiments et de nouvelles opinions sans mépris et […] sans ingratitude, puisque les premières connaissances qu’ils nous ont données ont servi de degrés aux nôtres, et que dans ces avantages nous leur sommes redevables de l’ascendant que nous avons sur eux (sc. les Anciens) ; parce que, s’étant élevés jusqu’à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait monter plus haut, et avec moins de peine et moins de gloire nous nous trouvons au-dessus d’eux. C’est de là que nous pouvons découvrir des choses qu’il leur était impossible d’apercevoir. Notre vue a plus d’étendue, et, quoiqu’ils connussent aussi bien que nous tout ce qu’ils pouvaient remarquer de la nature, ils n’en connaissaient pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu’eux. » Il faut cependant noter que, dans ce passage qui fait implicitement allusion à l’image du nain monté sur les épaules du géant, l’idée de l’inégalité de la contribution des générations successives au progrès de la science est implicitement présente, notamment par l’expression le moindre effort nous fait monter plus haut… Le texte des Pensées développe la Préface sans la contredire.
Pour approfondir…
Pascal écrit aussi dans le même opuscule, OC II, p. 781 : « Les secrets de la nature sont cachés ; quoiqu’elle agisse toujours, on ne découvre pas toujours ses effets : le temps les révèle d’âge en âge, et quoique toujours égale en elle-même, elle n’est pas toujours également connue. »
La Préface au traité du vide soutient aussi, comme nombre d’auteurs, que l’époque moderne comporte des esprits féconds capables de découvrir des choses nouvelles : voir par exemple Mersenne, dans ses Questions harmoniques, Question V, éd. Pessel, p. 191 sq., qui demande si les Grecs, et les autres anciens ont été plus savants que nous en la théorie, et en la pratique de la musique. Voir aussi, du même auteur, Questions inouïes, Question XXXII, A-t-on maintenant plus de connaissance de quelque art ou de quelque science que les anciens, p. 87. Campanella, par exemple, est nettement affirmatif : voir Apologie de Galilée, éd. Lerner, p. 52 : « Depuis l’Évangile il naît des esprits comme ceux de Platon ou d’autres, qui sont plus aptes à progresser dans l’étude des sciences que Platon et d’autres ». Voir sur ce sujet Blay Michel et Halleux Robert, La science classique, p. 410.
C’est en un certain sens la même idée que défendent ceux qui emploient la figure du nain sur les épaules du géant, pour illustrer le fait que les anciens ont été de grands génies, mais que les modernes, quelque inférieurs qu’ils soient dans l’absolu, connaissent plus de choses, parce qu’ils profitent de leurs découvertes. Voir Halleux Robert, article Anciens, in Blay Michel et Halleux Robert (dir.), La science classique, p. 405-415. La formule se trouve déjà dans Bernard de Chartres : « nous sommes comme des nains montés sur les épaules des géants, si bien que nous pouvons voir plus de choses qu’eux et plus loin, non pas que notre vision soit plus perçante ou notre taille plus haute, mais parce que nous nous élevons grâce à leur taille de géants » : voir Taton René, La science antique et médiévale, p. 600. L’idée se trouve également chez des auteurs mondains : voir d’Urfé en 1627 : « Je dirai sans arrogance que nous voyons plus que les anciens, car tout ainsi qu’un nain étant sur la tête d’un géant, verra quoique plus petit, plus loin que ne fera ce grand colosse, de même ayant les inventions de ces grands anciens, et pour ainsi dire étant sur leur tête, nous voyons sans doute plus avant qu’ils n’ont pas fait, et il nous est permis, sans les outrager, de changer et polir ce qu’ils ont inventé » (cité dans Bray René, Formation de la doctrine classique, p. 50).
L’idée que le Moyen Âge, notamment dans la scolastique, a été une période stérile dans les sciences, alors que les progrès depuis la Renaissance ressuscitent la fécondité des Grecs, est courante à l’époque.
E. Havet renvoie à Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe, 1861, I, p. 147, en note.
Plerumque gratae principibus vices.
« La plupart du temps, les changements plaisent aux princes », Horace, Odes, III, 29, 13, cité par Montaigne, Essais, I. 42, De l’inéqualité qui est entre nous, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 286. Horace n’a pas écrit principibus, mais divitibus ; c’est Montaigne qui remplace riches par princes.
Cela change considérablement le sens de la citation. Montaigne commente ainsi : « ce sont délices aux princes, c’est leur fête, de se pouvoir quelquefois travestir, et démettre à la façon de vivre basse et populaire ». En revanche il n’est pas évident que les riches aiment à vivre à la manière des pauvres, fût-ce un moment.
Le fragment Laf. 771, Sel. 636 cité plus haut explique la citation latine de Vanité 15, Plerumque gratae principibus vices : Les princes et rois jouent quelquefois. Ils ne sont pas toujours sur leurs trônes. Ils s’y ennuient. La grandeur a besoin d’être quittée pour être sentie. Le changement est donc considéré ici comme un remède à l’ennui, c’est-à-dire comme un divertissement.
C’est l’idée contraire de celle qui sert de principe à la tragédie comme histoire des grandeurs et des catastrophes qui arrivent aux princes. Les changements qui arrivent aux héros des tragédies ne sont en général guère plaisants.
C’est aussi une idée directement contraire à celle du fragment Divertissement 5 (Laf. 137, Sel. 169) : Divertissement. La dignité royale n’est-elle pas assez grande d’elle-même pour celui qui la possède pour le rendre heureux par la seule vue de ce qu’il est ; faudra(-t-)il le divertir de cette pensée comme les gens du commun ? Je vois bien que c’est rendre un homme heureux de le divertir de la vue de ses misères domestiques pour remplir toute sa pensée du soin de bien danser, mais en sera(-t-)il de même d’un roi et sera(-t-)il plus heureux en s’attachant à ces vains amusements qu’à la vue de sa grandeur. Et quel objet plus satisfaisant pourrait-on donner à son esprit ? ne serait-ce donc pas faire tort à sa joie d’occuper son âme à penser à ajuster ses pas à la cadence d’un air ou à placer adroitement une barre, au lieu de le laisser jouir en repos de la contemplation de la gloire majestueuse qui l’environne. Qu’on en fasse les preuves, qu’on laisse un roi tout seul sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l’esprit, sans compagnies et sans divertissements, penser à lui tout à loisir, et l’on verra qu’un roi sans divertissement est un homme plein de misères. Aussi on évite cela soigneusement et il ne manque jamais d’y avoir auprès des personnes des rois un grand nombre de gens qui veillent à faire succéder le divertissement à leurs affaires et qui observent tout le temps de leur loisir pour leur fournir des plaisirs et des jeux en sorte qu’il n’y ait point de vide. C’est-à-dire qu’ils sont environnés de personnes qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le roi ne soit seul et en état de penser à soi, sachant bien qu’il sera misérable, tout roi qu’il est, s’il y pense. Je ne parle point en tout cela des rois chrétiens comme chrétiens, mais seulement comme rois. Dans ce cas, le changement n’apporte pas de plaisir au roi, mais plutôt de l’ennui.
Il faut donc comprendre que les changements en question ne sont que ceux qui favorisent le divertissement, et non ceux qui conduiraient le prince à une réelle prise de conscience de leur condition.

