Fragment Transition n° 4 / 8 – Papier original : RO 347 r/v°, 351 r/v°, 355 r/v°, 359 r/v°
Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : Transition n° 248 à 257 p. 91 à 99 v° / C2 : p. 117 à 129
Éditions de Port-Royal :
Chap. XXII - Connoissance générale de l’homme : 1669 et janv. 1670 p. 171-178 / 1678 p. 168-174 (chap. complet)
Chap. XXXI - Pensées diverses : 1669 et janv. 1670 p. 331-335 / 1678 n° 27 p. 326-330
Éditions savantes : Faugère II, 63, I ; II, 68, II ; II, 75, II / Havet I.1 / Brunschvicg 72 / Tourneur p. 236-1 / Le Guern 185 / Maeda I p. 219 / Lafuma 199 / Sellier 230
______________________________________________________________________________________
✧ Éclaircissements
Sommaire
Analyse du texte de RO 347 : Que l’homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté... Analyse du texte de RO 347 v° : Que l’homme étant revenu à soi considère ce qu’il est au prix de ce qui est... Analyse du texte de RO 351 : qu’il se perde dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse, que les autres par leur étendue... Analyse du texte de RO 351 v° : Manque d’avoir contemplé ces infinis, les hommes se sont portés témérairement à la recherche de la nature... Analyse du texte de RO 355 : Mais l’infinité en petitesse est bien moins visible... Analyse du texte de RO 355 v° : Quelque terme où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle, et nous quitte... Analyse du texte de RO 359 : La flamme ne subsiste point sans l’air... Analyse du texte de RO 359 v° : De là vient que presque tous les philosophes confondent les idées des choses...
|
Mais l’infinité en petitesse est bien moins visible. Les philosophes ont bien plutôt prétendu d’y arriver, et c’est là où tous ont achoppé. C’est ce qui a donné lieu à ces titres si ordinaires, Des principes des choses, Des principes de la philosophie, et aux semblables aussi fastueux en effet, quoique moins en apparence que cet autre qui crève les yeux : De omni scibili.
Des principes des choses : allusion peut-être à Lucrèce.
Des principes de la philosophie : allusion à Descartes, auteur des Principes de la philosophie.
Lenoble Robert, Mersenne ou la naissance du mécanisme, p. 106. Sur Jean Pic de la Mirandole et les 900 thèses qu’à l’âge de 24 ans il propose à Rome en 1586, dites « de omni re scibili », Conclusiones philosophicae, cabalisticae, theologicae, etc. Ces thèses ont été condamnées par Innocent VIII. Voir Pensées, éd. Havet, I, Delagrave 1866, p. 19. Critique de cette remarque : p. 20.
Voir l’article de Jean-Claude Margolin, “Pic de la Mirandole Giovanni (1463-1494)”, in Dictionnaire des philosophes, Encyclopaedia universalis, Paris, Albin Michel, 1998, p. 120-121. Les célèbres neuf cents thèses De omni re scibili datent de 1486 ; elles portent sur tous les domaines de la philosophie et de la théologie.
Pascal aurait pu aussi penser à Viète, qui clôt son Isagoge, ch. VIII, par la promesse : « Denique fastuosum problema problematum ars Analytice, triplicem Zetetices, Poristices et Exegetices formam tandem induta, jure sibi adrogat, quod est nullum non problema solvere. » « Finalement l’art analytique s’étant restitué de sa triple forme de zététique, poristique et exégétique, soult le problème le plus relevé et excellent de tous les autres problèmes, qui est de soudre tous problèmes » (tr. Vasset). La traduction de Vaulézard est encore plus emphatique : « le plus ampoulé Probleme des Problemes, qui est, donner solution de tout probleme. »
On se croit naturellement bien plus capable d’arriver au centre des choses que d’embrasser leur circonférence, et l’étendue visible du monde nous surpasse visiblement. Mais comme c’est nous qui surpassons les petites choses nous nous croyons plus capables de les posséder, et cependant il ne faut pas moins de capacité pour aller jusqu’au néant que jusqu’au tout. Il la faut infinie pour l’un et l’autre, et il me semble que qui aurait compris les derniers principes des choses pourrait aussi arriver jusqu’à connaître l’infini. L’un dépend de l’autre et l’un conduit à l’autre.
Sur la nécessité de la connaissance universelle, voir Descartes, lettre à Mersenne du 22 juin 1637 ; Koyré Alexandre, Études galiléennes, p. 134. Pour connaître la vitesse, il faut connaître tout le système du monde. On ne peut isoler un phénomène : p. 135 ; et par conséquent on ne peut formuler des lois mathématiques simples.
Ces extrémités se touchent et se réunissent à force de s’être éloignées et se retrouvent en Dieu, et en Dieu seulement.
Koyré Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, p. 22. Pour Nicolas de Cues, les infinis se rejoignent en Dieu : p. 23-25.
Connaissons donc notre portée. Nous sommes quelque chose et ne sommes pas tout. Ce que nous avons d’être nous dérobe la connaissance des premiers principes qui naissent du néant, et le peu que nous avons d’être nous cache la vue de l’infini.
Notre intelligence tient dans l’ordre des choses intelligibles le même rang que notre corps dans l’étendue de la nature.
Bornés en tout genre, cet état qui tient le milieu entre deux extrêmes se trouve en toutes nos puissances. Nos sens n’aperçoivent rien d’extrême, trop de bruit nous assourdit, trop de lumière éblouit, trop de distance et trop de proximité empêche la vue. Trop de longueur et trop de brièveté de discours l’obscurcit, trop de vérité nous étonne.
Susini Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence », à l’œuvre dans les Pensées, p. 85 sq. Technique de l’énumération ; et p. 295, remarque sur la rédaction génétique de cette proposition.
Ce passage est composé d’échos de propositions déjà formulées, mais présentées de manière nouvelle : il y a un effet d’accumulation, voire de mitraillage : Montaigne est ici employé comme une véritable grêle. En même temps, on évolue vers le style tragique. L’effet d’accélération accroît l’impression de se trouver dans une impasse.
On voit ici comment Pascal procède par motifs, thèmes et variations dans la construction de son apologie de la religion chrétienne. Cette analogie entre les corps et les esprits se retrouvera dans le fragment Preuves de Jésus-Christ 11 (Laf. 308, Sel. 339) relatif aux trois ordres. L’indication n’est ni explicite ni complète, et surtout il n’est pas encore question de l’ordre de la charité, mais Pascal prépare ici les thèmes qui seront développés dans Preuves de Jésus-Christ.
Laf. 800, Sel. 652. L’Écriture a pourvu de passages pour consoler toutes les conditions et pour intimider toutes les conditions. La nature semble avoir fait la même chose par ces deux infinis naturels et moraux. Car nous aurons toujours du dessus et du dessous, de plus habiles et de moins habiles, de plus élevés et de plus misérables, pour abaisser notre orgueil et relever notre abjection.
Vanité 9 (Laf. 21, Sel. 55). Si on est trop jeune on ne juge pas bien, trop vieil de même.
Si on n’y songe pas assez, si on y songe trop on s’entête et on s’en coiffe.
Si on considère son ouvrage incontinent après l’avoir fait, on en est encore tout prévenu, si trop longtemps après, on n’y entre plus.
Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n’y a qu’un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne dans l’art de la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l’assignera ?
Trop de longueur et trop de brièveté de discours l’obscurcit : Pascal pense peut-être à la manière dont, dans l’explication de sa méthode de maximis et minimis, Fermat s’est montré si bref qu’il n’a été compris par presque personne.
Trop de vérité nous étonne : Pascal pense sans doute aux incompréhensibles qui ne laissent pas d’être. Havet, dans son édition des Pensées, I, p. 5, n. 1, écrit que « le principe même est étrange. Il y a sans doute des vérités qui étonnent [...], mais est-ce parce qu’elles sont trop vraies ? » ; voir p. 23 sq.
Russell Bertrand, Introduction à la philosophie mathématique, p. 12, en revanche, remarque que les choses les plus évidentes et les plus faciles ne sont pas celles qui se présentent au début, mais celles qui, du point de vue de la logique déductive, se présentent vers le milieu.
J’en sais qui ne peuvent comprendre que qui de zéro ôte 4 reste zéro.
J’en sais qui... : à qui Pascal pense-t-il ? Brunschvicg suppose que c’est Méré, mais comme le remarque Nagase Haruo, “La machine arithmétique de Pascal et la notion du nombre négatif ”, Journal of the Faculty of Letters, Okayama University, 46, décembre 2006, p. 95, c’est une supposition que rien ne confirme.
La formule a souvent dérouté les commentateurs.
Pensées, éd. Havet, I, Delagrave 1866, en note, p. 5 : « Je ne puis comprendre, en effet, comment qui de zéro ôte quatre reste zéro. Dans la langue vulgaire, ôter quatre de zéro n’a aucun sens, et dans la langue mathématique, si de zéro on ôte quatre, il reste – 4, et non pas zéro. »
Pensées, éd. Brunschvicg minor, p. 363, n. 8. La proposition n’est vraie que si zéro est pris comme néant. Avec les nombres algébriques, on obtient - 4. Même remarque in éd. Le Guern, I, p. 301, n.17.
L’expression se comprend en fait lorsqu’on se rapporte aux textes arithmétiques du Traité du triangle arithmétique, notamment au De numeris multiplicibus, OC II, p. 1284.
Voir Hara Kokiti, L’Œuvre mathématique de Pascal, Osaka University, 1981, p. 217, qui renvoie au De Numeris multiplicibus. « Ex 10 aufer 16 quantum potest, superest ipse 10 » ; c’est-à-dire que, quand on ôte de 10 le nombre 16 autant de fois qu’on le peut, il reste toujours 10. Mourlevat fait remarquer que reste rend superest, qui diffère du latin reliquum est ; il faut traduire par demeure. Le zéro demeure au terme de cette opération. C’est un cas général d’une règle que Pascal cite immédiatement pour justifier son affirmation : « ex minore enim numero majus numerus subtrahi non potest », d’un nombre, on ne peut en ôter un plus grand. Il suffit, comme le propose Hara, de mettre zéro à la place de 10 et 4 à la place de 16 pour arriver à la formulation de Disproportion de l’homme. En fait, quand il parle de soustraire quantum potest, Pascal pense non à la soustraction, mais à la division, qui peut être interprétée comme une soustraction quantum potest. Voir dans le même sens Guilbaud, “Pascal et la mathématique”, p. 111 sq., qui donne la même interprétation : diviser 10 par 2, c’est ôter 2 de 10 autant de fois qu’on le peut ; dans certains cas, il y a un reste, comme quand on fait la division de 11 par 2 ; dans certains cas, c’est impossible, comme quand on veut diviser 2 par 10 (en supposant qu’on demeure dans les entiers positifs). L’expression « ôter x de y tant qu’on pourra » se trouve dans Bachet de Méziriac, Problèmes plaisants et délectables qui se font par les nombres, éd. de 1612, p. 130, par exemple, à propos des divisions avec reste. Il n’y a donc pas besoin d’aller invoquer les nombres algébriques négatifs pour expliquer la formule en question.
Hara Kokiti, Nouvelles observations sur les écrits mathématiques de Pascal, II, Historia scientiarum, 27, 1984, p. 23 sq. Analyse détaillée des formulations du De Numeris multiplicibus. L’absence du quantum potest n’est pas gênante, puisque en OC II, p. 1283 on trouve la même formule.
Nagase Haruo, “La machine arithmétique de Pascal et la notion du nombre négatif”, Journal of the Faculty of Letters, Okayama University, 46, décembre 2006, p. 93-102. ✍
Les premiers principes ont trop d’évidence pour nous ; trop de plaisir incommode, trop de consonances déplaisent dans la musique,
Mesnard Jean, “Pascal et la musique”, Pascal, Textes du tricentenaire, Fayard, 1963, p. 203. Curieuse application du principe trop de plaisir incommode. Cela suppose non seulement une certaine expérience de l’harmonie, mais aussi une réflexion, naturelle chez un contemporain de Mersenne, sur les effets psychologiques de la musique.
et trop de bienfaits irritent. Nous voulons avoir de quoi surpayer la dette. Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse. Ubi multum antevenere pro gratia odium redditur.
Les Copies et certains éditeurs lisent surpasser. Surpayer, selon Furetière, signifie payer une chose plus qu’elle ne vaut, l’acheter trop cher. Ce n’est certainement pas le sens ici.
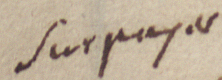
Les deux phrases sont tirées de Montaigne, Essais, III, VIII, De l’art de conférer, éd. Balsamo et alii, p. 985.
Tacite, Annales, IV, XVIII. « Les bienfaits sont agréables tant qu’on croit pouvoir payer sa dette. Mais s’ils sont excessifs, on rend de la haine au lieu de reconnaissance. »
Nous ne sentons ni l’extrême chaud, ni l’extrême froid. Les qualités excessives nous sont ennemies et non pas sensibles, nous ne les sentons plus, nous les souffrons. Trop de jeunesse et trop de vieillesse empêche l’esprit ; trop et trop peu d’instruction.
Enfin les choses extrêmes sont pour nous comme si elles n’étaient point et nous ne sommes point à leur égard ; elles nous échappent ou nous à elles.
Voilà notre état véritable. C’est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d’ignorer absolument.
Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d’un bout vers l’autre.
Mesnard Jean, “Desargues et Pascal”, in Dhombres J. et Sakarovitch J., Desargues en son temps, p. 98-99. Desargues : « l’entendement se sent vaguer en l’espace duquel il ne sait pas d’abord s’il continue toujours ou s’il cesse de continuer en quelque endroit » ; dans les infinis, « l’entendement s’y perd, non seulement à cause de leurs inimaginables grandeur et petitesse, mais encore à cause que le raisonnement ordinaire le conduit à en conclure des propriétés dont il est incapable de comprendre comment c’est qu’elles sont » : p. 99.
Sellier Philippe, “Sur les fleuves de Babylone : la fluidité du monde et la recherche de la permanence dans les Pensées”, in Port-Royal et la littérature. Pascal, 2e éd. Paris, Champion, 2010, p. 411-423. "Sur les fleuves de Babylone : la fluidité du monde et la recherche de la permanence", p. 239 sq. Le Psaume 137 : p. 412. Les fleuves qui embrasent plutôt qu'ils n'arrosent, symboles des passions humaines : p. 413 sq. L’image de l’homme abandonné dans l’île : p. 413. Idée générale de la fluidité des choses : p. 241.
Nicole Pierre, De la faiblesse de l’homme, I, ch. XI, Essais de morale, I, éd. L. Thirouin, p. 53. « Nous flottons dans la mer de ce monde au gré de nos passions, qui nous emportent tantôt d’un côté et tantôt d’un autre, comme un vaisseau sans voile et sans pilote ».
Susini Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence », à l’œuvre dans les Pensées, p. 574 sq. Étude de l’image.
Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd. 1993, p. 327, sur le style poétique tragique de ce passage.

