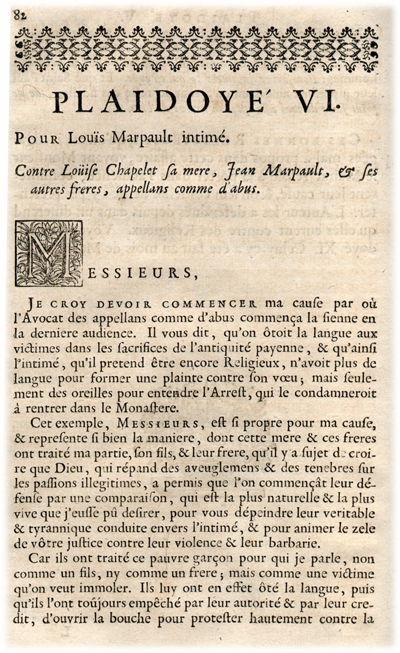Pensées diverses I – Fragment n° 29 / 37 – Papier original : RO 125-2
Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 100 p. 341 v° / C2 : p. 295-295 v°
Éditions savantes : Faugère I, 260, XLI et XLII / Havet XXV.132 et 76 / Brunschvicg 53 et 28 / Tourneur p. 81-2 / Le Guern 496 / Lafuma 579 et 580 (série XXIII) / Sellier 482
______________________________________________________________________________________
Bibliographie ✍
BOULEAU Charles, Charpentes. La géométrie secrète des peintres, Paris, Seuil, 1963. FORCE Pierre, “La nature et la grâce dans les Pensées de Pascal”, Op. cit., 2, Publications de l’Université de Pau, novembre 1993, p. 55-62. FUMAROLI Marc, L’Age de l’Éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, Genève, 1980. LESAULNIER Jean, Port-Royal insolite, Édition critique du Recueil de choses diverses, Paris, Klincksieck, 1992. McKENNA Antony et LESAULNIER Jean (dir.), Dictionnaire de Port-Royal, art. Le Maistre. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993. SUSINI Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Champion, 2008. |
✧ Éclaircissements
Carrosse versé ou renversé selon l’intention.
-------
Répandre ou verser selon l’intention.
Laf. 789, Sel. 645. Les sens. Un même sens change selon les paroles qui l’expriment. Les sens reçoivent des paroles leur dignité au lieu de la leur donner. Il en faut chercher des exemples.
Géométrie-Finesse I (Laf. 509, Sel. 669). Masquer la nature et la déguiser. Plus de roi, de pape, d’évêque, mais auguste monarque, etc. Point de Paris, capitale du royaume. Il y a des lieux où il faut appeler Paris, Paris et d’autres où il la faut appeler capitale du royaume.
Pascal s’intéresse aux différents sens du verbe verser, et aux synonymes que l’on emploie dans différents contextes.
Il envisage successivement un corps solide et les liquides.
Dans le cas d’un solide, Furetière définit verser, faire tomber sur le côté une machine roulante, soit carrosse, charrette ou coche, ou bateau.
Renverser en revanche signifie jeter par terre avec violence, abattre ; les ouragans renversent les bâtiments. Le verbe se dit aussi en choses spirituelles et morales : une grande affliction est capable de renverser l’esprit, de faire devenir fou ; cette doctrine renverse toutes les maximes de la religion et de la morale.
La différence est donc nette : renverser marque une violence destructrice qui n’est pas dans verser.
Verser signifie aussi faire écouler une chose liquide d’un vaisseau en l’inclinant ; répandre, épancher. Se dit figurément en choses spirituelles et morales ; le Saint-Esprit verse ses dons dans nos âmes (Furetière).
Répandre : Furetière donne pour respandre la définition suivante : épancher, faire tomber de la liqueur se dit aussi de la distribution de plusieurs choses, répandre de l’argent ; se dit figurément en choses morales, Dieu a répandu bien des grâces sur cette famille ; les mauvaises nouvelles se répandent. Répandre signifie aussi s’étendre beaucoup au long et au large, quand la rivière déborde, elle se répand dans ces prairies, elle inonde ces campagnes. Richelet : verser ; disperser ; exemples : répandre le sang, répandre des pleurs. Dans le cas des liquides, c’est l’ampleur du phénomène qui fait la différence entre les deux verbes.
Les sens varient donc considérablement avec les contextes. Ces remarques sur le verbe verser trouvent leur application et sans doute leur origine dans un passage d’un plaidoyer d’Antoine Le Maistre.
-------
Plaidoyer de M. Le M[aistre] sur le cordelier par force.
M. le M. : il s’agit d’Antoine Le Maistre, auteur de Plaidoyers célèbres. Sur l’avocat Antoine Le Maître, voir McKenna Antony et J. Lesaulnier (dir.), Dictionnaire de Port-Royal, art. Le Maistre. Les Plaidoyers de Le Maistre avaient fait de lui l’un des plus célèbres avocats de son temps. C’est après sa retraite à Port-Royal que la publication de ces plaidoyers fut réalisée (la première édition approuvée par l’auteur est de 1657). L’ouvrage est cité ici d’après Le Maistre Antoine, Les Plaidoyers et harangues de M. Le Maistre, donnés au public par M. Jean Issali, avocat au Parlement, 7e édition, Hortemels, 1688.
Sur la rhétorique d’Antoine Le Maistre, voir Fumaroli Marc, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et “res literaria” de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, Genève, 1980, p. 623 sq.
On attribue la Lettre d’un avocat au parlement à un de ses amis, touchant l’Inquisition qu’on veut établir en France à l’occasion de la nouvelle bulle du pape Alexandre VII (voir Les Provinciales, éd. L. Cognet, Paris, Garnier, 1983, p. 385 sq.) à Le Maistre, en collaboration avec Pascal.
Sur le jugement de Pascal sur le style des Plaidoyers de Le Maistre, voir l’extrait du Recueil de choses diverses, cité dans OC I, éd. J. Mesnard, p. 892 : « M. Le Maistre. Plaidoyers. M. Pascal s’en raillait et disait à M. Le Maistre qu’il avait pourtant bien écrit pour les gros bonnets du Palais, qui n’y entendent rien. » Voir aussi Lesaulnier Jean, Port-Royal insolite, p. 410. Pascal n’est apparemment pas le seul de son avis, car on lit ensuite : « Monsieur de Saint Elme, frère de Monsieur Le Maistre et de M. de Sacy, dit que les Plaidoyers de M. Le Maistre ne valent rien et qu’une oraison de Cicéron vaut mieux ».
Pourquoi Pascal cite-t-il le recueil des Plaidoyers de Le Maistre ?
Cette référence explique les considérations précédentes sur le verbe verser. Il fait allusion au sixième plaidoyer, intitulé dans la table des matières Pour un fils mis en religion par force, et en titre Plaidoyer VI, Pour Louis Mapault intimé, contre Louise Chapelet sa mère, Jean Mapault et ses autres frères, appelants comme d’abus, où il est écrit « Dieu qui répand des aveuglements et des ténèbres sur les passions illégitimes ». L’avocat défend un fils que ses parents ont forcé à entrer en religion contre sa volonté, contrairement à la règle qui veut qu’avant d’admettre des personnes, les monastères doivent s’informer « exactement par leur bouche si ce sont elles qui se portent à la religion de leur propre mouvement » : p. 87. Le jeune homme « pressait sa mère et ses frères de le retirer des cordeliers, y séchant de tristesse et de langueur : et la résistance continuelle, qu’il témoignait de jour en jour au dessein qu’ils avaient de le faire religieux à quelque prix que ce fût, était ce qui les animait davantage à l’exécuter », jusqu’à falsifier un extrait de baptême pour hâter les choses : p. 88-89. Le Maistre soutient que l’action des parents est contraire à la règle du concile de Trente (p. 97), mais il insiste sur le caractère de sacrilège que revêt leur action : p. 93. On trouve au début du plaidoyer le texte suivant : « Je crois devoir commencer ma cause par où l’avocat des appelants comme d’abus commença la sienne en la dernière audience. Il vous dit qu’on ôtait la langue aux victimes sans les sacrifices de l’antiquité païenne, et qu’ainsi l’intimé, qu’il prétend être encore religieux, n’avait plus de langue pour former une plainte contre son vœu, mais seulement des oreilles pour entendre l’arrêt qui le condamnerait à rentrer dans le monastère. Cet exemple, Messieurs, est si propre pour ma cause, et représente si bien la manière dont cette mère et ces frères ont traité ma partie, son fils et leur frère, qu’il y a sujet de croire que Dieu, qui répand des aveuglements et des ténèbres sur les passions illégitimes, a permis que l’on commençât leur défense par une comparaison qui est la plus naturelle et la plus vive que j’eusse pu désirer, pour vous dépeindre leur véritable et tyrannique conduite envers l’intimé, et pour animer le zèle de votre justice contre leur violence et leur barbare ». Brunschvicg, dans GEF XII, p. 57, explique la formule dans le sens suivant : « si nous avons bien interprété la remarque de Pascal, il eût fallu dire verse pour marquer l’intention divine ». Pascal veut sans doute dire que le verbe répandre est ici mal venu : dire que Dieu verse l’aveuglement ne va pas contre la doctrine chrétienne ; dire qu’il le répand implique qu’il veut que les ténèbres s’étendent, ce qui n’est jamais le cas. Mais l’expression selon l’intention suggère qu’il a bien compris que le choix du verbe répandre répond à une volonté d’amplification, voire de dramatisation, qui convient à l’exorde d’un plaidoyer. |
|
-------
Symétrie,
Lalande André, Vocabulaire…, art. Symétrie, p. 1082-1083. « Caractère de deux figures géométriques qui peuvent être placées d’une façon telle qu’à chaque point de l’une corresponde un point de l’autre, déterminé en abaissant de l’un de ces points une perpendiculaire sur une droite ou un plan (axe de symétrie) et en prolongeant cette perpendiculaire d’une longueur égale à elle-même ».
Noter que Pascal prend le mot symétrie dans un sens qui n’est pas habituel dans la mathématique de l’époque, mais qui répond au sens actuel. Voir Itard Jean, « L’Introduction à la Géométrie... », in L’Œuvre scientifique de Pascal, Centre International de synthèse, p. 115. Le terme symétrie est étranger au vocabulaire mathématique de l’époque. Le mot grec συμμετρία signifie d’abord réduction à une commune mesure, ce qui s’entend au sens des grandeurs commensurables. Voir Euclide, The thirteen books of the Elements, Livre X, Définition 1, éd. T. Heath, t. 3, Dover, p. 11 ; Les Éléments, Livre X, éd. Vitrac, t. 3, p. 25 sq. Sont dites grandeurs commensurables (σύμμετρα μεγέθη) celles qui sont mesurées par la même mesure, et incommensurables celles dont aucune commune mesure ne peut être produite. Symétrie appartient au vocabulaire de l’architecture : chez Vitruve, il signifie « proportion », et « marque en français le rapport et la parfaite ressemblance que les parties relatives ou appareillées d’un bâtiment ont l’une avec l’autre ». Dans ce style, le mot signifie aussi juste proportion, symétrie, et de là agréable disposition des parties d’un bâtiment, ordre de plusieurs choses placées l’une à l’égard de l’autre en quelque convenance ou proportion, correspondance de droite au gauche, du haut au bas, etc. L’idée de symétrie, toujours relative au sens de la vue, est particulièrement présente en peinture et en architecture.
en ce qu’on voit d’une vue,
La symétrie permet de saisir d’un seul regard la construction et l’harmonie d’un bâtiment ou d’un tableau. Elle permet donc d’obtenir tout de suite l’intuition d’une correspondance des deux parties, et de l’harmonie qui en résulte.
-------
fondée sur ce qu’il n’y a pas de raison de faire autrement,
Cette formule n’exprime pas une impuissance de l’homme, mais le fait que si l’on fait autrement que de raison, on ajoute et l’on fausse la vérité. On retrouve ici l’idée du fragment Laf. 578, Sel. 481. L’éloquence est une peinture de la pensée, et ainsi ceux qui après avoir peint ajoutent encore font un tableau au lieu d’un portrait.
La symétrie a pour avantage d’éviter l’invention inutile de pièces supplémentaires. La recherche de la symétrie ne doit donc pas viser à ajouter des éléments inutiles, ou plaisants pour l’auteur, mais à demeurer dans les limites du nécessaire.
Laf. 798, Sel. 650. Tout ce qui n’est que pour l’auteur ne vaut rien. Ambitiosa recidet ornamenta.
Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 119. Pascal s’interroge sur la raison d’être qui rend la symétrie plaisante. Elle provient de la « figure de l’homme ». Mais « si la beauté de la symétrie tient en son rapport à l’homme, elle serait infidèle à l’humain si elle s’accommodait du faux ».
Force Pierre, “La nature et la grâce dans les Pensées de Pascal”, Op. cit., 2, p. 55-62. Voir p. 59. L’abus de symétrie correspond à une application erronée du principe de similitude. La symétrie existe dans la nature. Il est donc bon que la rhétorique s’appuie sur des symétries. Mais construire des symétries purement verbales viole le principe de similitude, puisque des symétries ne constituent pas une imitation de la nature.
Sur l’usage de la symétrie chez Pascal, voir Susini Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Champion, 2008, p. 602 sq.
et fondée aussi sur la figure de l’homme.
Figure : selon Furetière, en termes de physique, figure est opposé à forme essentielle, et signifie seulement la configuration des corps ; il y a des corps de même nature, mais qui sont seulement de figure différente.
Interprétation du goût de la symétrie par la station debout propre à l’homme. Voir GEF XII, p. 38, qui remarque qu’il y a dans le texte de Pascal une tentative d’explication psychologique : c’est par l’œil et dans les limites de notre horizon visuel, que nous cherchons la symétrie, que nous ne voulons qu’en largeur parce que c’est le sens où l’homme lui-même est symétrique.
On trouve à cette idée un précédent intéressant dans saint Augustin, De vera religione, XXX, Bibliothèque augustinienne, 8, Paris, Desclée de Brouwer, 1951, p. 101. « Demandons-nous pourquoi nous sommes choqués de voir, de deux fenêtres non superposées, mais juxtaposées et qui pourraient être de dimensions égales, l’une est plus grande ou plus petite, alors que, si elles sont superposées, même une différence de moitié ne nous choque pas autant ; et pourquoi, du moment qu’il n’y en a que deux, nous ne nous soucions guère d’évaluer la différence de l’une à l’autre, tandis que, s’il y en a trois, le sens lui-même semble exiger ou bien qu’elles ne soient pas égales, ou bien que celle du milieu, entre la plus grande et la plus petite, offre des dimensions moyennes entre celles des deux autres. Ainsi, d’emblée, le jugement est pour ainsi dire dicté par la nature même ».
D’où il arrive qu’on ne veut la symétrie qu’en largeur, non en hauteur, ni profondeur.
La remarque vaut évidemment seulement si l’on conserve un point de vue fixe.
La figure verticale de l’homme et la disposition horizontale des yeux conduit à préférer la symétrie en largeur, c’est-à-dire horizontalement, de part et d’autre d’un axe vertical, car elle est immédiatement perceptible. Si la symétrie était prise en hauteur, c’est-à-dire, c’est-à-dire de part et d’autre d’un axe parallèle à l’horizon, les bâtiments et les tableaux auraient une partie haute symétrique à la partie basse, mais disposée à l’envers, ce qui aboutirait par exemple à placer les portes de la partie supérieure à l’envers.
La symétrie en profondeur, elle, aurait l’inconvénient de rendre l’axe de symétrie vertical difficile à assigner avec précision, en raison de l’éloignement progressif des objets.
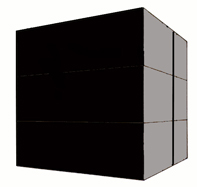
De même que les principes de la connaissance, nombre, temps, dimensions, naissent du fait que l’âme les trouve lorsqu’elle est jetée dans le corps (Preuves par discours I (Laf. 418, Sel. 680)), le goût esthétique dépend en partie de la structure corporelle de l’homme.
La Rochefoucauld, Maximes, éd. Truchet, Garnier, p. 555. Lettre de Mme de Sablé du 10 décembre 1663. Voir maxime 240, p. 62, une forme différente ; Liancourt, n° 258, p. 438. La symétrie, mais en rapport avec l’agrément (« séparé de la beauté ») de la personne. Il y a un rapport secret des traits ensemble, mais comme le je ne sais quoi, « on ne sait point les règles » de cette symétrie.
Le problème du goût dont l’homme témoigne pour la symétrie a aussi intéressé Montesquieu, qui invoque des causes différentes ; voir dans son Essai sur le goût dans les choses de la nature et de l’art le chapitre Des plaisirs de la symétrie, II, éd. R. Caillois, Pléiade, Paris, Gallimard, 1951, p. 1247-1248 : « Une des principales causes des plaisirs de notre âme lorsqu’elle voit des objets, c’est la facilité qu’elle a à les apercevoir : et la raison qui fait que la symétrie plaît à l’âme, c’est qu’elle lui épargne de la peine, qu’elle la soulage, et qu’elle coupe pour ainsi dire l’ouvrage par la moitié. De là suit une règle générale. Partout où la symétrie est utile à l’âme, et peut aider à ses fonctions, elle lui est agréable ; mais partout où elle est inutile, elle est fade parce qu’elle ôte la variété ».
Voir sur ce problème, tel qu’il se pose dans la peinture, ce qu’écrit Charles Bouleau, La géométrie secrète des peintres, p. 49 sq. « Dans les arts figuratifs, il n’existe pratiquement qu’une seule symétrie, la symétrie par rapport à un axe ou à un plan vertical. Pourquoi cette particularité ? Différents éléments semblent avoir concouru à un choix tout instinctif. D’abord et avant toute autre influence : l’homme. [...] L’homme a constaté que son propre corps était construit approximativement (et extérieurement) de part et d’autre d’un axe de symétrie vertical. Il a fait ensuite la même constatation sur les animaux et sur la plupart des formes que lui offrait la nature végétale. Le seul cas de symétrie par rapport à un plan horizontal qui se présentât à lui était celui des reflets dans l’eau claire des étangs. Mais si un arbre est symétrique comme le corps humain, quoique plus grossièrement, c’est pour des raisons d’équilibre, et nous touchons ici la cause véritable, bien qu’inconsciente, de cette prédilection artistique : la pesanteur. C’est bien sur la pesanteur que repose le principe de la balance, et c’est la balance en équilibre qui évoque le mieux la stabilité des parties d’un ensemble complexe étendu sur un même plan – comme est une œuvre de peintre ».