La liasse ORDRE (suite)
Fragments relatifs au problème de l’ordre dans les Pensées
Preuves de J.-C. 1 (Laf. 298, Sel. 329). Ordre du cœur.
Contrariétés 13 (Laf. 130, Sel. 163). S’il se vante, je l’abaisse…
Dossier de travail (Laf. 398, Sel. 17). Il faut d’abord passer par la bassesse, pour venir ensuite à la grandeur : c’est l’ordre que Pascal a suivi dans le renversement du pour au contre. Ce fragment corrige donc Contrariétés 13 qui donne à penser que l’ordre peut être quelconque ; en fait, on s’aperçoit que c’est le même, puisque Pascal envisage d’abord l’hypothèse que l’interlocuteur se vante.
Preuves par les juifs VI (Laf. 467, Sel. 704). Ordre. Après la corruption dire, il est juste que tous ceux qui sont en cet état le connaissent…
Pensées diverses (Laf. 532, Sel 457). J’écrirai ici mes pensées sans ordre…
Pensées diverses (Laf. 683, Sel. 562). Pourquoi prendrai-je plutôt à diviser ma morale en 4 qu’en 6.
Pensées diverses (Laf. 684, Sel. 563). Ordre. La nature a mis toutes ses vérités chacune en soi-même.
Dans Pensées diverses (Laf. 696, Sel. 575), disposition des matières se substitue à ordre. Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau, (l’ordre est) la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume c’est une même balle dont joue l’un et l’autre, mais l’un la place mieux.
Ordre et l’édition de Port-Royal
L’édition de Port-Royal ne propose aucun chapitre consacré à l’ordre, et elle ne retient que le dernier fragment, Ordre 10 (Laf. 12, Sel. 46) dans le chapitre XXVIII - Pensées chrétiennes. Ce dernier fragment n’est du reste pas envisagé essentiellement comme un programme de composition ou d’argumentation : les éditeurs le transforment pour en accentuer le caractère psychologique, relatif à la mentalité des incroyants.
Aucun texte de la liasse Ordre n’a été reproduit dans les Portefeuilles Vallant.
La plupart des autres fragments ont été recopiés par Louis Périer (dont une copie a été conservée) : il s’agit de Ordre 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; mais seuls Ordre 3 (entièrement) et 4 (partiellement) ont été publiés au XVIIIe par le père Desmolets (1728).
Aspects stratigraphiques des fragments de Ordre
Ernst Pol, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, Voltaire Foundation Universitas, 1996, Oxford, 480 p :
p. 290. Le fragment Ordre 1 (Laf. 1, Sel. 37) provient d’un feuillet à réglures.
p. 290. Le fragment Ordre 2 (Laf. 2 à 4, Sel. 38) est sur un papier portant une marque royale pour filigrane (type de feuille Marque royale et PF / B ♦ R).
p. 285 : Appartiendraient à la « strate FNIC » (type de feuille Deux écus de France et Navarre / I ♥ C)
Mais aucun d’eux ne porte de trace du filigrane et n’a été rapproché d’un papier portant un tel filigrane et pouvant rendre cette hypothèse incontestable (il faudrait au minimum mesurer à nouveau les écartements des pontuseaux en supposant que Pascal n’a pas utilisé d’autres types de papier ayant cette même caractéristique).
Les papiers de Ordre 4, 8 et 10 ne sont pas identifiés.
Pol Ernst a présenté des suppositions sur l’époque à laquelle Pascal a utilisé la « strate FNIC », à laquelle il rattache les fragments mentionnés ci-dessus : voir Ernst Pol, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, p. 241 sq. Pour l’examen critique de ces suppositions, qui sont difficilement recevables.
Bibliographie ✍
DESCOTES Dominique, “Le problème de l’ordre chez Pascal”, in Papasogli Benedetta (dir.), Le Pensées di Pascal : dal disegno all’edizione, Studi francesi, 143, Torino, Rosenberg et Sellier, mai-août 2004, p. 281-300.
ERNST Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970, p. 40 et 46.
ERNST Pol, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, Voltaire Foundation Universitas, 1996, Oxford.
FORCE Pierre, “Ordre et signification. Meaning, structure and history in the Pensées of Pascal”, in David Wetsel (éd.), Papers on French Seventeenth Century Literature, Biblio 17, Paris-Seattle-Tübingen, 1990.
FORCE Pierre, Pascal, Pensées, Nathan, Paris, 1997 128 p. Voir p. 19 sq.
MAEDA Yoichi, Commentaire des Pensées, I.
SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, p. 55 sq.
SOELBERG Nils, “La dialectique de Pascal. De la conférence de Port-Royal à la démarche apologétique”, Revue romane t. XIII, fasc. 2, 1978, p. 229-276.
SUEMATSU Hisashi, “Les Pensées et le métatexte”, Équinoxe, 1, automne 1987, p. 27-53.
MAEDA Yoichi, Commentaire des Pensées, I.
✧ Éclaircissements
♦ Sens et fonction de la liasse Ordre
Les commentateurs ne sont pas toujours d’accord sur la signification générale de la liasse Ordre : s’agit-il d’un dossier dont la seule fonction est d’ordre technique, ou Pascal comptait-il en tirer un chapitre d’ordre méthodologique qui aurait figuré en tête de son ouvrage ?
Philippe Sellier pense que Ordre rassemble des notes où, lors de l’agencement des vingt-sept rubriques provisoires de l’Apologie, Pascal a indiqué les projets nouveaux qui germaient en lui. Voir les Pensées, éd. Sellier, éd. Garnier, p. 164, p. 40, n. 1.
Ernst Pol, Approches pascaliennes, p. 46, interprète la liasse Ordre comme « un projet d’introduction générale » qui « devait comprendre deux Lettres », la Lettre qu’on doit chercher Dieu, et la Lettre d’ôter les obstacles, suivies de « précisions relatives au dessein général de l’Apologie » (p. 46).
Michel Le Guern, Les Pensées de Pascal, De l’anthropologie à la théologie, Paris, Larousse, 1972, p. 72, relève certaines hésitations dans la préparation de son plan par Pascal, mais il indique aussi qu’il y a « un thème pascalien de l’ordre », sur lequel plusieurs fragments notent des réflexions.
Le titre Ordre a donc un double sens : il désigne les fragments dans lesquels Pascal prépare la mise en ordre de ses matières ; mais il désigne aussi les textes dans lesquels il réfléchit sur cette recherche et tire les conclusions de ses échecs et de ses réussites.
Ces deux « ordres » de réflexion sont difficilement séparables.
Suematsu Hisashi, “Les Pensées et le métatexte”, Équinoxe, 1, automne 1987, p. 27-53. Voir p. 44 sq. Tous les fragments de la liasse Ordre appartiennent au métatexte, en ce sens qu’ils portent sur le texte de l’Apologie.
La question de fond consiste à savoir si, quoique relevant du « métatexte », les fragments de la liasse Ordre n’ont pas aussi une signification apologétique, autrement dit de savoir si l’explication que Pascal propose sur l’ordre qu’il veut suivre n’a pas aussi par elle-même une fonction apologétique. Il est très fréquent que Pascal ouvre ses écrits sur une explication préalable de sa méthode, de son plan ou de la succession des arguments ou des effets à produire (voir ci-dessous : Provinciale XI, Provinciale XV, Premier Ecrit des curés de Paris, Traité de la prédestination, Discours sur la possibilité des commandements, Lettre à Carcavy, etc.). Le plus souvent, cette explication sert à un moment ou à un autre d’argument.
♦ L’apparition de la préoccupation de l’ordre dans la préparation de l’Apologie
D’après Pol Ernst, Les Pensées de Pascal. Géologie et stratigraphie, p. 231 sq., c’est dans la « strate FNIC » que l’on voit apparaître des fragments qui marquent une préoccupation de l’ordre chez Pascal. Cela revient à placer la réflexion sur l’ordre après avril 1658. Voir ci-dessus les objections auxquelles s’expose cette supposition.
♦ Concept général d’ordre
Au sens le plus général, le mot désigne la succession d’objets qui peuvent être quelconques. C’est en ce sens que le prend Descartes dans les Regulae ad directionem ingenii, VI, Œuvres, éd. Alquié, I, p. 101 sq. : « Toutes les choses peuvent se disposer sous forme de séries, non point en tant qu’on les rapporte à quelque genre d’être, comme ont fait les philosophes qui les ont réparties en leurs catégories, mais en tant qu’elles peuvent se connaître les unes à partir des autres, en sorte que, chaque fois qu’il se présente une difficulté, nous puissions aussitôt nous rendre compte s’il sera utile d’en résoudre d’autres au préalable, lesquelles, et dans quel ordre. »
♦ Ordre, succession, série
La notion de série répond seulement à l’ordre et à la généalogie des connaissances. Une série se définit par son premier terme et par la loi qui permet d’obtenir chaque terme à partir du précédent. Le principe de la série est la possibilité de connaître une idée à partir d’une autre, de sorte qu’elle définit les connaissances qui sont successivement nécessaires pour arriver à une connaissance qu’on cherche. Il permet devant une difficulté de savoir si pour la résoudre, il faut en résoudre d’autres d’abord, lesquelles et dans quel ordre. Descartes distingue, dans une série d’éléments ordonnés, les absolus et les relatifs : les absolus sont ceux qui précèdent et par lesquels on arrive aux conséquents, qui ne peuvent être atteints qu’en passant par les premiers. Voir les Regulae ad directionem ingenii, VI, Œuvres, éd. Alquié, I, p. 102. ✍
Pour approfondir…
Voir Cassirer Ernst, Substance et fonction, p. 53. L’ordre n’est pas une composante des éléments eux-mêmes : il appartient à la relation sérielle qui les lie, et c’est de cette relation que l’on tire son caractère spécifique. C’est toujours à une relation transitive et asymétrique qu’il faut recourir pour imposer un ordre déterminé aux éléments d’une connexion.
On trouve une définition moderne de l’idée d’ordre dans Russell Bertrand, Introduction à la philosophie des mathématiques, p. 43 sq. L’ordre définit une succession des éléments. Dans un même groupe, il existe une multiplicité d’ordres. Pour qu’il y ait ordre dans une collection d’éléments, on demande que la relation qui sert à ordonner ait trois propriétés :
1. la relation doit être asymétrique : si x précède y, y ne peut pas précéder x : si x > y, il est impossible que x < y.
2. la relation doit être transitive : si x précède y, et si y précède z, x précède z : si x > y, et si si y > z, alors si x > z.
La transitivité se trouve dans les relations de plus et de moins, par exemple. Mais si x est frère ou sœur, de y et de z, il se peut que x ne soit pas frère ou sœur de z, car x et z peuvent être la même personne.
3. la relation doit être connective : si on donne deux termes quelconques de la classe à ordonner, l’un doit précéder et l’autre suivre. C’est vrai de deux nombres entiers, mais non de deux nombres complexes quelconques. De deux moments du temps, c’est vrai, mais non de deux événements qui seraient simultanés. Une relation est connexe lorsque, pour deux termes, elle existe entre le premier et le second, ou entre le second et le premier.
Necto : lier, attacher, nouer ; au passif, être enchaîné ; être lié, attaché ensemble : rerum causae aliae ex aliis aptae et necessitate nexae (Cicéron, Tusculanes, 5, 70). Nexus : enchaînement, entrelacement ; lien, nœud, étreinte.
Une relation est sériale quand elle est asymétrique, transitive et connexe.
♦ La notion d’ordre chez Pascal
Mesnard Jean, La culture au XVIIe siècle, p. 384 sq. Le terme d’ordre comporte chez Pascal deux sens distincts : c’est d’abord une structure reposant sur différents genres de réalité indépendants ; ce sont les ordres entendus au sens des genres de la géométrie. L’autre sens, c’est celui de la succession des idées. Ces deux idées sont liées étroitement, dans la mesure où, pour Pascal, inventer c’est soumettre la réalité à un certain ordre.
✍
Prigent Jean, “La conception pascalienne de l’ordre”, Ordre, désordre, lumière, Paris, 1952, p. 190-209.
Mesnard Jean, “Pascal ou la maîtrise de l’esprit”, Bulletin de la Société française de philosophie, n° 3, 2008, p. 1-38. Voir p. 19 sq., sur pensée et ordre.
Descotes Dominique, “Le problème de l’ordre chez Pascal”, in Papasogli Benedetta (dir.), Le Pensées di Pascal : dal disegno all’edizione, Studi francesi, 143, Torino, Rosenberg et Sellier, mai-août 2004, p. 281-300.
Descotes Dominique, “La messa a punto dell’ordine nei frammenti di Pascal”, in Romeo Maria-Vita, Le Provinciale oggi, Catania, CUECM, 2009, p. 33-45.
Thirouin Laurent, “Le défaut d’une droite méthode”, in Ronzeaud Pierre (dir.), Pascal, Pensées, Littératures classiques, n° 20, Klincksieck, Paris, 1994, p. 7-22.
♦ Ordre essentiel (ordo essentialis)
On parle d’ordre essentiel lorsque l’on envisage un ordre naturel entre les essences. Voir par exemple Duns Scot Jean, La théologie comme science pratique, éd. G. Sondag, p. 87, et Traité du premier principe, éd. Imbach et Putallaz, p. 45. Toute chose est soit antérieure, soit postérieure à une autre. En logique aristotélicienne, l’ordre de deux choses, considérée au plan de la substance, n’est pas entre ces choses, mais de l’une à l’autre, de sorte que le fait, pour une chose, d’être ordonnée à une autre, constitue pour elle une propriété intrinsèque et non une simple relation de raison. Antériorité et postériorité dans l’ordre sont des catégories très générales, dont il existe des formes particulières : par exemple, la cause n’est qu’une forme particulière de l’antériorité, et l’effet de la postérité. L’ordre essentiel représente ainsi l’ensemble des connexions possibles entre ce qui est antérieur et ce qui est postérieur : il servira donc de moyen terme de la démonstration, car il est à la fois une propriété transcatégoriale de l’être, et une propriété relative du premier principe lui-même ; il consiste en un ordre de relation réciproque entre les essences.
Pascal parle parfois de l’ordre de la nature ou de l’ordre objectif des choses. C’est le cas par exemple dans le fragment Laf. 684. Sel. 563 : Ordre. La nature a mis toutes ses vérités [chacune] en soi-même. C’est en ce sens que, dans le fragment Laf. 308, Sel. 339 (Preuves de Jésus-Christ 11), il présente les trois ordres comme une structure hiérarchique qui ordonne l’ensemble des réalités naturelle et surnaturelle.
Chez lui, ce sens de l’idée d’ordre est lié à l’idée de genre au sens mathématique du terme. Mais il y ajoute quelque chose : un genre est défini par ce qui le distingue des autres. L’univers des trois ordres est doté d’une hiérarchie d’ensemble, l’ordre de l’esprit étant supérieur à celui des corps, et l’ordre de la charité étant supérieur aux corps et aux esprits. Mais chaque ordre comporte aussi une hiérarchie interne, qui définit des degrés de grandeur en chacun d’eux. Voir le fragment Preuves de Jésus-Christ 11.
♦ L’ordre des matières
Le mot ordre a souvent un sens rhétorique, proche du mot dispositio, qui désigne la succession et le système des choses telles qu’elles sont présentées dans le discours. L’ordre est alors entendu comme mélange de dialectique et de rhétorique : voir Davidson Hugh, The origin of certainty, p. 4.
C’est en ce sens que le prend Descartes dans sa lettre au P. Mersenne du 24 décembre 1640, éd. Alquié, II, p. 301 : L’ordre des matières consiste à dire en un même lieu tout ce qui appartient à une matière. C’est l’ordre qui est adopté dans les sommes, qui prétendent exposer exhaustivement tout ce qui se rapporte à un sujet, à une discipline ou à une question générale.
Déjà, Aristote, Organon, IV, Analytiques II, I, 2, indique qu’il n’y a pas identité entre ce qui est antérieur par nature et ce qui est antérieur pour nous, ni entre ce qui est plus connu par nature et ce qui est plus connu pour nous.
Descartes va plus loin, et soutient que cet ordre n’est pas propre pour la démonstration.
Pascal remet aussi en cause la possibilité d’identifier l’ordre des matières et l’ordre qu’impose à ces choses l’art de l’homme, et la structure de sa pensée ou de son discours. Voir Laf. 684, Sel. 563 : Ordre. La nature a mis toutes ses vérités [chacune] en soi-même. Notre art les renferme les unes dans les autres, mais cela n’est pas naturel. Chacune tient sa place. De sorte que Pascal peut demander dans Laf. 683, Sel. 562 : Pourquoi prendrai-je plutôt à diviser ma morale en 4 qu’en 6. Pourquoi établirai-je plutôt la vertu en 4, en 2, en 1. Pourquoi en abstine et sustine plutôt qu’en suivre nature ou faire ses affaires particulières sans injustice comme Platon, ou autre chose. Mais voilà, direz-vous, tout renfermé en un mot : oui, mais cela est inutile si on ne l’explique. Et quand on vient à l’expliquer, dès qu’on ouvre ce précepte qui contient tous les autres ils en sortent en la première confusion que vous vouliez éviter. Ainsi quand ils sont tous renfermés en un ils y sont cachés et inutiles, comme en un coffre et ne paraissent jamais qu’en leur confusion naturelle. La nature les a tous établis, sans renfermer l’un en l’autre.
Cette critique de l’ordre par matières est associé, chez Pascal, à la critique de l’idée de la division rhétorique, qu’il considère comme plus capable d’engendrer de la confusion que d’apporter de la clarté dans la pensée. Voir Laf. 65, Sel. 99 (Misère 14).
♦ L’ordre des raisons
La disposition des arguments peut aussi être considérée comme un problème d’ordre successif à imposer aux arguments pour leur assurer un maximum d’efficacité rhétorique. Par exemple, Quintilien, Institution oratoire, V, 12, demande si les arguments les plus puissants doivent être placés au commencement, pour prendre possession des esprits, ou à la fin, pour les laisser aller sous cette impression, ou partie au commencement, partie à la fin, en laissant les éléments les plus faibles au centre.
L’ordre des raisons est l’ordre qu’impose aux idées et aux propositions leur enchaînement logique démonstratif. Il se distingue donc de l’ordre essentiel en ce qu’il concerne le discours et non les choses en elles-mêmes.
Cet ordre revêt un sens proche du sens rhétorique proche de dispositio, mais il implique que l’on y considère plutôt la connexion logique des propositions plutôt que la ressemblance des choses : il ne consiste pas en un classement des idées selon leurs caractères communs ou leurs différences, mais selon la succession logique qui conduit de la connaissance des unes à celle des autres.
C’est dans ce sens que doit s’entendre ce qui a été dit plus haut sur l’ordre tel que le conçoit Descartes, Œuvres, éd. Alquié, II, p. 581 : il consiste en ce que les choses qui sont proposées les premières doivent être connues sans l’aide des suivantes, et que les suivantes doivent être ensuite disposées de telle façon qu’elles soient démontrées par les seules choses qui les précèdent. Cette définition signifie qu’une proposition énoncée avant une autre est condition de cette autre, que toutes sont nécessaires les unes aux autres, et que la suppression d’une seule entraîne l’effondrement de l’ensemble : voir I, p. 21, et II, p. 274. C’est l’ordre suivi dans les Méditations ; voir Gueroult Martial, Descartes selon l’ordre des raisons, I, p. 20.
Ce souci de l’ordre rapproche Pascal de Descartes. L’éloge que L’esprit géométrique accorde à Descartes porte sur ce point, qu’une idée ne prend son sens véritable que dans l’enchaînement des raisons : malgré les réserves que suscite l’ambition cartésienne de science universelle, Pascal approuve la manière dont Descartes a tenté de tirer par ordre toute les conséquences qu’enferme l’évidence première du cogito : « je sais combien il y a de différence entre écrire un mot à l’aventure, sans y faire une réflexion plus longue et plus étendue, et apercevoir dans ce mot une suite admirable de conséquences, qui prouve la distinction des natures matérielle et spirituelle, et en faire un principe ferme et soutenu d’une physique entière, comme Descartes a prétendu faire ». Une pensée qui ne respecte pas l’ordre est mal conçue, et une pensée dont on ne rend pas l’ordre est mal comprise. C’est là-dessus que Pascal reprend le P. Noël : il manque à l’ordre en ce qu’il pose des propositions avant d’avoir défini les termes.
Si l’ordre fonde la validité des pensées, il fait aussi leur originalité : Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit de nouveau, la disposition des matières est nouvelle. Quand on joue à la paume, c’est une même balle dont joue l’un et l’autre, mais l’un la place mieux. J’aimerais autant qu’on me dise que je me suis servi des mots anciens. Et comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition différente, aussi bien que les mêmes mots forment d’autres pensées par leur différente disposition (Laf. 696, Sel. 575). Par exemple, Pascal pense que la nouveauté du cogito ne consiste pas en ce que Descartes aurait été le premier à en formuler l’idée, mais précisément en ce qu’il a su l’intégrer dans une chaîne de raisons dont il a tiré tout un système de conséquences entièrement original.
L’opuscule De l’esprit géométrique définit les règles de précession qui permettent de construire un ordre des raisons convaincant. Voir De l’Esprit géométrique, II, De l’art de persuader, § 14-16, p. 418-419 :
« Il importe donc bien de les comprendre et de les posséder, et c’est pourquoi, pour rendre la chose plus facile et plus présente, je les donnerai toutes en ce peu de règles qui renferment tout ce qui est nécessaire pour la perfection des définitions, des axiomes et des démonstrations, et par conséquent de la méthode entière des preuves géométriques de l’art de persuader.
Règles pour les définitions.
1. N’entreprendre de définir aucune des choses tellement connues d’elles-mêmes, qu’on n’ait point de termes plus clairs pour les expliquer.
2. N’admettre aucun des termes un peu obscurs ou équivoques sans définition.
3. N’employer dans la définition des termes que des mots parfaitement connus, ou déjà expliquez.
Règles pour les axiomes.
1. N’admettre aucun des principes nécessaires sans avoir demandé si on l’accorde, quelque clair et évident qu’il puisse être.
2. Ne demander, en axiomes, que des choses parfaitement évidentes d’elles-mêmes.
Règles pour les démonstrations.
1. N’entreprendre de démontrer aucune des choses qui sont tellement évidentes d’elles mêmes qu’on n’ait rien de plus clair pour les prouver.
2. Prouver toutes les propositions un peu obscures, et n’employer à leur preuve que des axiomes très évidents, ou des propositions déjà accordées ou démontrées.
3. Substituer toujours mentalement les définitions à la place des définis, pour ne pas se tromper par l’équivoque des termes que les définitions ont restreints. »
L’ordre démonstratif est défini par l’idée de précession : l’art de persuader, « qui n’est proprement que la conduite des preuves méthodiques parfaites, consiste en trois parties essentielles : à définir les termes dont on doit se servir par des définitions claires : à proposer des principes ou axiomes évidents pour prouver la chose dont il s’agit ; et à substituer toujours mentalement dans la démonstration les définitions à la place des définis. La raison de cette méthode est évidente, puis qu’il serait inutile de proposer ce qu’on veut prouver et d’en entreprendre la démonstration, si on n’avait défini clairement tous les termes qui ne sont pas intelligibles ; et qu’il faut de même que la démonstration soit précédée de la demande des principes évidents qui y sont nécessaires, car si l’on n’assure le fondement on ne peut assurer l’édifice. »
Pour Pascal, c’est la géométrie (et non pas la logique) qui donne le modèle de cet ordre dans sa plus grande perfection possible. L’opuscule De l’esprit géométrique indique que l’ordre strict et véritable est le privilège de la géométrie, « la seule des sciences humaines qui produise des démonstrations infaillibles », parce qu’elle suit la véritable méthode. Elle ne possède pas l’ordre parfait mais impossible, qui consisterait à tout définir et tout prouver ; mais elle se contente d’une perfection relative suffisante, qui consiste à définir et à prouver seulement le strict nécessaire, mais tout le nécessaire. Toutes les sciences autres que la géométrie demeurent par « une nécessité naturelle dans quelque sorte de confusion que les seuls géomètres savent extrêmement reconnaître ».
L’une des originalités principales de la pensée pascalienne de l’ordre des arguments est que Pascal en étend l’idée à tout le domaine de l’art de persuader : il parle d’ordre des idées pour l’art de convaincre, et pour l’art d’agréer. Voir sur ce point l’opuscule De l’esprit géométrique, II, De l’art de persuader, OC III, éd. J. Mesnard, p. 413 sq.
Droz Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal considéré dans le livre des Pensées, p. 40 sq. ✍
♦ Textes dans lesquels Pascal annonce préalablement l’ordre
Le souci que Pascal a de l’ordre apparaît dans les nombreux ouvrages qu’il ouvre sur l’annonce de l’ordre qu’il veut suivre.
C’est le cas dans les traités scientifiques. En géométrie, dans les Lettres de A. Dettonville, la Lettre à Carcavy présente, en tête de tous les autres traités relatifs à la roulette, le principe de la méthode des centres de gravité et la voie qui conduit de la connaissance des doubles onglets des trilignes à celle de leurs demi-solides de rotation.
En physique, le premier chapitre du Traité de la pesanteur de la masse de l’air présente une vue d’ensemble de tout le raisonnement qui conduit à l’application des principes du Traité de l’équilibre des liqueurs à la pression atmosphérique.
Dans la polémique religieuse, l’ouverture de la XIe Provinciale commence par distinguer la raillerie dirigée contre les choses saintes et la raillerie contre ceux qui les profanent. Cela annonce une première partie qui justifie le style des premières lettres de Pascal, et la seconde, qui montre comment les jésuites se moquent des choses saintes.
La XVe Provinciale annonce un plan en trois parties sur la question de la calomnie : Pascal montre d’abord que les jésuites disent des choses fausses contre leurs ennemis ; puis il déclare qu’il montrera que ces faussetés sont proférées intentionnellement, c’est-à-dire que les jésuites mentent ; la troisième partie traitera des raisons qui permettent aux jésuites de calomnier leurs ennemis en toute bonne conscience. C’est en effet le plan que suit Pascal.
Dans les Écrits sur la grâce, la deuxième rédaction du Traité de la prédestination présente une position du problème de la grâce et du péché où Pascal annonce comment il le traitera, par quels moyens et en usant de la progression qui va de l’incontesté au contesté.
Même dans la première Provinciale, qui repose pourtant sur des effets de surprise, Pascal annonce par la distinction de la question de fait et de droit le déroulement de l’enquête qu’il propose sur le pouvoir prochain.
Il y a donc des raisons de penser que Pascal aurait ouvert son apologie en s’expliquant sur l’ordre qu’il voulait suivre. C’est le cas dans le fragment Ordre 10 (Laf. 12, Sel. 46). Ordre. Les hommes ont mépris pour la religion. Ils en ont haine et peur qu’elle soit vraie. Pour guérir cela il faut commencer par montrer que la religion n’est point contraire à la raison. Vénérable, en donner respect. La rendre ensuite aimable, faire souhaiter aux bons qu’elle fût vraie et puis montrer qu’elle est vraie. Vénérable parce qu’elle a bien connu l’homme. Aimable parce qu’elle promet le vrai bien.
♦ Variations et dérogations de l’ordre
Dans certains textes Pascal évite d’annoncer l’ordre : ce sont ceux qui suivent l’ordre du cœur, qui ne dépendent pas d’une structure d’ordre sériel, comme la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Sur l’ordre du cœur, voir Laf. 308, Sel. 339 (Preuves de Jésus-Christ 11).
Le véritable ordre peut dans certains cas être un contre-ordre. La raison anthropologique en est donnée dans un fragment comme Laf. 519, Sel. 453. La nature nous a si bien mis au milieu que si nous changeons un côté de la balance nous changeons aussi l’autre. Je faisons zoa trekei.
Cela me fait croire qu’il y a des ressorts dans notre tête qui sont tellement disposés que qui touche l’un touche aussi le contraire. (partie barrée)
C’est particulièrement le cas lorsqu’il faut parler du scepticisme, par exemple :
Laf. 532, Sel. 457. Pyrr. J’écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans dessein. C’est le véritable ordre et qui marquera toujours mon objet par le désordre même.
Je ferais trop d’honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre puisque je veux montrer qu’il en est incapable.
Thirouin Laurent, “Le défaut d’une droite méthode”, in Ronzeaud Pierre (dir.), Pascal, Pensées, Littératures classiques, n° 20, Klincksieck, Paris, 1994, p. 7-22. ✍
♦ Sur les tentatives avortées de mise en ordre
Suematsu Hisashi, “Les Pensées et le métatexte”, Equinoxe, 1, automne 1987, p. 27-53. ✍
Pascal note parfois les difficultés qu’il a rencontrées dans la mise en ordre de ses idées, voire les échecs qu’il a subis.
Voir Laf. 694, Sel. 573 : Ordre. - J’aurais bien pris ce discours d’ordre comme celui-ci : pour montrer la vanité de toutes sortes de conditions, montrer la vanité des vies communes, et puis la vanité des vies philosophiques, pyrrhoniennes, stoïques ; mais l’ordre n’y serait pas gardé. Je sais un peu ce que c’est, et combien peu de gens l’entendent. Nulle science humaine ne le peut garder. Saint Thomas ne l’a pas gardé. La mathématique le garde, mais elle est inutile en sa profondeur.
J’aimerais autant qu’on me dise que je me suis servi des mots anciens. Et comme si les mêmes pensées ne formaient pas un autre corps de discours par une disposition différente, aussi bien que les mêmes mots forment d’autres pensées par leur différente disposition.
Pour approfondir…
♦ Polyvalence des démonstrations et nexus rationum
Le fait que l’ordre impose une mise en série des idées n’implique pas que cette série soit unilinéaire. Voir Gueroult Martial, Descartes selon l’ordre des raisons, I, p. 237 et II, p. 284 sq., qui explique à propos de Descartes que l’on doit considérer l’ordre des Méditations comme le lieu d’un nexus rationum. L’idée de nœud enferme d’abord celle de complexité : la series est une corde ; le nexus est un assemblage de cordes, ce qui implique que plusieurs problèmes sont solidaires l’un de l’autre, et qu’ils retentissent l’un sur l’autre. Autour de l’axe principal d’une démonstration prolifèrent des démonstrations secondaires, et chaque démonstration a des effets dans tous les domaines. Voir Vuillemin Jules, Mathématiques et métaphysique chez Descartes, p. 123.
C’est souvent le cas chez Pascal. De tels nœuds dans l’ordre sont fréquents dans l’œuvre mathématique. Les Lettres de A. Dettonville en donnent un exemple remarquable, lorsque Pascal cherche la mesure du bras d’un triligne sur sa base, c’est-à-dire de la distance qui sépare sa base AC de son centre de gravité : cette mesure s’obtient par la somme triangulaire des ordonnées (DF.DD) à l’axe AB, T (DF.DD). Le raisonnement s’énonce donc comme suit :
![]()
![]()

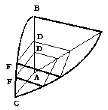
Du même coup, Pascal résout un autre problème, celui de la cubature de l’onglet sur la base AC du triligne BAC, ou de son double onglet. La somme des (DF.DA.DD), c’est-à-dire, puisque chaque DA est égal au segment FM ou FN correspondant, des rectangles (DF.FM.DD) ou (DF.FN.DD) est égale à la somme triangulaire des ordonnées (DF.DD)
![]()
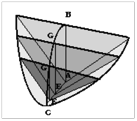
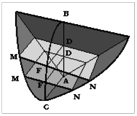
Ce sont donc deux problèmes de genre très différent, l’un sur la mesure de la dimension d’un solide, l’autre sur un centre de gravité, qui sont résolus en même temps.
Pascal effectue une semblable réduction dans les Pensées, lorsqu’il se propose de fournir les « Preuves des deux testaments à la fois ». Le raisonnement est le suivant : « Pour prouver d’un coup tous les deux il ne faut que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en l’autre. Pour examiner les prophéties il faut les entendre. Car si on croit qu’elles n’ont qu’un sens il est sûr que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont deux sens il est sûr qu’il sera venu en J.-C. Toute la question est donc de savoir si elles ont deux sens. » Au départ, il s’agit donc de résoudre un problème de vérité, savoir si les prophéties de l’Ancien Testament sont accomplies dans le Nouveau. Mais cette question présuppose la résolution d’une autre, car « pour examiner les prophéties il faut les entendre ». Celle-ci en enferme à son tour deux : l’une, de fait, de savoir « si elles ont deux sens » ; la seconde, d’interprétation, de savoir quel est le sens spirituel qui se cache derrière le sens charnel. Cette dernière question a une portée pour la vérification des prophéties, puisque c’est seulement si les prophéties « ont deux sens il est sûr qu’il sera venu en J.-C. » ; mais elle ouvre aussi un nouveau champ d’argumentation, relatif au caractère spirituel de la religion chrétienne, par opposition à la religion juive, ou à toute autre religion.
Le concept de tyrannie engendre un nexus rationum encore plus complexe. Il se dégage progressivement des rédactions successives des fragments Laf. 58, Sel. 91 (Misère 6) et Laf. 58, Sel. 92 (Misère 7). Sa signification est double. En premier lieu, il est directement lié à la substance de l’argumentation morale, dans la mesure où il répond au concept de misère, que Jean Mesnard définit comme l’état de la volonté privée du pouvoir. La tyrannie consiste à « vouloir avoir par une voie ce qu’on ne peut avoir que par une autre », c’est-à-dire à employer des moyens qui appartiennent à un ordre pour obtenir ce qui relève d’un autre. C’est une manière abusive de chercher remède à la misère. Dans ce contexte, les notions connexes sont celles d’usurpation et de violence. Le concept de tyrannie induit des argumentations sur la faiblesse de l’homme, dans la mesure où il entre dans la nature de moyens inadaptés de manquer leur but : la tyrannie est toujours vouée à l’échec et au ridicule. Mais ce concept a aussi sa place dans le fil critique de l’apologie : il permet de définir ce qui est insupportable à l’homme, soit du point de vue de l’esprit, soit du point de vue du cœur, autrement dit il doit aussi servir de critère d’admission ou de rejet des doctrines qui prétendent enfermer la vérité de la condition humaine. Ce que l’homme ne peut admettre, du point de vue de l’esprit, c’est qu’on lui impose une vérité par la force, sans laisser place à l’exercice de la raison, autrement dit qu’on cherche à imposer une superstition. Et du point de vue du bonheur, il ne peut supporter qu’on lui impose un bien qui ne soit pas le souverain bien, ou encore pire, une doctrine qui le réduise au désespoir.
Après Misère, ce concept fera plusieurs apparitions dans l’une ou l’autre fonction. Il réapparaît dans le discours de la Sagesse de Dieu, lorsqu’elle déclare que, pour ne pas s’imposer de manière tyrannique, elle prétend rendre compte à l’homme de son état par la doctrine de la corruption. Il est sous-jacent à Soumission et usage de la raison, qui accorde à la pensée humaine son exercice libre à partir des principes nouveaux de la Révélation. Il apparaît dans Fausseté des autres religions, dans la manière dont Pascal montre que Mahomet au contraire impose sa religion par violence. Enfin, il est dans Morale chrétienne, avec l’idée de membre du corps, qui exclut de la morale chrétienne la tyrannie totalitaire. Dans chacune de ces interventions, il sert de critère de filtrage, ou de discernement de la vérité et de l’erreur.
♦ Défaillances dans l’ordre et dans la méthode chez Pascal
Tocanne Bernard, “Flottements méthodologiques chez Pascal”, in Méthodes chez Pascal, p. 45 sq. ✍
Le nœud des raisons est particulièrement visible à la charnière de l’Apologie, qui repose sur une sorte de preuve apagogique. Le nerf de la démonstration est d’ordre critique, dans la mesure où il tire la conséquence du cercle vicieux où conduisent les philosophies humaines : les premiers chapitres ont montré que les contrariétés de la nature sont telles que de la grandeur on conclut la misère et inversement, sans fin. Cette impasse oblige à remettre en cause les fondements du problème : il faut récuser les principes fondés sur la raison naturelle des philosophes, puisque ce sont eux qui engendrent les apories auxquelles on s’est heurté, et poser les bases d’une problématique renouvelée, en acceptant des principes qui viennent d’une autre instance, savoir d’une révélation de nature religieuse. A P. R. en formule donc les termes, en posant les conditions auxquelles toute religion, pour pouvoir sérieusement prétendre exprimer la vérité, doit satisfaire. La première condition est d’ordre critique : cette vérité ne doit pas s’imposer de manière tyrannique, il faut qu’elle réponde à une exigence de la raison elle-même. Philosophes et Divertissement montrent qu’on ne doit pas demander à l’intérieur, comme le prétendent les Stoïciens, ce qu’on ne trouve pas à l’extérieur, comme le montre l’échec des conduites de diversion. A P. R. et Souverain Bien présentent les critères auxquels doit répondre la solution cherchée, Excellence confirme que la voie proposée par la religion chrétienne est conforme à ces exigences. Mais d’autres conditions ont été fournies par l’analyse morale, qui demeure valable de ce point de vue : la vraie religion doit déclarer le double aspect de misère et de grandeur de l’homme, et le besoin de vrai et de bien qui l’habite, et ensuite en expliquer la raison. Enfin Fausseté des autres religions envisage les mauvaises réponses qu’on peut donner au problème. On constate donc que, dans la question, les deux fils argumentatifs, moral et critique, forment un nœud si serré qu’on ne peut le défaire sans défaire toute la démonstration.
♦ Les couples dans l’ordre
Les liasses vont par couples :
Vanité par opposition à Raisons des effets
Misère, par opposition à Grandeur
Fausseté des autres religions et Religion aimable.
Les couples forment soit des ensembles liés soit des ensembles flottants.
Par ensembles liés, je désigne les couples dont l’un détermine l’autre : Soumission montre quelles sont les conditions que doit remplir une religion qui prétend être la vraie, Excellence montre comment le christianisme remplit ces conditions.
Par couples flottants, j’entends des couples dont l’ordre n’est pas déterminé de soi : c’est le cas de Misère et Grandeur, dont l’ordre est déterminé uniquement par l’art d’agréer, du fait qu’il faut affliger d’abord et consoler ensuite.
Lorsqu’on a affaire à un tel couple, il arrive que l’ordre ne soit pas fixé, voire qu’il soit dans une certaine mesure indifférent. Voir par exemple Laf. 408, Sel. 27 (Dossier de travail 26) : Une lettre de la folie de la science humaine et de la philosophie. Cette lettre avant le divertissement. Or c’est l’ordre inverse de celui des liasses. Mais c’est que Divertissement montre qu’on ne trouve pas le bonheur à l’extérieur de l’homme ; et Philosophes qu’on ne le trouve pas à l’intérieur. L’alternative fait qu’il faut éliminer les deux éventualités, mais du fait que c’est une alternative, rien n’oblige à commencer par un terme plutôt que par l’autre, sinon des exigences qui n’appartiennent pas à cette alternative même.
En revanche, dans d’autres cas, la précession est nécessaire, surtout lorsque par exemple la raison doit annoncer et expliquer l’effet. C’est le cas de Fondement et Loi figurative.

