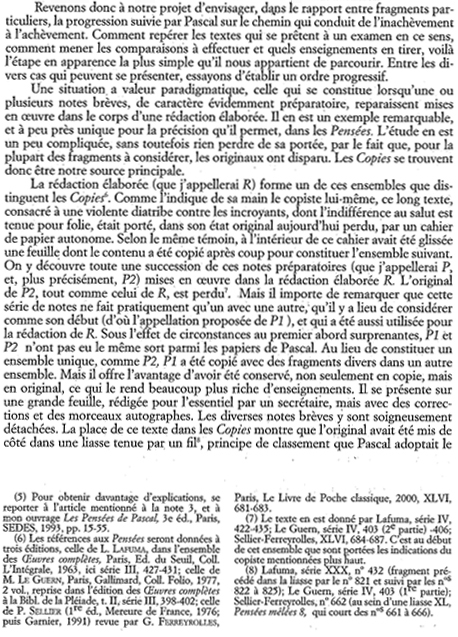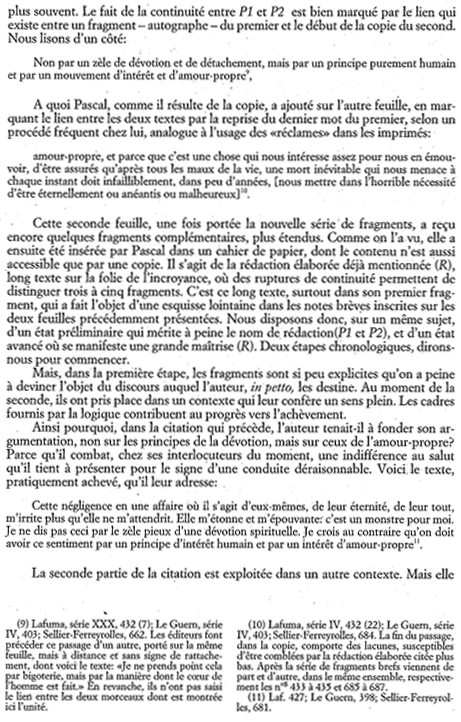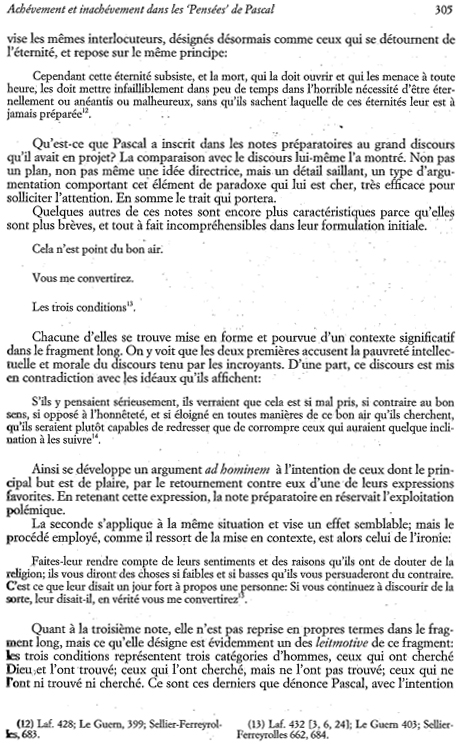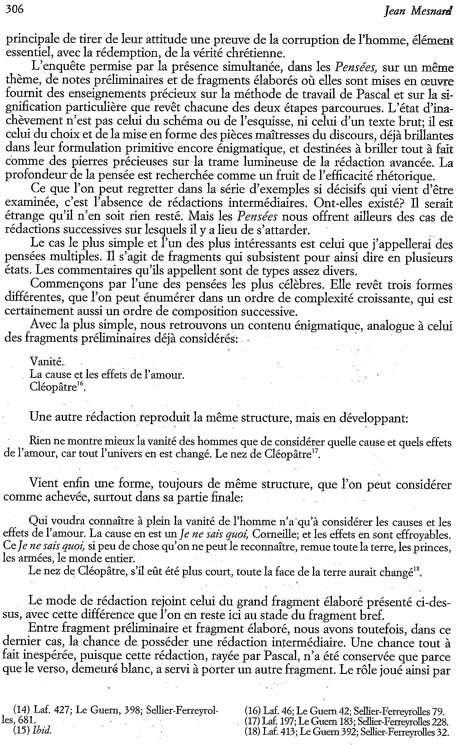Pensées diverses VIII – Fragment n° 2 / 6 – Papier original : RO 205
Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 188 p. 425 v° à 427 v° / C2 : p. 399 (copie de Pierre Guerrier)
Éditions de Port-Royal :
Chap. I - Contre l’Indifférence des Athées : 1669 et janv. 1670 p. 8 et 13 / 1678 n° 1 p. 7 et 12
Chap. XXVIII - Pensées Chrestiennes : 1669 et janv. 1670 p. 271 / 1678 n° 71 p. 264
Éditions savantes : Faugère II, 20 / Havet XXV.134 et 135, XXIV.45 et 8 bis / Brunschvicg 194 bis / Tourneur p. 313 / Le Guern 403 / Lafuma 432 (série XXX) / Sellier 662
______________________________________________________________________________________
Bibliographie ✍
Voir les bibliographies sur le Dieu caché et sur les Libertins. Voir la bibliographie du fragment Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681).
CHARLES-DAUBERT Françoise, Les libertins érudits en France au XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1998. DESCOTES Dominique, “De la XIe Provinciale aux Pensées”, in Treize études sur Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 75-83. DESCOTES Dominique, “Piège et paradoxe chez Pascal”, Méthodes chez Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 509-524. DESCOTES Dominique, L’argumentation chez Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1993. DROZ Édouard, Étude sur le scepticisme de Pascal, Paris, Alcan, 1886. FERREYROLLES Gérard, “L’ironie dans les Provinciales de Pascal”, Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises, 38, 1986, p. 39-50. FERREYROLLES Gérard, “Éthique et polémique en christianisme : le cas des Provinciales”, in J.-C. Darmon et P. Desan (dir.), Pensée morale et genres littéraires, Paris, Presses Universitaires de France, 2009, p. 63-80. FERREYROLLES Gérard, “Saint Thomas et Pascal : les règles de la polémique chrétienne”, in Séries et variations. Études littéraires offertes à Sylvain Menant, Paris, P. U. P. S., 2010, p. 687-703. GHEERAERT Tony, Le chant de la grâce. Port-Royal et le poésie d’Arnauld d’Andilly à Racine, Paris, Champion, 2003. GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Commentaires, Paris, Vrin, 1971. GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986. KOLAKOWSKI Leszek, Dieu ne nous doit rien, Brève remarque sur la religion de Pascal et l’esprit du jansénisme, Paris, Albin Michel, 1997. McKENNA Antony, “Le libertin interlocuteur de Pascal dans les Pensées”, in ROMEO Maria Vita (dir.), Abraham : individualità e assoluto, Atti delle giornate Pascal 2004, Catane, CUECM, 2006, p. 115-129. McKENNA Antony, Pascal et son libertin, Paris, Garnier, 2017. McKENNA Antony, Molière dramaturge libertin, Paris, Champion, 2005. McKENNA Antony, “Pascal et Gassendi : la philosophie du libertin dans les Pensées”, XVIIe siècle, 233, octobre 2006, p. 635-647. MESNARD Jean, Pascal, Coll. Les écrivains devant Dieu, Paris, Desclée de Brouwer, 1965. MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993. MESNARD Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320. MICHON Hélène, L’ordre du cœur. Philosophie, théologie et mystique dans les Pensées de Pascal, Paris, Champion, 2007. PINTARD René, “Pascal et les libertins”, in Pascal présent, Clermont-Ferrand, De Bussac, 1963. SELLIER Philippe, “Les leçons de la Lettre pour porter à rechercher Dieu”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 125-140. SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970. SELLIER Philippe, “Le Saint Augustin de Pascal”, Rivista di storia e letteratura religiosa, Firenze, L. S. Olschki, 2009, p. 359-371 ; repris in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 513-529. SHIOKAWA Tetsuya, Pascal et les miracles, Paris, Nizet, 1977. SILHON Jean de, De l’immortalité de l’âme, Paris, Pierre Billaine, 1634. STIKER-MÉTRAL Charles-Olivier, Narcisse contrarié. L’amour propre dans le discours moral en France (1650-1715), Paris Champion, 2007. SUSINI Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Champion, 2008. |
✧ Éclaircissements
Sur le protreptique pascalien, voir Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., 2010, p. 134 sq. Protreptique : exhortation à se tourner vers la vraie philosophie ou la vraie religion. Genre littéraire en cours dans la Grèce antique, notamment chez les stoïciens, consistant à exhorter. Ce sont des textes destinés à être lus, mais composés sur le mode oratoire. Le texte que Philippe Sellier intitule la Lettre pour porter à chercher Dieu s’inscrit dans ce genre.
Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320, a présenté une étude de ce texte à laquelle on doit renvoyer.
En voici le résumé. (Voir un extrait de l’article à la fin de ce commentaire).
J. Mesnard appelle R la rédaction élaborée du texte dans lequel Pascal s’en prend à l’indifférence des incrédules, qu’il taxe de folie : p. 303. C’est l’ensemble des fragments Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681), Preuves par discours II (Laf. 428-429, Sel. 682) et Preuves par discours II (Laf. 430-431, Sel. 683), dont l’état original est perdu, de sorte qu’il n’est connu que par les Copies. Cet ensemble a été appelé par Lafuma Série III.
Sur la page 205 du manuscrit original se trouvent les notes que J. Mesnard désigne par le sigle P1, qui porte dans Lafuma le n° 432 et dans Sellier le n° 662, et a été transportée dans le dossier Laf. XXX, Sel. XL - Pensées mêlées 8. P1 a été conservé en Copie, mais aussi en original. Le fait que de nombreux passages aient été barrés verticalement correspond au fait qu’ils ont été utilisés dans R. Le manuscrit, quoique barré, a été recopié lors de la confection des Copies.
Voir p. 303 pour la description du texte que Mesnard désigne par le sigle P2 (avec par erreur la référence 422 au lieu de 432 en note 7). Cet ensemble, que Lafuma a désigné par Série IV comprend les fragments Preuves par discours II (Laf. 432 série IV, Sel. 684), Preuves par discours II (Laf. 433, Sel. 685), Preuves par discours II (Laf. 434, Sel. 686) et Preuves par discours II (Laf. 435, Sel. 687). Ces fragments ne sont pas connus en original, on n’en a connaissance que par les Copies.
La continuité de P1 et P2 est marquée par le lien qui existe entre un fragment autographe du premier et le début de la copie du second : p. 304. On lit dans Laf. 432 série XXX, § 7 :
non par un zèle de dévotion et de détachement mais par un principe purement humain et par un mouvement d’intérêt et d’amour-propre. (texte barré verticalement)
À quoi Pascal a ajouté sur la feuille suivante (Preuves par discours II (Laf. 432 série IV, Sel. 684)), en marquant le lien entre les deux textes par la reprise du dernier mot du premier, comme une sorte de réclame :
amour-propre, et parce que c’est une chose qui nous intéresse assez pour nous en émouvoir, d’être assurés qu’après tous les maux de la vie une mort inévitable qui nous menace à chaque instant doit infailliblement, dans peu d’années … dans l’horrible nécessité … (texte barré verticalement)
La feuille, une fois portée la nouvelle série de fragments, a reçu encore quelques fragments complémentaires, plus étendus.
Par la suite, cette seconde feuille (P2) a été insérée par Pascal dans un cahier de papier, savoir R. J. Mesnard interprète ici ce que le copiste a ajouté au début de la Copie de P2 : « Ceci est dans le cahier commençant par les mots Qu’ils apprennent. »
On doit avoir pitié des uns et des autres, mais on doit avoir pour les uns une pitié qui naît de tendresse, et pour les autres une pitié qui naît de mépris. (texte barré)
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681), qui développe ces idées. Je ne puis avoir que de la compassion pour ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute, qui le regardent comme le dernier des malheurs, et qui n’épargnant rien pour en sortir font de cette recherche leurs principales et leurs plus sérieuses occupations. Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la vie et qui, par cette seule raison qu’ils ne trouvent pas en eux‑mêmes les lumières qui les en persuadent, négligent de les chercher ailleurs et d’examiner à fond si cette opinion est de celles que le peuple reçoit par une simplicité crédule, ou de celles qui, quoique obscures d’elles‑mêmes, ont néanmoins un fondement très solide et inébranlable, je les considère d’une manière toute différente.
Des uns et des autres : Pascal connaît deux sortes d’incrédules. Il distingue les incroyants qui cherchent et ceux qui vivent dans l’insouciance et dans l’indifférence de leur destinée. Toutes deux ont droit à la pitié, mais leurs conduites appellent un jugement différent : il faut plaindre ceux qui cherchent dans l’angoisse, parce qu’ils sont raisonnables, mais l’indifférence des autres provoque un jugement sévère en raison de son caractère aberrant. Voir Gouhier Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, p. 106.
Dans les deux cas toutefois, la pitié manifeste une forme de tendresse. Raisonner selon l’intérêt de l’adversaire définit ce que, selon Gilberte dans sa Vie de M. Pascal, ce dernier appelle la tendresse : voir dans la Vie de Pascal, 2e version, OC I, éd. J. Mesnard, p. 631, § 72-74, la définition pascalienne de la tendresse. Elle consiste à vouloir le bien d’autrui, y compris lorsqu’il faut le reprendre et le redresser rudement :
« C’est ainsi qu’il faisait voir qu’il aimait sans attache, et nous en avions eu encore une preuve dans la mort de mon père, pour lequel il avait sans doute tous les sentiments que doit avoir un fils reconnaissant pour un père bien affectionné ; car nous voyons dans la lettre qu’il écrivit sur le sujet de sa mort que, si la nature fut touchée, la raison prit bientôt le dessus ; et que, considérant cet événement dans les lumières de la foi, son âme en fut attendrie, non pas pour pleurer mon père qu’il avait perdu pour la terre, mais pour le regarder en Jésus-Christ, en qui il l’avait gagné pour le ciel. Il distinguait deux sortes de tendresse, l’une sensible, l’autre raisonnable, avouant que la première était de peu d’utilité dans l’usage du monde. Il disait pourtant que le mérite n’y avait point de part et que les honnêtes gens ne doivent estimer que la tendresse raisonnable, qu’il faisait ainsi consister à prendre part, à tout ce qui arrive à nos amis en toutes les manières que la raison veut que nous y prenions part aux dépens de notre bien, de notre commodité, de notre liberté, et même de notre vie, si c’est un sujet qui le mérite, et qu’il le mérite toujours, s’il s’agit de le servir pour Dieu qui doit être l’unique fin de toute la tendresse des chrétiens. « Un cœur est dur, disait-il, quand il connaît les intérêts du prochain, et qu’il résiste à l’obligation qui le presse d’y prendre part ; et au contraire un cœur est tendre quand tous les intérêts du prochain entrent en lui facilement, pour ainsi dire par tous les sentiments que la raison veut qu’on ait les uns pour les autres en semblables rencontres ; qui se réjouit quand il faut se réjouir, qui s’afflige quand il faut s’affliger. » Mais il ajoutait que la tendresse ne peut être parfaite que lorsque la raison est éclairée de la foi et qu’elle nous fait agir par les règles de la charité. C’est pourquoi il ne mettait pas beaucoup de différence entre la tendresse et la charité, non plus qu’entre la charité et l’amitié. Il concevait seulement que, comme l’amitié suppose une liaison plus étroite, et cette liaison une application plus particulière, elle fait que l’on résiste moins aux besoins de ses amis, parce qu’ils sont plus tôt connus et que nous en sommes plus facilement persuadés. Voilà comment il concevait la tendresse, et c’est ce qu’elle faisait en lui sans attachement et amusement, parce que, la charité ne pouvant avoir d’autre fin que Dieu, elle ne pouvait s’attacher qu’à lui, ni s’arrêter non plus à rien qui amuse ; parce qu’elle sait qu’il n’y a point de temps à perdre et que Dieu, qui voit et qui juge tout, nous fera rendre compte de tout ce qui sera dans notre vie, qui ne sera pas un nouveau pas pour avancer dans la voie uniquement permise qui est celle de la perfection. »
La tendresse telle que Pascal la conçoit consiste donc à agir pour le bien d’autrui, y compris lorsqu’il faut le reprendre et le redresser rudement.
Voir Commencement 12 (Laf. 162, Sel. 194) : Commencer par plaindre les incrédules, ils sont assez malheureux par leur condition. Il ne les faudrait injurier qu’au cas que cela servît, mais cela leur nuit.
Le type de la tendresse qui consiste à avoir intérêt à l’intérêt des autres, même quand ils l’oublient, trouve son modèle en Jésus-Christ au mont des Oliviers.
Pensée n° 6F (Le mystère de Jésus) (Laf. 919, Sel. 749). Jésus au milieu de ce délaissement universel et de ses amis choisis pour veiller avec lui, les trouvant dormant, s’en fâche à cause du péril où ils exposent non lui mais eux‑mêmes, et les avertit de leur propre salut et de leur bien avec une tendresse cordiale pour eux pendant leur ingratitude. Et les avertit que l’esprit est prompt et la chair infirme.
Pensée n° 15P (Laf. 931, Sel. 759). J’essaye d’être juste, véritable, sincère et fidèle à tous les hommes et j’ai une tendresse de cœur pour ceux à qui Dieu m’a uni plus étroitement.
Cependant Pascal ne se laisse pas aller à une naïve confiance dans la plainte que l’on accorde au malheur des autres.
Laf. 657, Sel. 541. Plaindre les malheureux n’est pas contre la concupiscence, au contraire, on est bien aise d’avoir à rendre ce témoignage d’amitié et à s’attirer la réputation de tendresse sans rien donner.
Une pitié qui naît de mépris : voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Mais pour ceux qui vivent sans le connaître et sans le chercher, ils se jugent eux-mêmes si peu dignes de leur soin, qu’ils ne sont pas dignes du soin des autres et qu’il faut avoir toute la charité de la religion qu’ils méprisent pour ne les pas mépriser jusqu’à les abandonner dans leur folie. Mais, parce que cette religion nous oblige de les regarder toujours, tant qu’ils seront en cette vie, comme capables de la grâce qui peut les éclairer, et de croire qu’ils peuvent être dans peu de temps plus remplis de foi que nous ne sommes, et que nous pouvons au contraire tomber dans l’aveuglement où ils sont, il faut faire pour eux ce que nous voudrions qu’on fît pour nous si nous étions à leur place, et les appeler à avoir pitié d’eux-mêmes, et à faire au moins quelques pas pour tenter s’ils ne trouveront pas de lumières.
Mépris : rebut, dédain, témoignage du peu d’estime qu’on fait d’une chose. La chose la plus dure pour un honnête homme, c’est le mépris ; les braves sont un généreux mépris de la vie.
Voir Loi figurative 24 (Laf. 269, Sel. 300). Il y en a qui voient bien qu’il n’y a pas d’autre ennemi de l’homme que la concupiscence qui les détourne de Dieu, et non pas des [iniquités], ni d’autre bien que Dieu, et non pas une terre grasse. Ceux qui croient que le bien de l’homme est en sa chair et le mal en ce qui le détourne des plaisirs des sens, qu’il[s] s’en soûle[nt] et qu’il[s] y meure[nt].
-------
Il faut bien être dans la religion qu’ils méprisent pour ne les pas mépriser. (texte barré)
Le passage dans lequel Pascal développe cette pensée permet d’en préciser le sens.
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Mais pour ceux qui vivent sans le connaître et sans le chercher, ils se jugent eux-mêmes si peu dignes de leur soin, qu’ils ne sont pas dignes du soin des autres et qu’il faut avoir toute la charité de la religion qu’ils méprisent pour ne les pas mépriser jusqu’à les abandonner dans leur folie.
La simple justice conduirait à abandonner avec mépris les incroyants paresseux à leur folie. Mais la charité chrétienne interdit de céder à cette tentation et exclut que l’on puisse traiter des incrédules par le mépris : sans rien céder sur le mépris dû à une insouciance aussi inepte, elle oblige malgré tout à ne pas laisser les incrédules se précipiter à leur perte. La miséricorde indispensable au chrétien n’empêche pas d’appeler un chat un chat et une folie une folie ; mais elle exige que l’on conserve le souci du salut du prochain, dans la mesure où il peut y contribuer.
-------
Cela n’est point du bon air. (texte barré)
Air signifie manière d’agir, de parler, de vivre, soit en bonne ou en mauvaise part. Il est des gens du bel air ; il a bon air, bonne grâce à parler à danser (Furetière).
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Il faut qu’il y ait un étrange renversement dans la nature de l’homme pour faire gloire d’être dans cet état, dans lequel il semble incroyable qu’une seule personne puisse être. Cependant l’expérience m’en fait voir un si grand nombre, que cela serait surprenant si nous ne savions que la plupart de ceux qui s’en mêlent se contrefont et ne sont pas tels en effet. Ce sont des gens qui ont ouï dire que les belles manières du monde consistent à faire ainsi l’emporté. C’est ce qu’ils appellent avoir secoué le joug, et qu’ils essayent d’imiter. Mais il ne serait pas difficile de leur faire entendre combien ils s’abusent en cherchant par là de l’estime. Ce n’est pas le moyen d’en acquérir, je dis même parmi les personnes du monde qui jugent sainement des choses et qui savent que la seule voie d’y réussir est de se faire paraître honnête, fidèle, judicieux et capable de servir utilement son ami, parce que les hommes n’aiment naturellement que ce qui peut leur être utile.
Pascal veut donc dire que, quoique les impies croient prendre une apparence favorable en niant la religion chrétienne, ils ne s’aperçoivent pas qu’ils se rendent méprisables aux yeux des honnêtes gens.
-------
Cela montre qu’il n’y a rien à leur dire, non par mépris mais parce qu’ils n’ont pas le sens commun. Il faut que Dieu les touche. (texte barré)
Il faut que Dieu les touche : le prolongement est donné plus bas par la formule (barrée horizontalement) Mais si nous ne pouvons les toucher, ils ne seront pas inutiles. C’est l’esquisse d’une orientation essentielle de l’argumentation de Pascal : elle comporte
1. un constat d’impuissance : on ne peut pas toucher des personnes qui poussent l’inconscience et l’incohérence aussi loin ; Dieu seul peut les sortir de l’état où ils se trouvent ;
2. en revanche, leur attitude peut servir à instruire les incrédules qui n’ont pas perdu leur bon sens et le souci d’eux-mêmes.
La conséquence de cette limite de la parole apologétique est exprimée en termes nets dans le fragment Loi figurative 24 (Laf. 269, Sel. 300). Il y en a qui voient bien qu’il n’y a pas d’autre ennemi de l’homme que la concupiscence qui les détourne de Dieu, et non pas des [iniquités], ni d’autre bien que Dieu, et non pas une terre grasse. Ceux qui croient que le bien de l’homme est en sa chair et le mal en ce qui le détourne des plaisirs des sens, qu’il[s] s’en soûle[nt] et qu’il[s] y meure[nt]. Mais ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n’ont de déplaisir que d’être privés de sa vue, qui n’ont de désir que pour le posséder et d’ennemis que ceux qui les en détournent, qui s’affligent de se voir environnés et dominés de tels ennemis, qu’ils se consolent. Je leur annonce une heureuse nouvelle : il y a un libérateur pour eux ; je le leur ferai voir ; je leur montrerai qu’il y a un Dieu pour eux ; je ne le ferai pas voir aux autres. Je ferai voir qu’un Messie a été promis pour délivrer des ennemis, et qu’il en est venu un pour délivrer des iniquités, mais non des ennemis.
Le correctif nécessaire est apporté par le fragment Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Mais pour ceux qui vivent sans le connaître et sans le chercher, ils se jugent eux-mêmes si peu dignes de leur soin, qu’ils ne sont pas dignes du soin des autres et qu’il faut avoir toute la charité de la religion qu’ils méprisent pour ne les pas mépriser jusqu’à les abandonner dans leur folie. Mais, parce que cette religion nous oblige de les regarder toujours, tant qu’ils seront en cette vie, comme capables de la grâce qui peut les éclairer, et de croire qu’ils peuvent être dans peu de temps plus remplis de foi que nous ne sommes, et que nous pouvons au contraire tomber dans l’aveuglement où ils sont, il faut faire pour eux ce que nous voudrions qu’on fît pour nous si nous étions à leur place, et les appeler à avoir pitié d’eux-mêmes et à faire au moins quelques pas pour tenter s’ils ne trouveront pas de lumières.
Rien à leur dire : entendre par discours rationnel. Dieu ne convertit pas les hommes par la raison : il agit sur le cœur. Voir Grandeur 6 (Laf. 110, Sel 142). Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux et bien légitimement persuadés, mais ceux qui ne l’ont pas, nous ne pouvons la donner que par raisonnement en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n’est qu’humaine et inutile pour le salut.
-------
Les gens de cette sorte sont académistes, écoliers, et c’est le plus méchant caractère d’hommes que je connaisse. (texte barré)
Faut-il lire académistes écoliers, comme s’il s’agissait d’une seule sorte de personne, les sceptiques débutants, ou de deux, comme s’il s’agissait de deux qualités différentes, mais qui conviennent aux mêmes personnes ? Le manuscrit porte une virgule entre les deux mots (voir la transcription diplomatique), ce qui introduit une disjonction entre deux caractères différents. Lafuma et Sellier gardent donc la virgule. Mais ni C1 ni C2 ne mettent de virgule.
Cependant le texte parle bien des mêmes personnes : des demi-académistes, qui affectent le doute sans en tirer toutes les conséquences.
Académiste : Pascal entend sans doute par ce mot la catégorie de sceptiques qui ne savent ni aller jusqu’au bout du scepticisme, comme le font les pyrrhoniens, ni recueillir la sagesse qui se trouve dans un certain scepticisme. Pascal a mentionné cette catégorie de sceptiques dans le fragment Grandeur 5 (Laf. 109, Sel. 141). Cela suffit pour embrouiller au moins la matière, non que cela éteigne absolument la clarté naturelle qui nous assure de ces choses. Les académiciens auraient gagé, mais cela la ternit et trouble les dogmatistes, à la gloire de la cabale pyrrhonienne qui consiste à cette ambiguïté ambiguë, et dans une certaine obscurité douteuse dont nos doutes ne peuvent ôter toute la clarté, ni nos lumières naturelles en chasser toutes les ténèbres. Voir aussi Fausseté 6 (Laf. 208, Sel. 240).
Écolier : GEF XIII, p. 116, explique ce mot comme suit : « imitateurs des belles manières dont ils ont entendu parler ». Ph. Sellier pense qu’il s’agit de « sceptiques de parti-pris, répétant dévotement les grands mots de quelques esprits forts ». Le mot se dit aussi de ceux qui savent imparfaitement une chose, mais qui sont d’autant plus obstinés à soutenir des idées dont ils ne mesurent pas vraiment la portée. Cet homme sera toujours écolier, il ne saura jamais bien cette science ; ce n’est qu’un écolier en géométrie, qu’un apprentif à l’égard d’un tel. La notion semble proche de celle de demi-habile ; mais elle ajoute l’idée d’une certaine obstination prétentieuse dans la sottise.
Méchant : mauvais, qui est dépourvu de bonnes qualités, qui ne mérite aucune estime ; ce mot se joint à presque tous les substantifs de la langue pour marquer leurs défauts. En la nature on dit une méchante bête. En morale, on le dit de ce qui est contre la raison, les lois, les bonnes mœurs ; un méchant garnement, une méchante femme, un méchant juge, une méchante action (Furetière). Le mot ne s’entend pas au sens actuel.
-------
Vous me convertirez. (texte barré)
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). S’ils y pensaient sérieusement, ils verraient que cela est si mal pris, si contraire au bon sens, si opposé à l’honnêteté, et si éloigné en toutes manières de ce bon air qu’ils cherchent, qu’ils seraient plutôt capables de redresser que de corrompre ceux qui auraient quelque inclination à les suivre. Et, en effet, faites-leur rendre compte de leurs sentiments et des raisons qu’ils ont de douter de la religion ; ils vous diront des choses si faibles et si basses, qu’ils vous persuaderont du contraire. C’était ce que leur disait un jour fort à propos une personne : « Si vous continuez à discourir de la sorte, leur disait-il, en vérité vous me convertirez. » Et il avait raison, car qui n’aurait horreur de se voir dans des sentiments où l’on a pour compagnons des personnes si méprisables ?
-------
Je ne prends point cela par bigoterie, mais par la manière dont le cœur de l’homme est fait, non par un zèle de dévotion et de détachement, mais par un principe purement humain et par un mouvement d’intérêt et d’amour‑propre. (texte barré)
Bigot : qui contrefait le dévot, qui prie Dieu avec hypocrisie. La cabale des bigots est fort dangereuse. Bigot se dit aussi de ceux qui ont une superstition, et une dévotion outrée (Furetière).
Détachement : Furetière indique que le mot se prend figurément en morale, pour désintéressement ou désengagement. Il donne pour exemple le détachement du monde. C’est sans doute en ce dernier sens que Pascal entend ici le mot.
Pascal a évité le mot de bigoterie dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Cette négligence en une affaire où il s’agit d’eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, m’irrite plus qu’elle ne m’attendrit ; elle m’étonne et m’épouvante : c’est un monstre pour moi. Je ne dis pas ceci par le zèle pieux d’une dévotion spirituelle. J’entends au contraire qu’on doit avoir ce sentiment par un principe d’intérêt humain et par un intérêt d’amour-propre : il ne faut pour cela que voir ce que voient les personnes les moins éclairées.
Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”, Studi francesi, 143, 2004, p. 304.
-------
Il est sans doute qu’il n’y a point de bien sans la connaissance de Dieu, qu’à mesure qu’on en approche on est heureux et que le dernier bonheur est de le connaître avec certitude, qu’à mesure qu’on s’en éloigne on est malheureux et que le dernier malheur serait la certitude du contraire. (texte barré)
Il est sans doute qu’il n’y a point de bien sans la connaissance de Dieu : voir la liasse Souverain bien. Toutes les tentatives qui ont été faites par les hommes pour trouver un souverain bien constant et satisfaisant se sont soldées par des échecs. Ces biens sont en effet des substituts de Dieu, qui seul peut remplir le cœur de l’homme.
Ce n’est pas l’écriture de Pascal, mais il a apporté une correction. Ce n’est pas une addition, mais bien une correction, car sans les mots qu’on en approche, portés en interligne, la phrase n’a pas de sens.
Qu’à mesure qu’on en approche on est heureux : cette formule demande à être nuancée ou précisée à l’aide de l’Écrit sur la conversion du pécheur.
Que le dernier bonheur est de le connaître avec certitude : cette certitude est la certitude du cœur, et non pas seulement la certitude rationnelle. C’est ce que Pascal exprime dans ce passage du Mémorial (Laf. 913, Sel. 742), qui associe directement la certitude au sentiment (qui est toujours du cœur), et à la joie, qui est identique au bonheur : Certitude, certitude, sentiment, joie, paix.
Que le dernier malheur serait la certitude du contraire : il faut entendre qu’il serait désespérant de penser qu’en approchant de Dieu on serait malheureux et qu’en s’en éloignant on serait heureux.
-------
C’est donc un malheur que de douter, mais c’est un devoir indispensable de chercher dans le doute, et ainsi celui qui doute et qui ne cherche pas est tout ensemble malheureux et injuste ; que s’il est avec cela gai et présomptueux, je n’ai point de terme pour qualifier une si extravagante créature. (texte barré)
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Ainsi notre premier intérêt et notre premier devoir est de nous éclaircir sur ce sujet, d’où dépend toute notre conduite. Et c’est pourquoi, entre ceux qui n’en sont pas persuadés, je fais une extrême différence de ceux qui travaillent de toutes leurs forces à s’en instruire, à ceux qui vivent sans s’en mettre en peine et sans y penser. [...] C’est donc assurément un grand mal que d’être dans ce doute ; mais c’est au moins un devoir indispensable de chercher, quand on est dans ce doute ; et ainsi celui qui doute et qui ne recherche pas est tout ensemble et bien malheureux et bien injuste. Que s’il est avec cela tranquille et satisfait, qu’il en fasse profession, et enfin qu’il en fasse le sujet de sa joie et de sa vanité, je n’ai point de termes pour qualifier une si extravagante créature.
Celui qui doute et qui ne cherche pas, est tout ensemble malheureux et injuste ; que s’il est avec cela gai et présomptueux, je n’ai point de terme pour qualifier une si extravagante créature : repris presque littéralement dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : ainsi celui qui doute et qui ne recherche pas est tout ensemble et bien malheureux et bien injuste. Que s’il est avec cela tranquille et satisfait, qu’il en fasse profession, et enfin qu’il en fasse le sujet de sa joie et de sa vanité, je n’ai point de termes pour qualifier une si extravagante créature.
Une si extravagante créature : voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : Cette négligence en une affaire où il s’agit d’eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, m’irrite plus qu’elle ne m’attendrit ; elle m’étonne et m’épouvante : c’est un monstre pour moi.
Monstre : prodige qui est contre l’ordre de la nature, qu’on admire ou qui fait peur. Aristote dit que le monstre est une faute de la nature, qui voulant agir pour quelque fin, n’y peut pas néanmoins arriver, à cause que quelques-uns de ses principes sont corrompus (Furetière).
-------
Cependant il est certain que l’homme est si dénaturé qu’il y a dans son cœur une semence de joie en cela.
La note est de l’écriture de Pascal. C’est une addition en marge de gauche. Cette idée n’est pas utilisée dans la version développée. Elle n’a pas été barrée.
Les deux Copies donnent le même texte en marge de gauche, mais une partie du texte est illisible parce que la reliure la masque. C’est un cas où il faut déchiffrer la Copie à l’aide du manuscrit.
Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Or quel avantage y a‑t‑il pour nous à ouïr dire à un homme qui nous dit qu’il a donc secoué le joug, qu’il ne croit pas qu’il y ait un Dieu qui veille sur ses actions, qu’il se considère comme seul maître de sa conduite et qu’il ne pense en rendre compte qu’à soi‑même ? Pense‑t‑il nous avoir porté par là à avoir désormais bien de la confiance en lui et en attendre des consolations, des conseils et des secours dans tous les besoins de la vie ? Prétendent‑ils nous avoir bien réjoui, de nous dire qu’ils tiennent que notre âme n’est qu’un peu de vent et de fumée, et encore de nous le dire d’un ton de voix fier et content ? Est‑ce donc une chose à dire gaiement ? Et n’est‑ce pas une chose à dire tristement, au contraire, comme la chose du monde la plus triste ? Quelque certitude qu’ils eussent, c’est un sujet de désespoir plutôt que de vanité. S’ils y pensaient sérieusement, ils verraient que cela est si mal pris, si contraire au bon sens, si opposé à l’honnêteté et si éloigné en toutes manières de ce bon air qu’ils cherchent, qu’ils seraient plutôt capables de redresser que de corrompre ceux qui auraient quelque inclination à les suivre.
Semence : se dit figurément en morale, de la cause des guerres, des dissensions, des procès (Furetière), et de toutes sortes d’effets. Les hérésies sont des semences de séditions. Le sang des martyrs a été une semence de chrétiens. Pascal pense au « mauvais levain » qui « signifie la malignité qui est cachée et empreinte dans le cœur de l’homme », que cite à plusieurs reprises le fragment Rabbinage 2 (Laf. 278, Sel. 309) sur la tradition ample du péché originel selon les Juifs.
-------
Est‑ce une chose à dire avec joie ? C’est une chose qu’on doit donc dire tristement. (texte barré)
Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Que s’il est avec cela tranquille et satisfait, qu’il en fasse profession, et enfin qu’il en fasse le sujet de sa joie et de sa vanité, je n’ai point de termes pour qualifier une si extravagante créature. Où peut-on prendre ces sentiments ? Quel sujet de joie trouve-t-on à n’attendre plus que des misères sans ressource ? Quel sujet de vanité de se voir dans des obscurités impénétrables, et comment se peut-il faire que ce raisonnement se passe dans un homme raisonnable ?
La tristesse que doit inspirer l’incapacité de croire est exprimée par le discours de l’incrédule inquiet dans le fragment Preuves par discours II (Laf. 429, Sel. 682).
-------
Le beau sujet de se réjouir et de se vanter la tête levée en cette sorte... : Donc réjouissons-nous, vivons sans crainte et sans inquiétude, et attendons la mort puisque cela est incertain, et nous verrons alors ce qu’il arrivera de nous. Je n’en vois pas la conséquence. (texte barré)
Le début est d’une autre main. Pascal ajoute le discours des incrédules, emprunté au Livre de la Sagesse. L’addition est postérieure à la note suivante. L’ensemble est barré, parce que Pascal l’a utilisé dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Le reproche d’inconséquence est cependant présent dans tout ce dernier fragment.
Pascal fait écho au discours des méchants dans le livre de la Sagesse. Voir la Bible de Port-Royal, Sagesse, II, 6, p. 807 : « Les méchants ont dit dans l’égarement de leurs pensées : Le temps de notre vie est court et fâcheux. L’homme après sa mort n’a plus de biens à attendre, et on ne sait personne qui soit revenu des enfers. 2. Nous sommes nés comme à l’aventure, et après la mort nous serons comme si nous n’avions jamais été. La respiration est dans nos narines comme une fumée, et l’âme comme une étincelle de feu qui remue notre cœur. 3. Lorsqu’elle sera éteinte, notre corps sera réduit en cendre. L’esprit se dissipera comme un air subtil, notre vie disparaîtra comme une nuée qui passe, et s’évanouira comme un brouillard qui est poussé en bas par les rayons du soleil, et qui tombe, étant appesanti par sa chaleur. 4. Notre nom s’oubliera avec le temps, sans qu’il reste aucun souvenir de nos actions parmi les hommes. 5. Car le temps de notre vie est une ombre qui passe, et après la mort, il n’y a plus de retour ; le sceau est posé et nul n’en revient. 6. Venez donc, jouissons des biens présents ; hâtons-nous de jouir des créatures pendant que nous sommes jeunes. » La suite appelle à la débauche et à l’injustice.
Le commentaire de l’édition de Port-Royal renvoie à ce que saint Paul écrit dans la première Lettre aux Corinthiens, XV, v. 32. Voir aussi Isaïe, LVI, 12.
Laf. 618, Sel. 511. S’il y a un Dieu il ne faut aimer que lui et non les créatures passagères. Le raisonnement des impies dans la Sagesse n’est fondé que sur ce qu’il n’y a point de Dieu. Cela posé, dit‑il, jouissons donc des créatures. C’est le pis‑aller. Mais s’il y avait un Dieu à aimer il n’aurait pas conclu cela mais bien le contraire. Et c’est la conclusion des sages : il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures.
Cazelles Henri, Introduction à la Bible, tome 2, Introduction critique à l’Ancien Testament, Paris, Desclée, 1973, p. 717 sq. Le Livre de la Sagesse. Livre attribué par les manuscrits grecs de la Bible à Salomon ; mais c’est un simple procédé littéraire. La Sagesse et les impies : p. 719 sq. D’emblée, l’auteur interpelle les rois, comme d’égal à égal (ce qui n’a rien d’étonnant si l’on suppose que c’est Salomon qui parle). Les impies regardent la mort comme une amie à laquelle ils sont dignes d’appartenir ; ils nient toute vie après la mort. À ce discours des impies ne répond pas d’autodéfense des justes : c’est le Sage qui défend leur cause : p. 719. Ils sont dans la main de Dieu et le jugement de Dieu fera voir leur gloire. Les impies dont la vie est longue seront parmi les morts dans l’opprobre pour toujours : p. 720.
Le P. Toussaint Desmares, dans la Lettre d’un ecclésiastique au P. de Lingendes, p. 11, emploie le même passage de la Sagesse pour caractériser les libertins.
Sirmond Antoine, De immortalitate animae, Pars II ch. III, Paris, Soly, 1635, p. 66. Même raisonnement sur le texte de la Sagesse. Voir la traduction française, Démonstration de l’immortalité de l’âme, tirée des principes de la nature, fortifiés de ceux de l’Aristote, IIe partie, ch. IV, Paris, Soly, 1637, p. 48-49.
Pascal change l’accent de l’argument, en faisant primer, dans le présent fragment et dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681), l’idée de l’insouciance et de l’incohérence sur celle du réjouissement : Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que moi-même ; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses ; je ne sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît non plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir ; mais ce que j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Comme je ne sais d’où je viens, aussi je ne sais où je vais ; et je sais seulement qu’en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant, ou dans les mains d’un Dieu irrité, sans savoir à laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage. Voilà mon état, plein de faiblesse et d’incertitude. Et, de tout cela, je conclus que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit m’arriver. Peut-être que je pourrais trouver quelque éclaircissement dans mes doutes ; mais je n’en veux pas prendre la peine, ni faire un pas pour le chercher ; et après, en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin - quelque certitude qu’ils en eussent, c’est un sujet de désespoir, plutôt que de vanité - je veux aller, sans prévoyance et sans crainte, tenter un si grand événement, et me laisser mollement conduire à la mort, dans l’incertitude de l’éternité de ma condition future.
Je n’en vois pas la conséquence : conséquence a ici un sens logique : en philosophie, note Furetière, on le dit de la conclusion d’un raisonnement et de toute sorte d’argumentation : quand on a accordé les deux prémisses d’un syllogisme, il faut aussi accorder la conséquence. Je n’en vois pas la conséquence signifie je ne vois pas la suite logique de ce raisonnement ; sous-entendu : ce raisonnement est dépourvu de cohérence logique. L’idée que l’incrédule raisonne de travers se trouve dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : comment se peut-il faire que ce raisonnement se passe dans un homme raisonnable ? Suit le discours d’un incrédule qui est conscient de sa condition faible et mortelle, mais qui refuse de se donner la peine de chercher s’il n’y a pas de remède à sa misère.
-------
N’est‑ce pas assez qu’il se fasse des miracles en un lieu et que la providence paraisse sur un peuple ?
Cette note ne touche apparemment pas le même sujet que les précédentes. Elle est jetée en marge dans un espace laissé libre par les notes sur les incrédules ; elle n’a pas été utilisée, et n’a pas été barrée.
Qu’il se fasse des miracles en un lieu : il s’agit sans doute de Port-Royal et du miracle de la sainte Épine.
Que la providence paraisse sur un peuple : cette proposition pourrait évoquer aussi le miracle de la sainte Épine. Pascal en parle en ces termes dans la XVIe Provinciale : « Vous calomniez celles qui n’ont point d’oreilles pour vous ouïr, ni de bouche pour vous répondre. Mais Jésus-Christ, en qui elles sont cachées pour ne paraître qu’un jour avec lui, vous écoute, et répond pour elles. On l’entend aujourd’hui, cette voix sainte et terrible, qui étonne la nature, et qui console l’Église. Et je crains, mes Pères, que ceux qui endurcissent leurs cœurs, et qui refusent avec opiniâtreté de l’ouïr quand il parle en Dieu, ne soient forcés de l’ouïr avec effroi quand il leur parlera en Juge. » Pascal pense que le miracle manifeste à tous la justice de son combat en faveur de Port-Royal.
-------
Le bon air va à n’avoir point de complaisance, et la bonne piété à avoir complaisance pour les autres.
Note en marge de gauche écrite par Pascal, non exploitée et non barrée. La remarque est d’ordre purement moral et n’a peut-être rien à voir avec les autres textes. Cependant on peut noter que ce bon air, qui n’a point de complaisance, s’oppose non seulement à la bonne piété, mais à la définition de la tendresse qui a été mentionnée plus haut.
N’avoir point de complaisance : complaisance n’a pas nécessairement un sens dépréciateur. Furetière la définit comme une « déférence aux sentiments et aux volontés d’autrui ». Dans le monde il faut avoir de la complaisance, même pour les sots. C’est donc en principe une qualité de l’honnête homme qui respecte les idées d’autrui. Un exemple de manque de complaisance pourrait être fourni dans le fragment Laf. 658, Sel. 542 : Conversation. Grands mots à la religion : Je la nie. Le mot prend un sens moins favorable si l’on entend par déférence un respect et une soumission tels que « la complaisance est d’ordinaire accompagnée de flatterie » (Furetière). Ce n’est pas le cas ici.
Voir Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : Cependant l’expérience m’en fait voir un si grand nombre, que cela serait surprenant si nous ne savions que la plupart de ceux qui s’en mêlent se contrefont et ne sont pas tels en effet. Ce sont des gens qui ont ouï dire que les belles manières du monde consistent à faire ainsi l’emporté. C’est ce qu’ils appellent avoir secoué le joug, et qu’ils essayent d’imiter.
-------
Est‑ce courage à un homme mourant d’aller, dans la faiblesse et dans l’agonie, affronter un Dieu tout-puissant et éternel ? (texte barré)
Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Ainsi ceux qui ne font que feindre ces sentiments seraient bien malheureux de contraindre leur naturel pour se rendre les plus impertinents des hommes. S’ils sont fâchés dans le fond de leur cœur de n’avoir pas plus de lumière, qu’ils ne le dissimulent pas : cette déclaration ne sera point honteuse. Il n’y a de honte qu’à n’en point avoir. Rien n’accuse davantage une extrême faiblesse d’esprit que de ne pas connaître quel est le malheur d’un homme sans Dieu ; rien ne marque davantage une mauvaise disposition du cœur que de ne pas souhaiter la vérité des promesses éternelles ; rien n’est plus lâche que de faire le brave contre Dieu. Qu’ils laissent donc ces impiétés à ceux qui sont assez mal nés pour en être véritablement capables ; qu’ils soient au moins honnêtes gens s’ils ne peuvent être chrétiens, et qu’ils reconnaissent enfin qu’il n’y a que deux sortes de personnes qu’on puisse appeler raisonnables : ou ceux qui servent Dieu de tout leur cœur parce qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu’ils ne le connaissent pas.
Nicole Pierre, Discours où l’on fait voir combien les entretiens des hommes sont dangereux, Seconde partie, ch. V, Essais de morale, II, éd. 1755, p. 97. « Il n’y a point de courage à ne pas craindre Dieu, parce qu’il n’y a qu’un aveuglement horrible qui nous puisse empêcher de le craindre [...]. C’est un excès de folie à des hommes faibles et misérables de le braver pour un moment quand il diffère de les punir, en se mettant au hasard d’éprouver pour jamais la rigueur de sa justice, quand ils ne se pourront empêcher de la sentir. »
Voltaire, Lettres philosophiques, XXV, § XXXII, éd. Naves, p. 164 sq. ; éd. Ferret et McKenna, p. 181, nie que la question de Pascal réponde à une possibilité réelle.
Boullier David Renaud, Sentiments de M*** sur la critique des Pensées de Pascal par M. Voltaire, § XXXI, p. 89. « Il ne peut arriver, dit M. V., que dans un violent transport de cerveau, qu’un homme dise : Je crois un Dieu, et je le brave. Un incrédule au lit de la mort fait pourtant ce que dit Pascal, et qu’on traite ici d’impossible ; et plût au ciel que nous en eussions moins d’exemples ! Combattre la religion jusqu’au bout, sans avoir seulement des raisons plausibles de la croire fausse, c’est affronter réellement jusques dans l’agonie, un Dieu tout-puissant et éternel ».
Braver Dieu jusqu’au dernier moment, c’est bien ce que fait le Dom Juan de Molière.
-------
Que je serais heureux si j’étais en cet état, qu’on eût pitié de ma sottise et qu’on eût la bonté de m’en tirer malgré moi !
L’idée trouve un prolongement dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Mais, parce que cette religion nous oblige de les regarder toujours, tant qu’ils seront en cette vie, comme capables de la grâce qui peut les éclairer, et de croire qu’ils peuvent être dans peu de temps plus remplis de foi que nous ne sommes, et que nous pouvons au contraire tomber dans l’aveuglement où ils sont, il faut faire pour eux ce que nous voudrions qu’on fît pour nous si nous étions à leur place, et les appeler à avoir pitié d’eux-mêmes, et à faire au moins quelques pas pour tenter s’ils ne trouveront pas de lumières. Mais ce n’est pas exactement la même idée, car l’idée qu’on puisse avoir pitié de la sottise de l’incrédule a été supprimée.
Qu’on eût la bonté de m’en tirer malgré moi : cette dernière expression peut sembler paradoxale. Y a-t-il de la bonté à tirer un homme de ses illusions malgré lui ? Pascal justifie la légitimité d’un traitement parfois vigoureux de l’erreur dans les quatre règles formulées dans la XIe Provinciale, éd. Cognet, Garnier, p. 203-206.
-------
N’en être pas fâché et ne pas aimer, cela accuse tant de faiblesse d’esprit et tant de malice dans la volonté. (texte barré)
-------
Quel sujet de joie de ne plus attendre que des misères sans ressource ! Quelle consolation dans le désespoir de tout consolateur ! (texte barré)
Ressource doit être mis au singulier. Furetière définit le mot comme suit : espérance ou moyen de se rétablir, quand on a fait des pertes ; ce marchand n’est pas perdu sans ressource. Sa dernière ressource a été de se jeter dans un couvent. Le pluriel convient plutôt au cas où les moyens dont on dispose sont de nature différente : Il a du crédit et des amis, il a de grandes ressources.
Les deux Copies omettent de marquer que le texte est biffé sur l’original. Texte repris de manière quasi textuelle dans Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681) : Où peut-on prendre ces sentiments ? Quel sujet de joie trouve-t-on à n’attendre plus que des misères sans ressource ? Quel sujet de vanité de se voir dans des obscurités impénétrables ? Quelle consolation de n’attendre jamais de consolateur ? Mais le texte définitif comporte une amplification, avec l’expression sur les ténèbres sans ressource.
-------
Mais si nous ne pouvons les toucher, ils ne seront pas inutiles.
Mais ceux‑là mêmes qui semblent les plus opposés à la gloire de la religion, nous en ferons le premier argument qu’il y a quelque chose de surnaturel. [Ils] n’y seront pas inutiles pour les autres. Car un aveuglement de cette sorte n’est pas une chose naturelle. Et si leur folie les rend si contraires à leur propre bien, elle servira à en garantir les autres par l’horreur d’un exemple si déplorable et d’une folie si digne de compassion.
Voir plus haut, la formule il faut que Dieu les touche, dont c’est ici le prolongement. C’est l’esquisse d’une orientation essentielle de l’argumentation de Pascal : elle comporte
1. un constat d’impuissance : on ne peut pas toucher des personnes qui poussent l’inconscience et l’incohérence aussi loin ; Dieu seul peut les sortir de l’état où ils se trouvent ;
2. en revanche, leur attitude peut servir à instruire les incrédules qui n’ont pas perdu leur bon sens et le souci d’eux-mêmes.
L’impossibilité de toucher les incrédules paresseux, qui devrait être désespérante pour un apologiste, n’en trouve pas moins une utilité réelle. Voir la partie barrée horizontalement qui précède immédiatement : l’inconscience des incrédules est si monstrueuse qu’elle paraîtra visible aux autres. Les incrédules inconscients seront utiles à d’autres, qu’elle rappellera à la réalité.
Pascal pense-t-il à la formule etiam peccata, même les péchés servent ? Il pouvait la trouver chez Saint Augustin, De liberio arbitrio libri tres, III, 9, 26, in Œuvres, 6, Dialogues philosophiques, III, Bibliothèque augustinienne, p. 432-433 : « Quapropter si ad miseriam nisi peccando non pervenit anima, etiam peccata nostra necessaria sunt perfectioni universitatis quam condidit Deus ». Tr. : « Par conséquent, si l’âme ne tombe dans le malheur qu’en péchant, nos péchés aussi sont nécessaires à la perfection de l’univers que Dieu a créé ». Voir aussi saint Augustin, De doctrina christiana, III, XXIII, 33, Bibliothèque augustinienne, 11/2, 1997 : « Si qua vero peccata magnorum virorum legerit, tametsi in eis aliquam figuram rerum futurarum animavertere atque indagare potuerit, rei tamen gestae proprietatem ad hunc adsumat, ut se nequaquam recte factis suis jactare audeat et prae sua justitia ceteros tamquam peccatores contemnat, cum videat tantorum virorum et cavendas tempestates et flenda naufragia. Ad hoc enim etiam peccata illorum hominum scripta sunt, ut apostolica illa sententia ubique tremenda sit, cum ait : Quapropter qui videtur stare, videat ne cadat ». Trad. de Madeleine Moreau : « S’il lui arrive de lire le récit des péchés commis par de grands personnages, il peut, sans doute, y remarquer et y découvrir une figure des événements à venir ; qu’il tire cependant de l’interprétation au sens propre de cet acte la leçon que voici : n’avoir en aucune façon l’audace de se vanter soi-même de ses actions bonnes, et : ne jamais mépriser, au nom de sa propre justice, les autres comme pécheurs, en voyant bien et qu’il faut prendre garde aux tempêtes essuyées par de si grands hommes, et déplorer leur naufrages. En outre, les péchés de ces personnages nous ont été racontés aussi pour que soit partout redoutable cette pensée de l’Apôtre : Voilà pourquoi celui qui semble debout doit prendre garde de ne pas tomber ».
Voir Laf. 566, Sel. 472. Tout tourne en bien pour les élus.
Est‑ce qu’ils sont si fermes qu’ils soient insensibles à tout ce qui les touche ? Éprouvons‑les dans la perte des biens ou de l’honneur. Quoi ! c’est un enchantement.
Preuves par discours II (Laf. 427, Sel. 681). Rien n’est si important à l’homme que son état ; rien ne lui est si redoutable que l’éternité. Et ainsi qu’il se trouve des hommes indifférents à la perte de leur être, et au péril d’une éternité de misère, cela n’est point naturel. Ils sont tout autres à l’égard de toutes les autres choses : ils craignent jusqu’aux plus petites, ils les prévoient, ils les sentent ; et ce même homme qui passe les jours et les nuits dans la rage et dans le désespoir pour la perte d’une charge, ou pour quelque offense imaginaire à son honneur, est celui là même qui sait qu’il va tout perdre par la mort, et qui demeure néanmoins sans inquiétude, sans trouble, et sans émotion. Cette étrange insensibilité pour les choses les plus terribles dans un cœur si sensible aux plus légères ; c’est un enchantement incompréhensible, et un assoupissement surnaturel.
La perte des biens ou de l’honneur : l’édition Sellier indique à juste titre qu’il y a là une allusion sarcastique au passage du Cid de Corneille (I, 4), où Don Diègue se désespère d’avoir été giflé par Don Gormas, « offense imaginaire à son honneur » qui le rend indigne de la charge de précepteur du fils du roi. Mais entre la note brève du présent fragment et la rédaction élaborée, Pascal a restreint et précisé l’idée. L’expression les biens et l’honneur ne convient pas au cas de Don Diègue, dont les biens ne sont pas en cause. Dans la rédaction élaborée, il concentre l’attention sur l’offense à l’honneur parce qu’elle seule est vraiment l’effet de l’imagination (alors que la perte des biens peut être un mal effectif). L’allusion à Corneille, nettement perceptible dans l’allusion à la plainte « Ô rage ! Ô désespoir » devient ainsi à la fois précise, exacte, et évocatrice.
♦ Extrait de Mesnard Jean, “Achèvement et inachèvement dans les Pensées de Pascal”,
Studi francesi, 143, anno XLVIII, maggio-agosto 2004, p. 300-320 (en particulier, p. 303-306)