Fragment connu par l’édition de Port-Royal de 1670 – Le papier original est perdu
Copies manuscrites du XVIIe s. : absent de C1 et C2
Éditions de Port-Royal : chap. XV - Preuves de Jésus-Christ par les prophéties : 1669 et janv. 1670 p. 126 / 1678 n° 17 p. 126-127
Éditions modernes : Havet XVIII.14 / Brunschvicg 727 (n. 5) / Lafuma 487 (note) / Sellier 2010, p. 586
______________________________________________________________________________________
Bibliographie ✍
BARTMANN Bernard, Précis de théologie dogmatique, Mulhouse-Tournai, Casterman-Salvator, 1941, 2 vol. MESNARD Jean, “Sur une « nouvelle pensée » de Pascal, authentique ou fabriquée ?”, Courrier du Centre International Blaise Pascal, 28, 2006, p. 27-36. NADAÏ Jean-Christophe de, Jésus selon Pascal, Paris, Desclée, 2008. SELLIER Philippe, “Jésus-Christ chez Pascal”, in Port-Royal et la littérature, I, Pascal, Paris, Champion, 1999, p. 271 sq. ; 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 486 sq. THIROUIN Laurent,Marie PÉROUSE et Gilles PROUST, “Une nouvelle « pensée » de Pascal”, Courrier du Centre International Blaise Pascal, 27, 2005, p. 3-6.
|
✧ Éclaircissements
La découverte de ce bref texte a suscité une controverse, qui a donné lieu à la publication de deux articles dans les livraisons 27 et 28 (2005-2006) du Courrier du Centre International Blaise Pascal. Nous en donnons le texte dans les Éclaircissements qui suivent, moins pour parvenir à une certitude indiscutable sur l’authenticité du fragment que pour déterminer les termes du problème.
Quand il est parlé du Messie, comme grand et glorieux, il est visible que c’est pour juger le monde, et non pour le racheter. (Isaïe 65. 15. 16)
Bartmann Bernard, Précis de théologie dogmatique, I, Mulhouse-Tournai, Casterman-Salvator, 1941, p. 180 sq., sur la justice de Dieu. Sur le retour du Christ et le jugement dernier, voir I, p. 455. Sur le jugement particulier et le jugement dernier, voir II, p. 509 sq. et p. 540 sq.
Nadaï Jean-Christophe de, Jésus selon Pascal, Paris, Desclée, 2008, p. 151 sq., sur la grandeur et la puissance du Verbe de Dieu.
Sur la notion de gloire, appliquée à Dieu, voir l’article de Bouyer Louis, Dictionnaire théologique, p. 278-282. Voir aussi les articles Justice, p. 365-367, et Jugement, p. 363-364.
Voir le dossier sur Jésus-Christ dans la présente édition.
L’évangile de saint Jean permet de comprendre l’idée des deux aspects de la figure du Christ.
Saint Jean écrit en effet, V, 22 : « Le Père ne juge personne ; mais il a donné tout pouvoir de juger au Fils ; ». « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils ».
Jean, III, 19 : « Le sujet de cette condamnation est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière ; parce que leurs œuvres étaient mauvaises ».
Jean, III, 17. « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui ».
Commentaire de Port-Royal sur ce dernier passage : « Dieu aurait pu envoyer son Fils dans le monde pour juger le monde : et alors quelle frayeur auraient eu les hommes, de voir parmi eux leur propre juge armé de tous les traits différents de sa justice pour les punir ? Mais il ne l’a envoyé dans le monde, qu’afin de sauver le monde : ce qui nous engage à une éternelle reconnaissance ». La suite montre comment la loi de Moïse ne servait qu’à condamner, alors que celle du Christ est destinée à sauver les hommes.
♦ Une « nouvelle » pensée de Pascal
par Laurent Thirouin, Marie Pérouse et Gilles Proust (UMR 5037) (nous proposons les notes entre crochets droits)
« Procédant à la comparaison d’une édition des Pensées de 1670 avec l'édition Sellier, dans le cadre d’un projet d’édition électronique des Pensées, Gilles Proust, ingénieur de recherche informaticien au C.E.R.H.A.C. (UMR 5037), a remarqué que la première édition des Pensées, habituellement désignée comme l’édition de Port-Royal, donne le fragment suivant comme un écrit de Pascal : [Pensées de M. Pascal sur la Religion et sur quelques autres sujets, fac-similé de l’édition de Port-Royal (1670) et de ses compléments (1678-1776), présentée par G. Couton et J. Jehasse, Saint-Étienne : Centre interuniversitaire d’éditions et de rééditions, 1971 ; p. 125]
![]() Quand il est parlé du Messie, comme grand & glorieux, il est visible que c’est pour juger le monde, & non pour le racheter.
Quand il est parlé du Messie, comme grand & glorieux, il est visible que c’est pour juger le monde, & non pour le racheter.
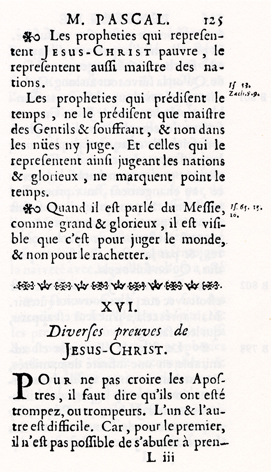
Or ce texte ne figure dans aucune des éditions modernes des Pensées. Les grands éditeurs du XIXe siècle ne le connaissent pas. Ni Brunschvicg ni Lafuma, dans l’Intégrale (1963), dans l’édition du Luxembourg (1951) et dans Le Manuscrit des Pensées de Pascal (1962), ne le donnent comme texte de Pascal. Brunschvicg signale en note, à propos de la pensée « Les prophéties qui prédisent le temps ne le prédisent que maître des Gentils, et souffrant, et non dans les nuées, ni juge. Et celles qui le représentent ainsi, jugeant et glorieux, ne marquent point le temps » :
Port-Royal publie à la suite de cette remarque la réflexion suivante : Quand il est parlé du Messie comme grand et glorieux, il est visible que c’est pour juger le monde et non pour le racheter. Elle a été incorporée au texte de Pascal par tous les éditeurs, sauf M. Molinier ; mais ni le manuscrit ni les Copies n’en portent trace. [Br. 727, page 187 de la section XI, en note 5]
Lafuma signale seulement dans les notes de l’édition du Luxembourg, p. 91, que « l’édition de Port-Royal complète ainsi [...] » [Dans un article sur les éditions de Port-Royal dans Les Pensées de Pascal ont trois cents ans, Thérèse Goyet propose une concordance entre les incipits de l’édition de 1670 et les éditions Lafuma Luxembourg et Brunschvicg. À la page 53, Th. Goyet signale au n°138 l’article concerné et donne en référence à l’édition Brunschvicg « 727n, p. 674 » sans référence à Lafuma Luxembourg]. Ce fragment a donc disparu du canon pascalien depuis que la suspicion a frappé le travail originel de Port-Royal et que les exigences philologiques inaugurées en 1842 par Victor Cousin ont imposé la référence au manuscrit autographe.
Ce texte n’apparaît pas dans le Recueil original (ms 9202). C’est le cas certes d’un bon nombre d’autres pensées, dont l’authenticité n’a jamais été mise en question, et que l’on ne connaît que par les deux copies prises à la mort de Pascal. Mais cette brève remarque consacrée au Messie n’a pas davantage d’existence dans l’une ou l’autre des copies. Sommes-nous donc en face d’un texte authentique de Pascal ? A-t-on eu raison de l’écarter ? Faudrait-il au contraire lui redonner une place (et un numéro) dans l’accumulation de notes, plus ou moins rédigées, que sont dorénavant les éditions scientifiques des Pensées de Pascal ?
Il est connu que l’édition de Port-Royal n’a pas été gouvernée par un souci prédominant de respect philologique. Le comité a dû transiger entre un idéal de fidélité rigoureuse et la nécessité de donner à lire une œuvre accessible, selon les critères esthétiques et intellectuels du temps — d’où le nombre important d’interventions et de remaniements, qui échappent totalement aux principes modernes d’une édition. Il n’y a donc pas lieu, a priori, d’accorder une trop grande importance au texte de Port-Royal, du moins quand il s’agit d’éditer les Pensées. On remarquera cependant que les éditions modernes des Pensées ont accueilli quelques fragments qui ne nous sont connus par aucun autre canal. C’est le cas de Sellier 739, et surtout du célèbre fragment 740, constamment cité et que Brunschvicg avait même intégré dans sa section initiale des Pensées (n°19) :
La dernière chose qu’on trouve en faisant un ouvrage, est de sçavoir celle qu’il faut mettre la première. [Éd. 1678, p. 336]
Peut-être ces textes ont-ils davantage retenu l’attention de la critique, en ce qu’ils figurent dans l’édition augmentée, donnée par Port-Royal en 1678. On a soigneusement relevé tous les textes nouveaux par rapport à la première édition, et l’on a naturellement identifié les hapax. L’absence d’attestation en dehors de l’ouvrage imprimé n’a pas empêché qu’ils ne prennent place dorénavant dans le canon pascalien, sans qu’aucun doute ne soit émis sur leur authenticité. Pourquoi en irait-il autrement du fragment sur le Messie ?
Ce texte conclut le chapitre XV, intitulé « Preuves de Jésus-Christ par les prophéties ». Il est précédé, à gauche, d’un fleuron, et accompagné, dans la marge de droite, d’une référence à Isaïe : Is. 65.15.16. Chacun de ces éléments est significatif.
L’étude minutieuse que Marie Pérouse (G.R.A.C., UMR 5037) a consacrée à l’édition de Port-Royal [«Voilà quel était son dessein.» Les premières éditions des Pensées de Pascal (1670-1678). Thèse à soutenir en décembre 2005] a mis en évidence la fonction exacte du recours aux fleurons, et les latitudes que s’autorisaient les éditeurs par rapport à leurs propres principes. Sans qu’il soit possible ici de résumer la démonstration dans toute sa richesse, il suffira d’en donner les conclusions. L'édition originale explique la raison d'être des fleurons qui précèdent les « pensées » :
[...] quoy qu’il soit assez facile, en lisant chaque article, de juger s’il est une suitte de ce qui le precede, ou s’il contient une nouvelle pensée ; neanmoins on a crû que pour les distinguer davantage il estoit bon d’y faire quelque marque particuliere. Ainsi lors que l’on verra au commencement de quelque article cette marque (![]() ) cela veut dire qu’il y a dans cet article une nouvelle pensée qui n’est point une suitte de la precedente, & qui en est entierement separée. Et l’on connoistra par mesme moyen que les articles qui n’auroient point cette marque, ne composent qu’un mesme discours [...] (P-R 1670 2e éd., « Avertissement ».)
) cela veut dire qu’il y a dans cet article une nouvelle pensée qui n’est point une suitte de la precedente, & qui en est entierement separée. Et l’on connoistra par mesme moyen que les articles qui n’auroient point cette marque, ne composent qu’un mesme discours [...] (P-R 1670 2e éd., « Avertissement ».)
Ce principe exprimé qui consiste à accompagner d’un fleuron chaque pensée distincte de Pascal retenue par le comité, est appliqué dans le livre avec une certaine souplesse. Cependant, il est une liberté que le comité ne prend à aucun moment : celle de faire précéder par un fleuron un texte rédigé par lui (pour compléter un fragment lacunaire ou pour servir de transition entre deux fragments, ou encore d’introduction à un chapitre) [Lorsque ce type de texte apparaît en début de paragraphe, il n’est introduit par aucun signe typographique particulier. Par exemple, chap. XXVI, p. 213 : Ainsi les divertissements qui font le bonheur des hommes…]. Par conséquent, dans la mesure où le texte qui nous intéresse comporte un fleuron, on peut a priori exclure qu’il s’agisse d’un commentaire rédigé par le comité. À moins, bien entendu, que ce signe typographique ne résulte d’une erreur d’impression, ou d’une inattention.
La fréquentation attentive de l’édition originale de 1670 conduit à écarter cette dernière hypothèse. Les chapitres du livre obéissent en effet à des principes de dispositio plus ou moins rigoureux d’un chapitre à l’autre, parmi lesquels on compte ce qu’il faudrait appeler les « effets de clôture » : les textes choisis pour achever chacun des chapitres sont retenus pour leur expressivité, et l’on imagine mal que le comité ait décidé de faire occuper ce lieu stratégique qu’est une conclusion de chapitre par une imitation de fragment pascalien. Du reste, tous les autres chapitres sans exception, se terminent par une pensée tirée d’un fragment authentique [Même si, dans deux cas, le texte pascalien se trouve altéré ou augmenté de façon notable : à la fin du chapitre XXVI, un long commentaire est ajouté au fragment Sel. 166, et, à partir de 1678, le chapitre II se termine par une version développée du fragment Sel. 717]. Les principes internes du volume, non seulement plaident pour l’authenticité pascalienne du fragment, mais incitent même à le regarder avec une particulière attention, comme une réflexion synthétique et forte.
La référence marginale au livre d’Isaïe pose d’autre part un problème. Les versets indiqués évoquent la conversion des gentils et l’instauration d’une nouvelle alliance, autant de considérations qui ne concernent pas explicitement la figure du Messie. La référence à Isaïe prend en revanche tout son sens, quand on consulte les mêmes versets - 15 et 16 - mais au chapitre suivant et dernier, le chapitre 66. Le prophète y annonce en effet, sur un mode apocalyptique, le retour ultime du Seigneur, dans la gloire suprême (« dans les feux ») et avec la fureur du justicier (« pour juger toute chair ») [« Car le Seigneur va paraître dans les feux, et son char viendra fondre comme la tempête, pour répandre son indignation et sa fureur, et pour exercer sa vengeance au milieu des flammes. / Le Seigneur viendra environné de feux, et armé de son glaive pour juger toute chair. Le nombre de ceux que le Seigneur tuera se multipliera à l’infini. » (Isaïe LXVI, 15-16, trad. Le Maistre de Sacy.]). Le texte biblique illustre exactement la pensée qui nous occupe, présentant la figure d’un Messie glorieux et étranger au souci de racheter le monde. Si le comité s’était donné la peine de forger cette remarque, n’eût-il pas été précis quant à la référence ? Il est plus probable que le texte de Pascal ait été mal lu, et sa référence scripturaire transcrite sans vérification.
Quel est donc le propos de Pascal et en quoi cette dernière remarque sur le Messie glorieux se rattache-t-elle à une démonstration plus large, dont elle est même susceptible d’assurer la conclusion ? Pascal veut prouver que les prophéties messianiques trouvent bien leur accomplissement en Jésus-Christ, que le Messie est bien venu en la personne de Jésus-Christ (Sel. 305). Pour être pleinement probante, la démonstration doit se faire selon les deux critères que sont 1) le temps (le moment de cet avènement) et 2) la manière (la forme de cet avènement). L’un est plus flagrant que l’autre, celui du temps : par un examen assez technique des prophéties, l’apologiste se fait fort de montrer comment la naissance de Jésus survient précisément à la seule date qui puisse concilier toutes les conditions annoncées par les prophètes, faisant converger « quatre repères chronologiques autonomes » [La formule est celle de Gérard Ferreyrolles, en note du fragment Sel. 367]. L’autre critère en revanche, celui de la manière, se révèle plus problématique. Il heurte davantage l’interprétation des prophètes, et notamment l’attente suscitée par eux chez les Juifs. Comment pourrait-on concevoir que la naissance obscure, la prédication discrète et la mort déshonorante de Jésus accomplissent les annonces du Messie ? À les prendre dans leur sens obvie, les prophéties ne semblent guère autoriser la foi des Chrétiens.
Pascal répond à cette difficulté de plusieurs façons. Il souligne en premier lieu que l’humilité et la souffrance du Messie ont bel et bien fait l’objet de certaines prophéties : qu’il devait être « rejeté, méconnu, trahi » (fr. 734) et qu’ainsi son obscurité ne fait que donner une marque supplémentaire de sa véritable nature. Un second argument consiste en une spiritualisation des notions de bien, d’ennemi, de domination… C’est l’idée, très insistante dans les Pensées, d’une loi figurative et d’une écriture chiffrée. L’Évangile nous apprend à lire les prophéties dans leur authentique signification : « que les ennemis de l’homme sont ses passions, que le rédempteur serait spirituel et son règne spirituel » (fr. 291). Mais ce qui achève la démonstration est la thèse d’un double avènement [La formule est omniprésente dans les Pensées : fr. 273, 285, 291, 292, 305…], la distinction entre deux manifestations du Messie : un avènement de misère et un avènement de gloire, une naissance obscure et un retour glorieux. Cette double face du Messie, humilié et triomphal, correspond à sa double action, de sauveur et de juge. La mort dans la souffrance et la gloire sont indissociablement réunies dans une seule figure, annoncée par les prophètes sous cette forme contradictoire, et manifestée selon une double temporalité. La pensée oubliée, qui concluait le chapitre XV de l’édition de Port-Royal, affirme solennellement le caractère glorieux du Messie, dès lors qu’il n’est plus considéré dans son rôle de sauveur (celui qui rachète), mais de juge.
On signalera enfin, avec toutes les précautions qu’un tel argument suppose, combien la syntaxe et le lexique de notre texte présentent des traits pascaliens. La même tournure impersonnelle - « il est parlé » - apparaît à plusieurs reprises dans d’autres fragments, toujours dans un contexte de commentaire des prophéties [Fr. 303 : « il est parlé de Dieu » ; fr. 309 : « la sagesse dont il est parlé » ; fr. 478 : « Il est parlé dans le II Paralipomènes… »]. L’adjectif visible surtout, avec sa quarantaine d’occurrences (dont six en structure impersonnelle : « il est visible que »), et l’adverbe visiblement sont presque des tics de l’auteur des Pensées. L’adverbe a un sémantisme fort sous la plume de Pascal ; il sert à indiquer qu’un jugement possède un haut degré de certitude [Fr. 513 : « L’homme est visiblement fait pour penser. » ; fr. 736 : « C’est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie : Isaïe XLII, 9… »]. Visible(s) et visiblement apparaissent très souvent dans des fragments qui proposent des interprétations de l’Écriture : est « visible » ce qui est « lisible » de façon non discutable, avec les yeux de la raison ; c’est le cas ici.
Il y a quelque chose de cocasse à découvrir aujourd’hui une nouvelle pensée de Pascal… dans le recueil des Pensées ! Cette bizarrerie s’explique par l’histoire peu commune de cette œuvre. Pendant plus d’un siècle, on a lu le recueil de 1670 comme émanant de Pascal. Voltaire n’a jamais eu lieu de s’interroger sur l’exacte authenticité des textes qu’il commentait dans les Lettres anglaises (et il n’a pas manqué, de fait, de porter le fer contre des expressions parfaitement étrangères à la plume de Pascal). Aujourd’hui, on met en doute toute formule qui ne serait pas validée par le manuscrit autographe ou par les copies. Mais il restait une importante pensée de Pascal, insoupçonnée, dans ce volume de 1670, si souvent manié. L’ironie du sort permet de tirer la leçon de cette affaire, en concluant avec les mots mêmes de notre auteur : [De l’esprit géométrique, in : Pascal, Œuvres complètes, éd. Jean Mesnard, t. III, p. 427]
Rien n’est plus commun que les bonnes choses : il n’est question que de les discerner ; et il est certain qu’elles sont toutes naturelles et à notre portée, et même connues de tout le monde. Mais on ne sait pas les distinguer. »
♦ Sur une « nouvelle pensée » de Pascal, authentique ou fabriquée ?
par Jean Mesnard (nous proposons les notes entre crochets droits)
« Il n'y a que Pascal pour se prêter à pareil scoop. Trouver dans l'édition originale des Pensées un fragment que rien ne permet de distinguer des autres, ni le contenu, ni la présentation, ni la typographie, et qui se retrouve à la même place, en fin du chapitre XV, Preuves de Jésus-Christ par les prophéties, dans toutes les éditions dites de Port-Royal, c'est-à-dire jusqu'aux deux tiers du XVIIIe siècle, pour être pratiquement oublié ensuite, et prendre aujourd'hui un air de nouveauté : voilà de quoi provoquer une belle surprise. Si l’on songe que, pendant cette période d’oubli, se sont multipliés les travaux savants et se sont découvertes dans les manuscrits des dizaines de pensées réellement nouvelles, le paradoxe créé par ce contraste est bien fait pour combler d'aise quiconque s'est engagé un peu à fond dans l'exégèse des écrits de Pascal et a commencé à faire le compte de tous les pièges qui n'ont cessé de le guetter. En voilà un dont il convient de prendre l'exacte mesure.
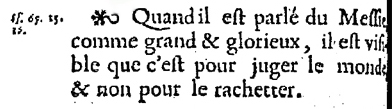
Saluons d'abord la découverte elle-même, et son auteur, Gilles Proust. Son évidence aurait dû s'imposer depuis longtemps. Mais le souci d'exactitude nécessaire à l'éditeur des Pensées a souvent été défaillant. Saluons aussi ceux qui ont interprété cette donnée dite nouvelle, Marie Pérouse et Laurent Thirouin : ils ont fait preuve d'une extrême ingéniosité et leur argumentation est très forte. Qu'ils me permettent cependant, au départ, deux petites critiques [Il convient de se reporter à l'article, sous triple signature, “Une « nouvelle pensée » de Pascal”, Courrier du Centre international Blaise Pascal, 27/2005, p. 3-6.].
La « pensée nouvelle » dont ils ont défendu l'authenticité apparaît dès l'originale des Pensées - et même dès la préoriginale de 1669 ; mais laissons de côté ce dernier raffinement. Notons seulement qu'ils ont pris pour référence la « seconde édition » - en fait, la troisième -, qui, pour porter la même date de 1670, n'en diffère pas moins sensiblement de l'originale : la page 126 de cette dernière est devenue 125 de l'autre, et il y a eu recomposition, glissement des références bibliques de la gauche vers la droite du texte, et addition du début du chapitre suivant. Cette négligence est l'effet d'une autre, imputable à Georges Couton et Jean Jehasse, lorsque, ayant eu l'heureuse idée de procurer un reprint de l'originale des Pensées [Signalé ibid., p. 3, n. 1], ils ont choisi, pour des raisons de commodité, cette seconde édition, choix que, en son temps (1971), j'ai amicalement, mais vigoureusement reproché à Georges Couton. Mettons quand même les choses au point : l'argumentation de Marie Pérouse et Laurent Thirouin n'est nullement atteinte par cette critique. Mais il vaut la peine de présenter ici un reprint de la page (126) originale, pour comparaison avec la page (125) incluse dans leur article.
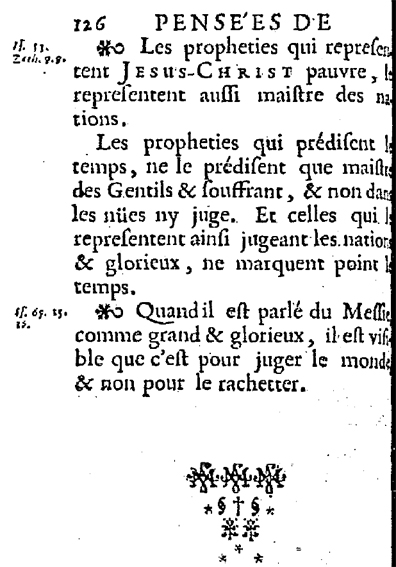
On regrette aussi l'absence d'une recherche précise, malheureusement très délicate, sur les circonstances dans lesquelles la pensée qui nous intéresse a disparu des éditions. Le scénario posé au départ de la présente étude, et qui reflète le point de vue implicite des « inventeurs » de la pensée, résistera-t-il à une enquête plus exigeante ? Selon ce scénario, comme on l'a vu, la pensée se serait effacée avec la fin de l'édition de Port-Royal. Or la situation est, en fait, beaucoup plus complexe. Impossible d’y voir clair sans une confrontation générale des éditions par laquelle doit nécessairement s’amorcer la recherche originale qu’il convient maintenant d’entreprendre.
L’odyssée de la « nouvelle pensée »
[Pour cette partie de l'étude, se reporter à Albert Maire, Bibliographie générale des Œuvres de Blaise Pascal, t. IV, Pascal philosophe, Paris, Giraud-Badin, 1926, notamment p. 131-150 ; Louis Lafuma, Histoire des Pensées de Pascal (1656-1952), Paris, éd. du Luxembourg, 1954 ; et mon article “L'Original des Pensées de Pascal avant et après Victor Cousin”, Le Manuscrit littéraire, Travaux de littérature publiés par l'A.D.I.R.E.L., t. XI, 1998, p. 121-149.]
La première étape qu’il y a lieu de bien marquer est celle de l’édition de Port-Royal. Son unité est saisissante, tout au long d’un siècle où aucun lecteur - même, par exemple, Voltaire - n’a pu se soustraire à son empire. Aucune différence notable, tant pour le texte que pour l’ordonnance, ne distingue les exemplaires pourvus de la marque authentique des trois Guillaume Desprez, père, fils et petit-fils, qui se succédèrent à la tête de la librairie portant leur nom, de ceux qui ne peuvent correspondre qu’à des contrefaçons et de ceux qui sont sortis des presses hollandaises, principalement celles des Elzevier. Le seul tournant véritable dans l’histoire de l’édition a été pris sur l’initiative du premier Guillaume Desprez, évidemment en accord avec les héritiers de Pascal, lorsqu’il a décidé de publier une « nouvelle édition » de l’ouvrage, une sorte de nouvelle originale, en 1678. De quelle nouveauté s’agissait-il exactement ? Nullement de suppressions, de retouches ou de regroupements dans les pensées constitutives de l’originale. Tout le contenu de celle-ci se retrouve dans la nouvelle, suivant le même ordre et sous les mêmes titres de chapitres. L’élément le plus proprement nouveau consistait dans l’adjonction de fragments inédits, lesquels venaient s’insérer, selon les sujets abordés, dans le cours des chapitres déjà existants, pour les enrichir sans les bouleverser. C’est ainsi qu’un fragment nouveau est glissé dans le chapitre XV, terminé, comme l’on sait, par la « nouvelle pensée » qui retient notre attention, et que l’on retrouve telle quelle à la même place. Peut-être ne faut-il pas faire fi d’une autre nouveauté, en dépit de son caractère purement pratique. À partir de 1678, les fragments, dont l’unité n’était rendue sensible auparavant que par l’impression, à la première ligne de chacun d’eux, d’une vignette typographique représentant une fleur de bluet, furent pourvus chacun d’un numéro, suivi d’ailleurs immédiatement du même bluet. Numérotation continue à l’intérieur d’un chapitre donné, mais reprenant à chacun des chapitres successifs, eux-mêmes numérotés depuis le temps de l’originale. Voilà qui permettait des références beaucoup plus simples et efficaces que les renvois aux pages, et facilitait la lecture raisonnée et le dialogue entre lecteurs. Dans le chapitre XV qui nous occupe, il est aisé de désigner le fragment apparu en 1678 par le numéro 12 qui lui a été donné. On notera d’ailleurs qu’il renferme deux paragraphes sous ce même numéro, ce qui montre le souci de distinguer fragment et paragraphe. Distinction qui, dès l’originale, avait déterminé le recours à la marque du bluet pour signaler tout fragment nouveau, comme il est bien spécifié dans l’Avertissement initial [Ce point a été bien mis en valeur dans l’article cité n. 1, p. 4]. Quant au fragment final du chapitre, c’est-à-dire la fameuse « nouvelle pensée », il ne comporte qu’un paragraphe et est numéroté 17. Cette numérotation, dont on n’oubliera pas cependant qu’elle est absente de l’originale, nous sera d’un grand secours à l’avenir pour simplifier la mise en forme de nos raisonnements [Inutile de s’arrêter ici aux pensées inédites publiées en 1727 par l’évêque Colbert de Montpellier et en 1728 par le P. Desmolets. Leur considération ne saurait rien apporter à notre enquête].
L’histoire de l’édition de Port-Royal ne peut plus désormais nous apporter aucun enseignement si ce n’est celui qui se tire de sa disparition. Celle-ci fut entraînée par l’extinction du privilège qui était alors détenu par Guillaume Desprez le petit-fils. Le dernier qu'il ait obtenu, inséré en 1761 dans la dernière édition des Pensées publiée sous son nom, était valable pour six ans, et prenait donc fin en 1767 [Louis Lafuma, Controverses pascaliennes, Paris, éd. du Luxembourg, 1952, p. 136, n. 1]. Parallèlement une dernière édition hollandaise voyait le jour en 1774. Absence de privilège, absence de concurrence : le champ était libre pour de nouveaux éditeurs, auxquels on peut d’ailleurs prêter avec quelque vraisemblance des démarches en chancellerie pour empêcher le renouvellement du privilège de Desprez. C’est à leur rencontre qu’il convient désormais de se rendre. Avec eux, qu’advient-il, en particulier, de la « nouvelle pensée » ?
Entre la mise sur la touche de Desprez par l’extinction de son privilège et l’entrée en scène de Victor Cousin (1842), c’est-à-dire pendant près de trois quarts de siècle, trois éditeurs des Pensées ont principalement compté, d’abord par leur notoriété, puis par les options auxquelles ils se sont arrêtés, et qui ont eu leur incidence sur le destin de la « nouvelle pensée ». Ce sont le philosophe Condorcet (1776, puis deux fois en 1778), l’abbé Bossut, mathématicien réputé (1779, avec de nombreuses reprises anonymes, ou sous d’autres noms, jusqu’en 1844), enfin le libraire et érudit Renouard (1803, puis 1812) [Je laisse de côté, entre autres, parce qu’elles nous engageraient inutilement en d’autres problèmes, les éditions Ducreux (1780 et 1785)]. Par précaution, si tous ont publié leurs éditions en France, ils l'ont fait, surtout au début, sous des adresses étrangères fictives. Sous ce peu de noms, un bon nombre d’éditions ont, en fait, vu le jour.
Interrogeons-les donc, sans plus attendre, sur le sujet qui nous occupe. La « nouvelle pensée » y a-t-elle été retenue ?
La réponse sera différente selon les éditeurs. Elle est négative avec Condorcet ; positive avec Bossut et Renouard. Mais à quelles intentions, ou simplement à quels mécanismes attribuer ces diverses attitudes ?
Gardons-nous de prêter nos rigueurs philologiques à des esprits dont tout prouve, dans leur œuvre pascalienne, qu’ils n’en faisaient pas grand cas. N’allons pas croire que Condorcet a pris parti contre l’authenticité du fragment, tandis que Bossut et Renouard se prononçaient à l’inverse. C’était là le cadet de leurs soucis. En fait le seul dont l’édition ait été commandée par une véritable idée directrice a été Condorcet. Mais cette idée était philosophique : il s’agissait de prolonger la critique de Voltaire contre Pascal, et, tout en exaltant éventuellement le savant et le philosophe, de dénigrer le chrétien. D’où des coupes sombres pratiquées dans les pensées à contenu religieux et, notamment, biblique, placées d’ailleurs à la fin de son volume. Condorcet n’a que mépris pour l’argument prophétique. Des innombrables fragments que Pascal lui consacre, il ne conserve à peu près rien. Or c’est précisément à cette catégorie qu’appartenait la « nouvelle pensée ». Ne cherchons pas d’autre raison à sa suppression.
Suppression qui pouvait se faire avec d’autant moins de scrupules que Condorcet n’entendait nullement offrir une édition complète. À cet égard, Bossut et Renouard ont été un peu plus exigeants, mais en se résignant facilement à l’imperfection. Au fond, les trois éditeurs ont eu à la fois deux révélations contradictoires : d’une part, celle de l’ampleur et de la richesse inédite des manuscrits des Pensées, notamment de l’Original ; d’autre part, celle de l’extrême difficulté de leur exploitation. Tous ont tiré quelque chose, mais peu de chose, de l’Original. Par compensation, tous ont puisé sans vergogne dans l’édition de Port-Royal, appartenant désormais au domaine public. Ils n’en ont guère enrichi le contenu ; cherchant surtout la nouveauté dans une disposition des fragments dont la forme la plus précise est donnée par les deux parties de Bossut : d’un côté, Pensées qui se rapportent à la philosophie, à la morale et aux belles-lettres ; de l’autre, Pensées immédiatement relatives à la religion. Mais, à l’intérieur des cadres ainsi tracés, de vastes ensembles constitués dès l’édition de Port-Royal reparaissent souvent tels quels.
C’est ce qu’on constate en particulier, chez Bossut, avec l’article XI de sa Seconde Partie, « Preuves de Jésus-Christ par les prophéties ». Il y reprend intégralement, titre compris comme on vient de le voir, le chapitre XV de Port-Royal - évidemment d'après la « nouvelle édition » de 1678, modèle de toutes les suivantes, avec numérotation des fragments et addition d’un inédit. Outre le titre, il en conserve l'ordre de présentation, apportant comme seule nouveauté une numérotation propre, qui n’est pas sans créer des ambiguïtés. On sait que la « nouvelle pensée » apparaissait précisément au terme de ce chapitre XV (n°17 de 1678). Avec la reprise de Bossut, elle garde cette place finale, mais elle perd son caractère autonome. Elle se fond dans un ensemble de fragments numéroté V, correspondant aux nos 13 à 17 de 1678. Les fragments anciens ne sont plus distingués que par le passage à la ligne, désormais employé identiquement que le changement marqué porte sur un paragraphe ou sur un fragment. Le n°17 semble alors se donner pour la suite et la fin du n°16, dont il était rigoureusement séparé dans toutes les éditions de Port-Royal. Son interprétation n’en est pas facilitée ; au contraire. Pour bien comprendre les rares commentaires dont la « nouvelle pensée » fait l’objet aux XIXe et XXe siècles, il importera de savoir si leurs auteurs ont sous les yeux Port-Royal ou Bossut. Reste que le fragment est bel et bien présent chez ce dernier, sans que sa provenance y fasse l'objet d'aucune explication, à plus forte raison d'aucun doute. L’éditeur s’est manifestement fié à Port-Royal, sans se poser aucune question.
Nul progrès sur ce chapitre avec Renouard, qui reconnaît d'ailleurs toute sa dette à l'égard de Bossut, en dépit d'une grande admiration professée pour Condorcet et de quelques emprunts effectués, sur d'autres sujets, au manuscrit original. L'article XI de Bossut s'y retrouve donc identique, avec le même fragment terminal. Certes Condorcet garde ses fervents ; mais le texte de Bossut, comme le prouve l'exemple de Renouard, qui possédait l’autorité d’un bibliophile averti, faisait loi pour l'édition des Pensées. Il devient le texte standard, qu'il ne paraît plus nécessaire de rattacher à un auteur précis. Il en ira ainsi, comme on l’a vu, jusqu'en 1844. Au cours de cette longue période, aussi bien, d'ailleurs, qu'auparavant, le fragment qui nous intéresse est donc passé sous de multiples yeux sans attirer la moindre attention, sans même être enregistré dans la mémoire des lecteurs. Comme si l'oubli avait coïncidé avec sa naissance. Comme s'il avait été refusé, quasi inconsciemment, à Pascal avant même que l'idée d'une critique possible eût surgi.
Cette critique trouve son origine indirecte dans le fracassant Rapport à l'Académie française de Victor Cousin (1842). Pour la première fois, peut-être, mais non la dernière, l'interprétation de l'œuvre de Pascal et notamment des Pensées était remise en question de fond en comble. Deux éditions successives de l'œuvre, toutes les deux reçues avec le plus grand succès, s'étaient auparavant partagé les faveurs du public pendant plus d'un siècle et demi : celle de Port-Royal et celle de Bossut. Or un examen attentif faisait ressortir d'une façon flagrante, dans l'une et dans l'autre, par comparaison avec les sources manuscrites et notamment avec l'Original des Pensées, deux défauts que les progrès des sciences historiques rendaient insupportables : de graves inexactitudes dans la transcription et l'établissement du texte ; de nombreuses omissions portant sur des fragments du plus haut intérêt. La disqualification du savoir prétendument acquis est devenue tellement profonde que des règles de critique très sévères se sont imposées désormais sans résistance : le texte des Pensées devait se fonder sur le manuscrit original, rigoureusement transcrit et intégralement respecté, avec le complément éventuel d'autres manuscrits, notamment des deux Copies anciennes des originaux, puisqu'elles comportent des inédits ; mais non sans beaucoup de réserves pour tous les manuscrits d’origine marginale. Les imprimés des XVIIe et XVIIIe siècles étaient désormais considérés à peu près comme nuls et non avenus. Ils ne pouvaient, en principe, valoir comme sources. Nul besoin presque d'inventorier leur contenu. Le principe d'authentification étant fourni par les manuscrits, tout fragment connu seulement par les imprimés se trouvait frappé de suspicion et devait fournir ses preuves. Pour quiconque aurait quand même prêté attention au fragment unique en son genre achevant le chapitre XV de Port-Royal et l'article II, XI, de Bossut, la tendance naturelle était de le considérer comme inauthentique.
L'attitude des nouveaux éditeurs a pourtant été plus diverse. Certes le parti de Victor Cousin a été embrassé vigoureusement par le premier des nouveaux éditeurs, Prosper Faugère (1844). Chez lui, la pensée litigieuse est purement et simplement supprimée ; son existence antérieure n’est même pas signalée. Cette pratique sera aussi, dans la quasi-totalité des cas, celle des innombrables éditeurs qui ont paru ensuite jusqu’à nos jours. L’un d’eux, et non des moindres puisqu’il s’agit d’Ernest Havet, fait toutefois remarquablement exception. Quoique fidèle à Victor Cousin, il reste très impressionné par Bossut, dont il s’inspire notamment pour son plan. Il ne peut donc se résigner à passer tout à fait sous silence cette pensée qu’il trouvait chez son modèle, quoiqu’il la sût bien absente des manuscrits. Dans la plus ancienne de ses éditions (1852), il évite d’avoir à se prononcer en adoptant une solution moyenne. Il élimine la pensée (n°17 de 1678) du corps du texte, retenant seulement celle qui la précède (n°16 de 1678) ; mais il la mentionne en note [Art. XVIII, n°5, p. 246, n. 1. C’est Laurent Thirouin qui m’a très aimablement signalé cette curieuse particularité de l’édition Havet originale ; le commentaire relève toutefois de ma seule responsabilité]. Cependant tout se passe comme s’il avait éprouvé un remords en préparant sa seconde édition, sensiblement remaniée, en 1866. Avec cette dernière, le n°17 est rétabli dans le corps du texte, à la suite du n°16 [Art. XVIII, n°14, t. II, p. 26]. On retrouve, du moins pour un court passage, la disposition de Bossut, reflet médiocre de celle de Port-Royal. En somme, quoique informé par les travaux de Victor Cousin et de Faugère, Havet deuxième manière n’a pas hésité à juxtaposer deux fragments d'origine et de statut très différents, qu’il avait d’ailleurs trouvés enclavés ensemble dans la série plus ample de ses sources. Est-ce par gêne qu’il a mis entre parenthèses ces deux fragments, en les faisant précéder d’un troisième puisé ailleurs ? Toujours est-il qu’il ne s’explique aucunement sur les motifs qui l’ont guidé, s’abstenant même de faire remarquer son changement d’attitude depuis sa première édition. La troisième dont il ait pris la charge, celle de 1881, n’apporte aucun changement sur ce point à la seconde ; et il en ira de même par la suite. Voilà qui signale le poids des difficultés rencontrées par celui des éditeurs qui s’est sans doute appliqué le plus sérieusement - mais en vain - à la solution du problème qui nous arrête encore.
Si l’hésitation a marqué l’entreprise d’Havet, elle n’a pas été moins présente chez Brunschvicg. Mais l’évolution s’est faite en sens opposé. Au fond, le nouvel éditeur a commencé par prendre acte des conclusions auxquelles, depuis 1866, était parvenu le plus important de ses prédécesseurs. Dans ses deux premières petites éditions (1897, 1900) [Au n°727, p. 674], il a donc inséré à son tour, à la suite du n°16 de 1678, le n°17 litigieux. C'est en préparant sa grande édition (1904 [T. III, p. 187, n. 5]), qu’il s’est rangé à l’avis de Victor Cousin et de Faugère [T. II, Paris, Andrieux, p. 279], repris et renforcé par Molinier (t. I, 1877), et qu’il a exclu le fragment 17 de son nouveau texte, le transportant en note, avec quelques explications, d’ailleurs insuffisantes. Ce texte, avec des explications simplifiées, à la même date de 1904, fut étendu définitivement à la petite édition [3e éd., p. 674, n. 1].
Le succès de l’édition Brunschvicg contribua pour beaucoup à l’imposer. On observera cependant que le texte de Port-Royal et de Bossut, continuait à figurer dans les rééditions d’Havet, par exemple dans la huitième, parue en 1925 [Même pagination qu’en 1866 et 1881]. Contrairement à ce qu'on a pu supposer, la tradition favorable à l'insertion du fragment unique en son genre n'a donc jamais été tout à fait abandonnée.
Pourtant un nouveau coup lui avait été porté par un éditeur assez négligé, mais qu’il convient ici de prendre en considération comme appartenant de façon privilégiée à la tradition de Port-Royal, Augustin Gazier. L’édition qu’il procura en 1907 entendait suivre de très près celle de 1670, ou plutôt celle de 1678, avec toutefois rétablissement du texte authentique des manuscrits et adjonction des fragments omis, mais en veillant à ne pas trop défigurer le modèle. Quelle fut donc sa conduite en face de la « nouvelle pensée », que lui imposait son texte de référence ? Il n’en souffla mot, mais il s’abstint de la publier [Voir son texte, Paris, S.F.I.L., p. 241]. Il donnait sa caution à Brunschvicg.
Il ne reste plus qu’une étape à franchir, où la tendance à la suppression semble ne plus susciter de résistance. Vers cette attitude ne pouvaient que porter les recherches inaugurées par Tourneur et amplement prolongées et précisées par Lafuma. Elles avaient montré à quel point l’édition des Pensées était tributaire d’une meilleure connaissance des manuscrits et quelles ressources offraient ceux-ci, notamment les deux Copies, pour une étude scientifique des célèbres fragments. Les libertés prises par les éditeurs de toutes époques avec la documentation dont ils disposaient les rendaient peu dignes de confiance : moins que jamais, leur œuvre ne pouvait faire autorité.
Lafuma fut toutefois le dernier, pour plus de cinquante ans, dans le texte annoté publié aux Éditions du Luxembourg (1951 [T. II, p. 91]), à citer de nouveau le fragment aberrant. Mais, suivant l’exemple de plusieurs de ses prédécesseurs, c’était dans une simple note, particulièrement laconique, et ne prononçant aucun jugement pour ou contre l’authenticité. Nouveau refus d’aborder une question qui pouvait sembler presque insoluble. C’est sans doute l’autorité grandissante reconnue aux manuscrits qui détermina les éditeurs de la fin du XXe siècle, jusqu’à Philippe Sellier (1976 et 1991) et Michel Le Guern (1977 et 2000), à sacrifier un fragment fourni par les seuls textes imprimés.
Mais rendre compte des comportements successifs adoptés par les éditeurs ne suffit pas à déterminer le degré de confiance que méritent leurs choix : choix dont on a vu qu'ils se répartissaient, d'une façon plus complexe qu'on ne pouvait le croire, soit en faveur de l'authenticité (dans la tradition issue de Port-Royal, avec un rebondissement dans la recherche toute récente), soit en sens contraire (dans la postérité de Victor Cousin, avec l'exception notable d'Havet).
L’histoire qui vient d’être retracée n’a donc pas levé les incertitudes de départ. Elle n’a pas livré de témoignage ni de signe permettant de faire reconnaître à la pensée en litige un statut objectif, en somme de lui assigner une origine. Aucun des éditeurs que nous avons rencontrés n’a fait de découverte ou conduit d’enquête susceptibles d’éclairer jusqu’au bout les problèmes qui nous avaient engagés à suivre leur piste. Quel bilan faut-il donc retenir de cette aventure ? Il est triple. Nous avons d’abord pris solidement possession d’un texte tellement méconnu qu’il peut passer pour l’équivalent d’un inédit. Inédit de Pascal ou relatif à Pascal ? Même si l’hésitation reste de mise, notre curiosité est avivée et le sujet, désormais, ne peut plus être éludé. De plus, nous avons pu mesurer le degré exact d’oubli dans lequel est tombée la « nouvelle pensée ». Au fond, elle a été beaucoup plus négligée qu’ignorée. Négligée même par ceux qui l’ont retenue dans leurs éditions, et qui jamais ne semblent lui avoir prêté grand intérêt. Or - et c’est là sans doute l’élément le plus positif du bilan - ce peu d’attention suscité par le contenu se trouve compensé par un puissant appel au commentaire critique. Le cas particulier que constitue notre texte est si bien imbriqué dans un vaste contexte qu’il doit être sans cesse débordé et que le regard doit s’élargir à l’ensemble des Pensées, considérées dans leur genèse comme dans leur histoire. L’invention de la « nouvelle pensée » a beau nous laisser jusqu’ici sur notre faim ; elle n’en est pas moins allée déjà bien au-delà de ce qu’elle promettait.
Le mystère de l’origine
Reste que notre curiosité principale n’est pas encore satisfaite. L’histoire n’ayant imposé aucune conclusion à ce sujet, nous voilà renvoyés à notre point de départ, c’est-à-dire à la page 126 de l’originale des Pensées. C’est sur cet unique document qu’il convient maintenant de s’appuyer. Il appelle une analyse directe, et très matérielle. Je m’engagerai donc sur la voie déjà suivie par Marie Pérouse et Laurent Thirouin, porteurs d'une argumentation favorable à l’authenticité. Sans considérer leurs raisons comme décisives, je les tiens pour fondées et je n'y reviens qu'à l'occasion. Je présenterai surtout des doutes, à partir de points de vue assez différents des leurs. C'est au lecteur que je réserverai le soin de conclure.
On ne saurait d'abord trop insister sur le caractère essentiel de la tradition manuscrite pour l'établissement du texte des Pensées. Infime est le nombre de fragments, quelle que soit leur date de publication, qui ne remonte à un manuscrit connu, original ou copie. Il n'en existait en fait jusqu'ici que deux pour lesquels un imprimé fût notre ultime source. Ils nous sont procurés par l'édition de Port-Royal, et leur authenticité n'a pas lieu d'être mise en doute [Voir l'article cité note 1, p. 4]. Est-ce à dire que notre possible inédit appartienne à la même catégorie ? En fait des différences capitales les séparent. Le dernier appartient à l'édition originale. Les deux autres ne sont apparus qu'à partir de l'édition de 1678. Or cette dernière a été préparée à Clermont, avec recours à des sources nouvelles, principalement la Seconde Copie, mais d'autres aussi. Au contraire, l'originale était restée constamment sur le chantier à Paris, entre 1666 et 1670. De plus, elle repose uniquement sur la Première Copie : à preuve, entre autres, la présence dans ce manuscrit de fragments retouchés des mains d'Arnauld et de Nicole qui sont passés dans l'édition avec ces retouches [Le fait est indiscutable, mais un relevé rigoureux demeure à faire]. Or le texte de notre pensée inédite, fait unique pour l'édition originale, est absent de la Première Copie, comme d’ailleurs de tout autre manuscrit. Peut-il dès lors être tenu pour authentique ?
Peut-être pourrait-on invoquer contre ce raisonnement l’un des arguments les plus brillants qu’aient déployés Marie Pérouse et Laurent Thirouin. On se souvient que les éditeurs de 1670, fidèlement suivis par ceux de 1678, ont expressément tenu à rendre sensible l’unité de chaque fragment indépendant trouvé dans les papiers de Pascal en le faisant précéder d’une vignette typographique en forme de bluet. Or, dans l’édition de Port-Royal, une telle vignette figure bien en tête du dernier fragment inclus dans le chapitre XV (n°17 de 1678), c’est-à-dire de la « nouvelle pensée ». Ainsi déclaré autonome, ce dernier fragment n’est-il pas, par la même occasion, reconnu comme étant de Pascal ?
Sans méconnaître la force de cet argument, on peut toutefois hésiter à s’y rendre. Il ne manque pas, dans les fragments publiés en 1670, de gloses introduites par les éditeurs. Pourquoi la glose ne se serait-elle pas une fois présentée sous la forme d’un fragment entier ? Si le bluet signale un fragment autonome, pourquoi serait-il toujours de Pascal ? Certes, selon toute apparence, l’exception créée par un texte entièrement fabriqué serait unique. Mais, si le fragment était authentique, ne serions-nous pas dans le cas non moins unique d’une pensée publiée sans avoir été puisée dans le corpus des manuscrits ? Les choses sont égales de part et d’autre. Nous en sommes presque réduits au pari.
L’argumentation à laquelle j’oppose ces réserves est toutefois soutenue en même temps par d’intéressantes analyses stylistiques. On retrouve dans la « nouvelle pensée » des habitudes de langage familières à Pascal. Ainsi l’expression « il est visible que », employée exactement de la même façon dans un fragment concernant les preuves de Jésus-Christ [Lafuma, n°593 ; Sellier, n°493. Il est remarquable que, si le fragment existe dans l’édition de Port-Royal (XVI, 9, de 1678), la formule en a été soustraite. Voir aussi Laf. 746 ; Sell. 619 ; et Laf. 844 ; Sell. 427 : deux fragments absents de Port-Royal]. Si le fragment était tenu pour supposer, il faudrait alors admettre, de la part des éditeurs, sinon un dessein de pasticher Pascal, du moins, plus qu’une imprégnation, le souci de garder une certaine couleur pascalienne à leurs gloses mêmes. Une telle intention ne leur a jamais été prêtée. Est-ce à dire qu’il faille absolument l’exclure ?
Pour aller plus au fond des choses, tant sur la portée des bluets que sur celle des faits de style, arrêtons-nous à deux exemples de fragments glosés avec lesquels Marie Pérouse et Laurent Thirouin ont parfaitement compris la nécessité d’une confrontation [Article cité note 1, p. 4-5]. Le premier apparaît à la fin du chapitre XXVI, Misère de l’homme, (n° 4 de 1678 [Lafuma 133 ; Sellier 166]). Il roule sur le thème du divertissement et commence par un fragment authentique portant sur ce thème. Comme il se doit, il est précédé d’un bluet. Mais à ce premier fragment, relativement bref, s’enchaîne une suite, fort longue, étrangère aux manuscrits des Pensées, dont on peut se demander si elle ne serait pas aussi couverte par la valeur authentificatrice du bluet, au cas où celle-ci existerait réellement. Cette suite offre très clairement le double caractère d’une amplification et d’une explicitation. Le lien, en particulier, est très nettement - et très justement - établi entre le divertissement et l’ennui, alors qu’il n’est pas si aisément perceptible lorsqu’on s’en tient aux pensées authentiques. Cette suite porte un accent si pascalien que Brunschvicg, dans une note apparue dès l’originale de sa petite édition, et toujours reprise par la suite [Au n°168, p. 406, n. 1], réserve la possibilité, sans toutefois vraiment y croire, et sans avoir jamais été suivi, de l’attribuer à Pascal lui-même. Cet accent pascalien est principalement obtenu par l’emploi de tours familiers à l’auteur des Pensées, très semblables à celui de l’exemple précédemment analysé. Ainsi est-il dit, à propos des hommes séduits par le divertissement : « C’est tout ce qu’ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux ». On reconnaît : « Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux », qui appartient au grand fragment du divertissement, où Port-Royal le conserve d’ailleurs tel quel [Lafuma 136 ; Sellier 168 ; Port-Royal, 1678, XXVI, 1, p. 203]. C’est pour éviter un redoublement trop textuel que la reprise insérée dans la glose a fait l’objet de modifications. Plus loin, c’est encore une tournure très pascalienne que l’on trouve quand il est dit : « par un étrange renversement de la nature de l’homme ». On est là très proche d’une formule présente dans un fragment authentique, et retenu dans l’édition de Port-Royal : « Il faut qu’il y ait un étrange renversement dans la nature de l’homme pour [...] » [[Ibid., respectivement 427, p. 248 ; 681, p. 479 ; I, p. 12], ou, dans un fragment préparatoire à ce dernier : « marque d’un étrange renversement » [Ibid., respectivement 632 ; 525 ; absent de Port-Royal]. L’accumulation ainsi constatée rend plus que plausible la recherche d’une coloration pascalienne qui a déjà été suggérée.
Parallèlement à cette recherche d’accent, ou de coloration, on peut estimer aussi que les éditeurs de Port-Royal, lorsqu’ils entendaient se livrer à une glose, aimaient la concevoir un peu comme un centon, et emprunter à Pascal lui-même, dans toute la mesure du possible, les mots et les tours qui convenaient à leur propre texte. Ainsi la glose prolongeait l’édition.
Le second fragment glosé dont la confrontation a été appelée avec la « nouvelle pensée » n’apparaît qu’avec l’édition de 1678 (II, 16). Il n’obéit donc pas nécessairement à l’esprit qui inspirait les éditeurs de 1670. Aussi bien la glose n’y témoigne-t-elle pas de la même finesse que précédemment. Il s’agit d’une longue énumération de preuves de la religion chrétienne dont l’énoncé schématique était fourni par un texte assez bref des Copies [Lafuma 482. Sellier 717]. Nous découvrons là un modèle d’amplification beaucoup plus banal, et trop didactique, dans lequel il est bien difficile de dégager l’élément original du commentaire. Certes, on y retrouve, de place en place, des souvenirs de Pascal, mais sans couleur et qui n’offrent plus ce cachet d’authenticité qu’on a pu admirer ailleurs. Nul, au sujet de ce fragment, n’a jamais été menacé de se tromper d’auteur.
Quoi qu’il en soit, les deux fragments lourdement glosés présentent une particularité commune de grande importance. Dans les éditions de Port-Royal, ils figurent tous les deux en fin de chapitre, lieu propice à des considérations synthétiques, débordant éventuellement le texte des originaux. Or c’est aussi en fin de chapitre que se situait la « nouvelle pensée ». Cette position extrême n’est-elle pas à prendre en compte pour apprécier son authenticité ? N’est-elle pas propre à nous orienter vers une conclusion négative ?
Le moment est venu de nous attaquer enfin d’une façon directe à notre redoutable fragment, et de chercher dans son texte des raisons de l’attribuer ou bien à Pascal ou bien à ses éditeurs. Pour ce faire, il convient de porter sur lui deux regards successifs, en le considérant d’abord de l’intérieur, puis de l’extérieur.
Par le premier regard, nous essaierons de saisir le fragment dans son contenu et dans sa cohérence. Il soulève sur ce point une difficulté qui a été fort bien vue par Marie Pérouse et Laurent Thirouin [Art. cité n. 1, p. 5]. On peut y distinguer deux éléments : le texte, fort bref ; et une référence au prophète Isaïe portée en marge. Le texte déclare qu’une prophétie montrant le Messie glorieux ne peut concerner sa mission terrestre de Rédempteur (accomplie dans la pauvreté et la souffrance), mais son rôle de juge du monde (consacré à la fin des temps). Or la prophétie à laquelle s’applique la référence, et qui devrait fournir la preuve de l’affirmation précédente, introduit un tout autre sujet, celui de la substitution au peuple juif du peuple chrétien qui en prend la suite, en d’autres termes celui du passage de l’ancienne alliance à la nouvelle par l’œuvre du Christ. Comment rendre compte de cette étrangeté ? A-t-elle une incidence sur le statut de notre fragment ?
Pour les interprètes dont je viens d’accepter le point de départ, l’explication est simple. L’auteur du fragment aura commis une erreur de référence, ou bien son texte aura été mal déchiffré. Il n’est en effet que de substituer 66 à 65 comme numéro de chapitre, en conservant ceux des versets, pour tomber sur un passage d’Isaïe parfaitement adapté à l’idée exprimée dans le texte de la pensée. C’est en effet la gloire du Seigneur et sa qualité de juge du monde qui sont célébrées, avec une vigueur tout apocalyptique. Si cette hypothèse est juste, le poids d’une attribution à Pascal est singulièrement renforcé. On n’imaginerait pas que, dans un texte directement forgé pour l’édition, ait subsisté une erreur aussi grossière. En revanche, un écrit venu de Pascal n’était pas nécessairement soumis à vérification très poussée ; et d’ailleurs, la rédaction en ayant été souvent improvisée, des négligences auraient aisément pu s’y glisser.
Mais, en définitive, que vaut l’hypothèse ? Elle se heurte à bien des objections. N’insistons pas sur le fait que, parmi les innombrables références que renferment les Pensées et les autres écrits de Pascal, il en est fort peu d’inexactes. De plus, si faute il y a, elle est généralement corrigée par Port-Royal [Ainsi, dans le fragment Laf. 487 ; Sell. 734 ; on peut lire « Ps. 110 » (conforme au manuscrit original, p. 22, et aux Copies, p. 285 et 400), pour « 109 » (qui est l’exacte numérotation ancienne) dans Port-Royal, XV, 9], plutôt qu’on ne trouve l’inverse. On contestera surtout que la référence modifiée fournisse un contexte satisfaisant pour notre fragment. Le Seigneur glorieux et juge auquel nous sommes alors renvoyés n’est nullement le Messie, expressément nommé dans la « nouvelle pensée », mais Dieu lui-même - Yahwé dans les Bibles d’aujourd’hui - seul susceptible d’offrir l’image apocalyptique qu’Isaïe en donne. On doit même aller beaucoup plus loin ; mais en faisant appel à ce que j’ai appelé le regard extérieur, c’est-à-dire en situant le fragment à élucider dans les Pensées, et notamment dans l’édition de Port-Royal.
Si Pascal cite souvent la Bible, il ne le fait pas au hasard de la mémoire ; il recueille toujours soigneusement, à l’avance, les citations dont il formera l’armature de son argumentation, en vue d’un développement plus ou moins étendu. De plus, il monte en épingle certaines de ces citations, les dispose aux charnières de son raisonnement et les fait revenir comme des refrains. Appliquons ces remarques aux versets apocalyptiques d’Isaïe. Ils n’apparaissent jamais dans les Pensées, quoique le chapitre 66 du prophète soit souvent allégué pour d’autres passages. En revanche, la citation dont la référence est donnée en marge de la « nouvelle pensée »est familière à Pascal. On la trouve à deux reprises dans un long fragment indiscutablement authentique, précédé du titre Pour montrer que les vrais juifs et les vrais chrétiens n’ont qu’une même religion. La première fois, référence est seulement faite au chapitre 65 d’Isaïe, sans autre précision, mais avec traduction et contexte [Lafuma, 453 ; Sellier, 693]. Mais la seconde fois, la référence complète est donnée, accompagnée de la traduction du verset, et d’un autre verset apportant un détail complémentaire sur les temps messianiques : [Ibid., respectivement t. I, p. 277 ; et p. 498]
Que le nom des juifs serait réprouvé et un nouveau nom donné. (Is. 65.15.)
Que ce nouveau nom serait meilleur que celui de juifs et éternel. (Is. 56.5.)
Le fragment qui, vers la fin, comporte ces deux versets a été exploité par Port-Royal, dans ce chapitre XV qui s’achève par la « nouvelle pensée », sous le n°9. Mais beaucoup de coupures ont été pratiquées dans l’énumération qu’il comporte. On constate en particulier que les deux renvois au chapitre 65 d’Isaïe ont été supprimés. Or un rapprochement s’impose entre ce fragment énumératif et la « nouvelle pensée », où se retrouve le second renvoi, complété par la mention d’un verset supplémentaire : « Is. 65.15.16 », bien que rien n’y fasse écho dans cette pensée. Aucune nouveauté importante n’est à tirer de l’addition d’un verset, lequel ne fait que reprendre l’idée du précédent, celle de l’avènement d’un nouveau peuple de Dieu. De plus grande portée est une remarque qui vient alors nécessairement à l’esprit : n’avons-nous pas constaté plusieurs fois, dans l’édition de Port-Royal, et dans des passages qui sont indiscutablement des gloses, la reprise intentionnelle de petits détails qui semblent avoir été découpés dans des textes authentiques et comme mis en réserve ? La situation serait curieusement semblable si la « nouvelle pensée » devait être considérée comme une glose.
Reste que la difficulté soulevée par la non-correspondance entre la référence donnée et le fragment qui lui fait face n’a pas trouvé sa solution. Faut-il tout à fait renoncer à établir quelque lien entre deux fils conducteurs essentiels de l’interprétation pascalienne de la Bible : l’idée que les vrais juifs et les vrais chrétiens n’ont qu’une même religion, et celle des deux images contradictoires et complémentaires du Messie, l’une d’humilité, l’autre de gloire ? La constatation qui, de toute manière, ne saurait échapper, à considérer la réflexion de Pascal sur les prophéties, dans l’Original des Pensées comme dans l’édition de Port-Royal, est que ces deux fils s’entrecroisent étroitement. Considérons les deux séries de prophéties dont se composent deux fragments du chapitre XV de Port-Royal, sous les nOS 6 et 9, en les éclairant toutefois par le recours aux originaux [Pour le n°9, voir les deux notes précédentes ; pour le n°6, Lafuma 487 (en deux fragments) ; Sellier 734]. Les termes de ces énumérations se répartissent assez aisément entre les deux catégories. Une sorte de torsade peut se constituer par le jeu des alternances. Mais l’unité de l’ensemble subsiste : chacun des deux fils consolide l’autre.
Pour nous concentrer sur la question qui nous occupe présentement au sujet de la « nouvelle pensée », celle du rapport entre la référence proposée et le texte dont on ne sait encore s’il lui sert de commentaire, examinons la manière dont la même référence est traitée, sinon au chapitre XV, 9, de l’édition de Port-Royal, où elle manque, du moins dans l’original de ce fragment, qui la comporte. Il va de soi que la référence concerne le passage du peuple juif au peuple chrétien, tandis que le texte distingue les deux visages du Messie, correspondant à ses deux fonctions, ou ses deux « offices » [Lafuma 608 ; Sellier 504] : rédempteur et juge. Or, dans l’original de XV, 9, les deux volets coexistent aussi. L’idée de la nouvelle alliance est exprimée par la référence, et par la citation qui lui est adjointe, ainsi que par d’autres données prophétiques. L’idée des deux visages du Messie, et notamment de son visage glorieux, qui est alors mis en valeur, l’est en particulier par deux allusions au célèbre psaume Dixit Dominus, psaume messianique par excellence, et célébration du Messie glorieux. Ce qui n’était qu’allusion dans le manuscrit original est d’ailleurs développé sous forme de citations effectives dans l’édition de Port-Royal :
Ps. 109.1. Qu’il monterait au ciel, pour s’asseoir à la droite de Dieu.
[...]
Ps. 109.1. Qu’étant à la droite de Dieu, il sera victorieux de ses ennemis.
Cette conjonction des deux visages s’explique par le fait que la grandeur du Messie est intimement unie à sa fonction rédemptrice, où il apparaît à la fois « souffrant » et « maître des Gentils », c’est-à-dire mourant sur la croix, mais opérant victorieusement le passage du peuple juif au peuple chrétien. La « nouvelle pensée » ne fait que développer un point de vue très proche, mais selon une rédaction entièrement différente.
On découvre ainsi, des fragments originaux à l’édition de Port-Royal, tout un travail de réflexion et d’agencement dont le sens n’est perceptible qu’à condition de dominer des ensembles assez vastes. Faut-il l’attribuer à Pascal ou à ses éditeurs ? La première hypothèse n’est certes pas indéfendable. Mais on peut estimer que l’auteur premier aurait traité plus librement ses essais successifs. La part d’artifice qu’il a été possible de déceler fait soupçonner la main des éditeurs.
Toutefois, au-delà des grandes règles d’exégèse mises en œuvre, la « nouvelle pensée » vise un objet beaucoup plus précis. Cet objet est directement indiqué dans le fragment, indiscutablement authentique, qui la précède (n°16). Pourquoi distinguer deux visages du Messie dans les prophéties qui le concernent ? Parce que leur valeur probante en dépend, surtout si l’on se met à la place des juifs. Le visage pauvre et souffrant appelait de leur part une réaction de rejet, qui leur a interdit de les comprendre. Mais les prophéties de cette nature sont sauvées, objectivement, par leur association avec d’autres, littéralement exactes, concernant le temps de la venue du Messie. Le second visage est en harmonie avec la grandeur de Dieu, et se laisse donc volontiers accepter sans l'appui d'une datation précise qui fait alors défaut. Une datation qui serait d’ailleurs déplacée, car le propre du divin est de déborder le temps. À quoi se superpose évidemment l'idée des « deux avènements » du Messie, l'un, dans la pauvreté, au moment de la Rédemption et de la Croix ; l'autre, triomphant, impliqué dans le premier, notamment par la fondation de la nouvelle alliance, et par tout ce que sa grandeur comporte de spirituel, mais totalement réalisé lors de la fin du monde et du Jugement dernier.
Qu’apporte alors la « nouvelle pensée » ? Elle est étroitement soudée à la précédente, dont elle implique les conclusions. Sa valeur est d’explicitation : elle affirme que représenter le Messie glorieux, c'est faire considérer en lui la fonction de juge, et non celle de rédempteur. Ce qui s’applique à celui qui a renversé l’idolâtrie et qui est à la fois Roi des Juifs et des Gentils. On peut estimer que cette conclusion se déduisait directement des raisonnements antérieurs, dont elle est la simple réciproque : elle ne constituerait alors qu'une glose, avec sa fonction caractéristique d’explicitation. Elle aurait été introduite par l'un des éditeurs de Port-Royal, et serait inauthentique.
Si importantes que puissent paraître les raisons présentées ici de mettre en doute le caractère original de la « nouvelle pensée » de Pascal si brillamment découverte et commentée à Clermont-Ferrand et à Lyon, je ne saurais prétendre qu’aucune certitude soit acquise, ni dans un sens ni dans l’autre. Je ne me risquerai même pas à calculer des probabilités, me bornant à me réjouir, faute de mieux, devant la perspective de voir le débat se prolonger. Ce qui est sûr, c’est que, si ce résultat peut décevoir, il se situe au terme d’une enquête éminemment positive, et dépassant de beaucoup le cas particulier envisagé. Elle a d’abord considérablement enrichi notre connaissance de l’édition de Port-Royal. Elle a permis d’analyser et de juger, avec une précision toute nouvelle, la manière très soigneuse, voire méticuleuse, avec laquelle ses auteurs ont travaillé le texte de Pascal, rendant accessible, avec leurs œillères parfois, mais souvent aussi en interprètes bien informés et avisés, une pensée demeurée à l’état naissant et requérant un discret commentaire, sensibles aussi à la qualité d’un langage dont ils ont voulu préserver la saveur et les effets, même s’ils en modifiaient la disposition. Il leur arrive ainsi de fournir une aide irremplaçable au lecteur d’aujourd’hui. Paradoxalement, même en cas de glose, ils peuvent rester d’excellents intermédiaires avec Pascal. N’est-ce pas ce qui rend si difficile la solution des problèmes d’authenticité qui se sont présentés à nous ? Comme il nous est apparu au passage, il semble toutefois que les éditeurs de 1678 aient été moins bien inspirés que ceux de 1670. Mais, bien entendu, c’est par sa confrontation avec le texte de l’Original que celui de l’édition permet ce regard explicatif ; c’est donc le texte original qu’une enquête telle que nous l’avons entreprise aboutit à mieux faire saisir : l’abrègement ici, l’amplification ou l’explicitation ailleurs font de l’édition une excellente voie d’accès au texte authentique, même s’il faut d’abord passer par la déformation.
Pour finir par un dernier mot sur la « nouvelle pensée », et pour reprendre le passage le plus important du commentaire qui précède, la clef de son interprétation sera fournie par le rapport qu’elle peut entretenir avec le groupe de citations prophétiques comportant la même référence à Isaïe que l’on trouve dans le grand fragment XV, 9, de Port-Royal, confronté avec son original. Ou bien les éditeurs ont trouvé les deux textes dans les papiers de Pascal, qu’il faut alors considérer comme l’auteur de l’un et de l’autre. Ou bien ils n’auront disposé que de l’original de XV, 9, éventuellement suppléé par sa copie, et alors ils pouvaient fabriquer le fragment XV, 17. On ajoutera, sans vouloir peser dans quelque sens que ce soit, que cette pensée suspecte n'est pas parfaitement équilibrée, qu'elle ne s'insère pas très clairement dans la suite de l’œuvre qui la contiendrait, et qu’elle ne saurait, selon les choix, ni apporter ni retirer grand-chose à Pascal.
Jean MESNARD »
♦ Visible
Pascal emploie fréquemment la formule il est visible que …, dans des domaines divers.
Sont visibles l’incohérence des actions des hommes, tels que les observent les moralistes, selon le fragment Vanité 4 (Laf. 16, Sel. 50). Vanité. Qu’une chose aussi visible qu’est la vanité du monde soit si peu connue, que ce soit une chose étrange et surprenante de dire que c’est une sottise de chercher les grandeurs. Cela est admirable.
Le fragment Raisons des effets 4 (Laf. 85, Sel. 119) applique l’adjectif visible à l’évidence des faits sociaux élémentaires : La pluralité est la meilleure voie parce qu’elle est visible et qu’elle a la force pour se faire obéir.
Il en va de même pour les évidences d’ordre psychologique et moral :
Grandeur 13 (Laf. 117, Sel. 149). La grandeur de l’homme est si visible qu’elle se tire même de sa misère, car ce qui est nature aux animaux nous l’appelons misère en l’homme par où nous reconnaissons que sa nature étant aujourd’hui pareille à celle des animaux il est déchu d’une meilleure nature qui lui était propre autrefois.
A P. R. 1 (Laf. 149, Sel. 182). Les grandeurs et les misères de l’homme sont tellement visibles qu’il faut nécessairement que la véritable religion nous enseigne et qu’il y a quelque grand principe de grandeur en l’homme et qu’il y a un grand principe de misère.
Ignorance et vanité sont aussi de ces choses immédiatement perceptibles :
Dossier de travail (Laf. 400, Sel. 19). L’homme ne sait à quel rang se mettre, il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables.
Preuves par discours II (Laf. 428, Sel. 682). De tous leurs égarements, c’est sans doute celui qui les convainc le plus de folie et d’aveuglement, et dans lequel il est le plus facile de les confondre par les premières vues du sens commun et par les sentiments de la nature. Car il est indubitable que le temps de cette vie n’est qu’un instant, que l’état de la mort est éternel, de quelque nature qu’il puisse être, et qu’ainsi toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon l’état de cette éternité, qu’il est impossible de faire une démarche avec sens et jugement qu’en la réglant par la vue de ce point qui doit être notre dernier objet. Il n’y a rien de plus visible que cela et qu’ainsi, selon les principes de la raison, la conduite des hommes est tout à fait déraisonnable, s’ils ne prennent une autre voie.
Peuvent aussi être considérés comme visibles certains traits collectifs des peuples et leur sens dans l’Histoire : Loi figurative 2 (Laf. 246, Sel. 278). Figur. Les peuples juifs et égyptiens visiblement prédits par ces deux particuliers, que Moïse rencontra : l’Égyptien battant le juif, Moïse le vengeant et tuant l’Égyptien et le juif en étant ingrat.
Prophétie VII (Laf. 495, Sel. 736). C’est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Is. 43. 9. 44. 8. Il porte les livres et les aime et ne les entend point. Et tout cela est prédit ; que les jugements de Dieu leur sont confiés, mais comme un livre scellé.
Dans les sciences, le mot visible apparaît lorsqu’il est question de vérités théoriques, de principes immédiatement reçus (à tort ou à raison).
Dans la polémique, Pascal emploie l’adjectif visible lorsqu’il révèle les intentions de ses adversaires : voir par exemple la Provinciale XI : « L'innocence de ce Père étant la seule chose commune à vos deux réponses, il est visible que c'est aussi la seule chose que vous y recherchez, et que vous n'avez pour objet que la défense de vos Pères, en disant d'une même maxime qu'elle est dans vos livres et qu'elle n'y est pas ; qu'elle est bonne et qu'elle est mauvaise, non pas selon la vérité, qui ne change jamais, mais selon votre intérêt, qui change à toute heure. »
Le même terme apparaît dans les sciences, notamment dans la physique, lorsqu’il décrit et explique une expérience : voir L’équilibre des liqueurs, II, OC II, éd. J. Mesnard, p. 1047.
L’usage du vocabulaire de la vue s’applique donc à des objets très variés.

