La liasse FAUSSETÉ DES AUTRES RELIGIONS (suite)
Fausseté et l’édition de Port-Royal
Le chapitre XVII, intitulé Contre Mahomet, n’intègre que quatre fragments de la liasse Fausseté. Sa structure est plus complexe : les textes sont issus respectivement de Fondement 20 (Laf. 243, Sel. 276), Fausseté 1, Loi figurative 31 (Laf. 276, Sel. 307), Fausseté 15 et 16, Fausseté 5, Preuves de Jésus-Christ 23 (Laf. 321, Sel. 352) et Fausseté 7.
Port-Royal a retenu plusieurs autres textes de la liasse :
Fausseté 3 et 6 ont été intégrés dans le chapitre III, Véritable religion prouvée par les contrariétés.
Fausseté 12, 13, 17 et 18 sont les sources du début du chapitre II, Marques de la véritable religion.
Fausseté 15 est venu compléter le chapitre XII, Figures.
Le texte de Fausseté 10 a été ajouté dans le chapitre XIV, Jésus-Christ, dans l’édition de 1678.
Les fragments Fausseté 2, Fausseté 4, Fausseté 8, Fausseté 9, Fausseté 11 et Fausseté 14 n’ont pas été retenus par le Comité. Les fragments 8 et 9 ont ensuite été recopiés par Louis Périer dont une copie a été conservée, puis publiés en 1728 par P. N. Desmolets. Les autres fragments n’ont pas retenu son attention. Il faut attendre l’édition Faugère (1844) pour qu’ils soient publiés. Seul le fragment Fausseté 11 a été publié un peu avant par A. Renouard en 1812.
Aspects stratigraphiques des fragments de Fausseté
Cinq papiers portent un filigrane complet ou des traces de filigrane :
RO 457-1 (Fausseté 3) : filigrane Écusson fleurette RC/DV,
RO 467-1 (Fausseté 4) : traces d’un filigrane Armes de France et Navarre / P ♥ H (type Cadran & Armes de France et Navarre / P ♥ H),
RO 373 (Fausseté 6) : filigrane Raisin (type Raisin & Raisin),
RO 467-8 + 457-3 (Fausseté 7) : traces d’un filigrane Marque royale (type Marque royale & PF / B ♦ R),
RO 465-4 (Fausseté 18) : filigrane Écusson fleurette RC/DV.
Les autres papiers ne portent pas de filigrane.
La reconstitution de Pol Ernst (Album, p. 31) montre que cinq papiers de la liasse sont issus d’un même feuillet de la variété au petit Jésus et utilisé parallèlement aux pontuseaux. Cette reconstitution est d’autant plus intéressante qu’elle propose deux ensembles : un demi-feuillet sur lequel ont été écrits des textes dont le thème est la nature est corrompue et composé des papiers RO 467-3 (Fausseté 10), RO 467-2 (Fausseté 11), RO 455-1 (Fausseté 12), RO 465-2 (Fausseté 13) ; et un quart de feuillet sur lequel a été écrit un texte contre l’islam et qui correspond au papier RO 457-2 (Fausseté 5).
D’autres reconstitutions partielles permettent de préciser l’origine de certains fragments :
Album, p. 153 : le papier RO 467-1 (Fausseté 4) est probablement issu d’un feuillet de type Armes de France et Navarre / P ♥ H et composé des fragments RO 123-2 (Laf. 570-571, Sel. 474), RO 467-1, RO 49-8 (Preuves de J.-C. 18 - Laf. 316, Sel. 347), RO 137-2 (Laf. 566, Sel. 472) et RO 411-3 (Contre la fable d’Esdras - Laf. 968, Sel. 416).
Album, p. 191 : les papiers RO 467-8 et 457-3 (Fausseté 7) sont probablement issus d’un feuillet de type Marque royale dont la partie supérieure est composée des fragments RO 467-8, RO 457-3, RO 55-2 (Preuves de J.-C. 3, Laf. 300, Sel. 331), RO 23-2 (Vanité 26, Laf. 39, Sel. 73). L’étude que nous proposons dans la description des papiers RO 467-8 et 457-3 nous amène à conclure que ces deux papiers ont été découpés post mortem. Nous considérons donc qu’ils ne formaient qu’un seul et unique fragment.
Album, p. 166 : les papiers RO 467-5 (Fausseté 8) et RO 167-5 (Morale chrétienne 20 - Laf. 371, Sel. 403) sont issus d’un même feuillet qui pourrait être de type Armes de France et Navarre / P ♥ H. Selon P. Ernst, le papier RO 467-5 porterait une minuscule trace du filigrane, ce que nous n’avons pas pu confirmer après l’avoir examiné à l’aide d’une tablette éclairante.
Album, p. 164 (corrigé par G. Proust) : le papier RO 459-1 (Fausseté 15) est issu d’un feuillet de type Cadran d’horloge (& Armes de France et Navarre / P ♥ H), composé en partie des fragments RO 459-1, RO 17-1 (Loi figurative 12 - Laf. 256, Sel. 288), RO 19-4 (Figures particulières 2 - Laf. 350, Sel. 382) et RO 31-2 (Loi figurative 31 - Laf. 276, Sel. 307).
Selon Pol Ernst, Les Pensées de Pascal, Géologie et stratigraphie, p. 303-305, les papiers RO 465-1 (Fausseté 14) et RO 451-2 (Fausseté 17) pourraient être issus de feuillets de type Écusson fleurette RC/DV, et le papier RO 465-6 (Fausseté 16) serait issu d’un feuillet de type Cadran d’horloge & Armes de France et Navarre / P ♥ H.
Les papiers de Fausseté 1 (RO 467-7), Fausseté 2 (RO 467-4) et Fausseté 9 (RO 467-7) ne sont pas identifiés.
Bibliographie ✍
BOUCHER Jean, Les triomphes de la religion chrétienne, contenant les résolutions de trois cent soixante et dix questions sur le sujet de la foi, de l’Écriture sainte, de la création du monde, de la rédemption du genre humain, de la divine providence, et de l’immortalité de l’âme, proposées par Typhon, maître des impies et libertins de ce temps et répondues par Dulithée, Paris, 1628.
BOUYER L., Dictionnaire théologique, Tournai, Desclée, 1963, p. 445.
CELSE, Contre les chrétiens, éd. L. Rougier, Paris, Pauvert, 1965.
CHÉDOZEAU Bernard, La Bible et la liturgie en français, Paris, Cerf, 1990.
COUSIN Victor, Rapport à l’Académie, in Œuvres de M. Victor Cousin, Quatrième série, Littérature, tome I, Paris, Pagnerre, 1849, p. 224 sq.
COUTON Georges, “Libertinage et apologétique : les Pensées de Pascal contre la thèse des Trois Imposteurs”, XVIIe siècle, n° 127, avril-juin 1980, p. 181-196.
DUBARLE A., “Pascal et l’interprétation des Écritures”, Les sciences philosophiques et théologiques, vol. II, 1941-1942, p. 346-379.
ERNST Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970.
FORCE Pierre, Le problème herméneutique chez Pascal, Paris, Vrin, 1989.
GROTIUS Hugo, De veritate religionis christianae, 2e éd., Lugduni Batavorum, A. Westeinius, 1629.
GOUHIER Henri, Blaise Pascal. Conversion et apologétique, Paris, Vrin, 1986.
HASEKURA Takaharu, “Commentaire des Pensées de Pascal (6), L. 207”, The proceedings of the department of foreign languages and literatures, College of arts and sciences, University of Tokyo, vol. XLI, n° 2, 1993, p. 1-24.
HASEKURA Takaharu, “Commentaire des Pensées de Pascal (3), L. 208 (1)”, The proceedings of the department of foreign languages and literatures, College of arts and sciences, University of Tokyo, vol. XXXVIII, n° 2, 1990, p. 77-133.
HASEKURA Takaharu, “Commentaire des Pensées de Pascal (4), L. 208 (2)”, The proceedings of the department of foreign languages and literatures, College of arts and sciences, University of Tokyo, vol. XXXIX, n° 2, 1991, p. 85-133.
HASEKURA Takaharu, “Commentaire des Pensées de Pascal (7), L. 209 (1)”, The proceedings of the department of foreign languages and literatures, College of arts and sciences, University of Tokyo, vol. XLII, n° 2, 1994, p. 1-18.
HASEKURA Takaharu, “Commentaire des Pensées de Pascal (8), L. 209 (2)”, The proceedings of the department of foreign languages and literatures, College of arts and sciences, University of Tokyo, vol. XLIII, n° 2, 1995, p. 1-10.
HOSSAIN Mary, “A false antithesis in Pascal’s Pensées ?”, French studies Bulletin, n° 8, Autumn 1 (8).
ICARD Simon, Port-Royal et saint Bernard de Clairvaux (1608-1709), Saint-Cyran, Jansénius, Arnauld, Pascal, Nicole, Angélique de Saint-Jean, Paris, Champion, 2010.
JANSÉNIUS, Cornelii Jansenii Leerdamensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus, sive commentarius in Sancta Jesu Christi Evangelia , Paris, 1643.
La Genèse, tr. Sacy, Bruxelles, Frixc, 1700.
LHERMET J. Pascal et la Bible, Paris, Vrin, 1931.
MAHOMET, L’Alcoran de Mahomet translaté d’arabe en François, par Du Ryer, Paris, Sommaville, 1647 (nombreuses éditions).
MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993.
MESNARD Jean, “La théorie des figuratifs dans les Pensées de Pascal”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 426-453.
Méthodes chez Pascal, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, p. 170.
MOUSNIER Roland, Les XVIe et XVIIe siècles, Paris, Presses Universitaires de France, p. 485 sq.
PÉROUSE Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), Paris, Champion, 2009.
PUECH Henri-Charles (dir.), Histoire des religions, 2, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1972.
SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010.
SELLIER Philippe, “Après qu’Abraham parut : Pascal et le prophétisme”, in Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 461-470.
SELLIER Philippe, “Pascal : les conclusions du projet d’apologie”, in Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010, p. 171-182.
SELLIER Philippe, Pascal et saint Augustin, Paris, Colin, 1970.
SUSINI Laurent, L’écriture de Pascal. La lumière et le feu. La « vraie éloquence » à l’œuvre dans les Pensées, Paris, Champion, 2008.
TAVARD Georges, La Tradition au XVIIe siècle en France et en Angleterre, Paris, Cerf, 1969.
THIROUIN Laurent, “Le moi haïssable, une formule équivoque”, in BEHRENS Rudolf, GIPPER Andreas, MELLINGHOFF-BOURGERIE Viviane (dir.), Croisements d’anthropologies. Pascals Pensées im Geflecht der Anthropologien, Universitätvelag, Heidelberg, 2005, p. 217-247.
THOMAS D’AQUIN, Somme contre les gentils, I, chapitre 6, éd. Michon, Garnier Flammarion, p. 153.
TILLEMONT Sébastien Le Nain de, Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles, Paris, C. Robustel, 1701-1712, 16 vol.
Traité des trois imposteurs, éd. Retat, ch. III, § XXII, Publications de l’Université de Saint-Étienne, p. 73 sq.
♦ Structure de la liasse Fausseté
Ernst Pol, Approches pascaliennes, Gembloux, Duculot, 1970, p. 303. ✍
Sellier Philippe, “Pascal : les conclusions du projet d’apologie”, in Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., 2010, p. 176, observe que, dans cette liasse, sur 18 fragments, 7 seulement traitent de la Fausseté des autres religions, tandis que les 11 autres tournent autour de la corruption de la nature.
Après avoir consacré plusieurs liasses aux fausses solutions en matière religieuse, Commencement contre l’athéisme, Soumission contre la superstition et l’excès de religiosité, et Excellence contre le déisme qui prétend atteindre Dieu sans médiateur, Pascal a effectué une translatio quaestionis avec la liasse Transition, qui introduit à la recherche du vrai Dieu, tel qu’il se présente dans les religions révélées. Il doit alors prendre en compte les religions qui sont directement concurrentes du christianisme, en commençant par celle de Mahomet. La liasse Fausseté des autres religions : contre les caricatures de la foi en Dieu que donne l’islam, religion tyrannique et violente, sur laquelle il s’est documenté dans le De veritate religionis christianae de Hugo Grotius. La preuve de la supériorité du christianisme revêt alors deux formes :
1. d’une part Pascal montre par la comparaison de la religion chrétienne à l’islam que ce dernier ne satisfait en rien les conditions auxquelles doit répondre la véritable religion. Ce thème était esquissé dès le fragment A P. R. 1 (Laf. 149, Sel. 182) : Sera-ce les philosophes qui nous proposent pour tout bien les biens qui sont en nous ? Ont-ils trouvé le remède à nos maux ? est-ce avoir guéri la présomption de l’homme que de l’avoir mis à l’égal de Dieu ? Ceux qui nous ont égalés aux bêtes et les mahométans qui nous ont donné les plaisirs de la terre pour tout bien, même dans l’éternité, ont-ils apporté le remède à nos concupiscences ?
2. d’autre part, il souligne que la religion chrétienne est la seule qui, par le dogme du péché originel et de la corruption, a véritablement connu la nature de l’homme, ce qui la rend vénérable (Ordre 10 - Laf. 12, Sel. 46), alors que les autres ne le sont pas.
Cette liasse, qui montre l’imperfection des autres religions, conduit directement à la suivante, qui vise à rendre la religion chrétienne aimable, contrairement à celle de Mahomet, qui n’a pas d’autorité, qui n’est pas prédit, qui tue, qui défend de lire, dont le paradis est ridicule et le Coran obscur, le contraste rend la religion chrétienne aimable.
Cependant, la structure de cette liasse et son titre posent un problème difficile.
La nature est corrompue
Le titre La nature est corrompue ne figure pas sur le manuscrit original. Il n’est connu que par les copies.
Jean Mesnard, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 44 sq., remarque que dans la liasse Dossier de travail (liasse I de l’éd. Lafuma, liasse-table de l’éd. Sellier), l’avant-dernier fragment, Dossier de travail 34 (Laf. 416, Sel. 35), est précédé, dans les Copies (p. 197 v°), par le titre La nature est corrompue qui est, selon lui, celui d’une liasse plutôt que celui du fragment.

En effet, le papier RO 485-9 sur lequel a été écrit ce texte ne porte pas de titre 1 :

et la table des matières présente deux titres au lieu d’un seul.
C1 : 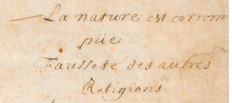 C2 :
C2 : 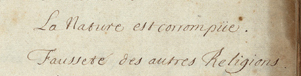
1 Selon L. Lafuma, le titre aurait été rogné lors du collage du papier dans le Recueil. Rien n’est moins sûr et aucune trace n’a subsisté dans la partie supérieure du papier. Il aurait été intéressant de connaître quel papier se situait au-dessus sur le feuillet originel, mais l’étude P. Ernst ne le dit pas. Selon J. Mesnard, le titre pouvait être écrit sur un petit papier qui aura disparu. Nous signalons enfin une découverte récente de G. Proust : le papier RO 491-7 du Dossier de travail 35 (Laf. 417, Sel. 36), dont le texte a été écrit par le secrétaire assidu de Pascal, porte au verso l’inscription non autographe : 20. ignorance de l’homme.
Sellier Philippe, “Pascal : les conclusions du projet d’apologie”, in Port-Royal et la littérature, Pascal, 2e éd., 2010, p. 176, observe que, dans cette liasse, 11 fragments tournent autour de la corruption de la nature. 2 L’examen des fausses religions devait constituer la seconde étape de l’enquête sur les contradictions de l’homme, après l’errance parmi les philosophies.
2 Soit Fausseté 3, 4, 6, 8 à 14 et 18.
Cette bipolarisation peut être illustrée par la reconstitution partielle d’un feuillet par P. Ernst, Album p. 31, qui réunit cinq fragments de Fausseté, en présentant dans la colonne de gauche des fragments dont le thème est la nature est corrompue et à droite un fragment contre l’islam :
|
J. C. est un Dieu dont on s’approche sans orgueil et sous lequel on s’abaisse sans désespoir. ------- Dignior plagis quam osculis non timeo quia amo. -------
La vraie religion doit avoir pour marque d’obliger à aimer son Dieu. Cela est bien juste et cependant aucune ne l’a ordonné, la nôtre l’a fait. Elle doit encore avoir connu la concupiscence et l’impuissance, la nôtre l’a fait. Elle doit y avoir apporté les remèdes, l’un est la prière. Nulle religion n’a demandé à Dieu de l’aimer et de le suivre.
Après avoir entendu toute la nature de l’homme il
|
Contre Mahomet.
L’Alcoran n’est pas plus de Mahomet que l’Évangile de saint Matthieu. Car il est cité de plusieurs auteurs de siècle en siècle. Les ennemis même, Celse et Porphyre, ne l’ont jamais désavoué. L’Alcoran dit que saint Matthieu était homme de bien, donc il était faux prophète ou en appelant gens de bien des méchants, ou en ne demeurant pas d’accord de ce qu’ils ont dit de Jésus-Christ.
[La suite n’a pas été retrouvée, mais il ne serait pas surprenant que Fausseté 2 provienne de cette partie] |
Pérouse Marie, L’invention des Pensées de Pascal. Les éditions de Port-Royal (1670-1678), remarque aussi que le double titre indique deux sujets distincts.
Avec le dernier fragment de cette liasse, Dossier de travail 35 (Laf. 417, Sel. 36), J. Mesnard aborde le sujet de la liasse La nature est corrompue qui figure sur la table des matières, sans répondre à une liasse concrète. Il en conclut que les deux fragments, transcrits dans les Copies à la fin du Dossier de travail, formaient à l’origine une liasse autonome intitulée La nature est corrompue, de même type que les 27 autres, dont le titre figure sur la table des matières, mais qui semble ne pas exister. Ces deux fragments auraient été transférés dans le Dossier de travail parce qu’ils devaient être associés à d’autres textes, consacrés à la corruption de l’homme et à la rédemption, qui auraient été composés après la mise en ordre des « papiers classés ». Voir Méthodes chez Pascal, p. 170 : Pascal a travaillé sur ce thème, et il s’est trouvé avoir dépassé le contenu de cette liasse ; mais il ne l’a pas détruite pour autant. Au cours du développement de la rédaction, Pascal a mis de côté cette liasse et s’est servi des instruments matériels qui la constituaient, savoir le fil, pour rajouter d’autres fragments, qui constituent le Dossier de travail.
Philippe Sellier propose une explication un peu différente : Pascal a tout simplement réuni en un seul dossier deux dossiers dont les thèmes étaient différents, mais étroitement liés : l’un qui consiste à montrer que seule la religion chrétienne a vraiment connu la corruption de l’homme, l’autre que toute religion qui n’a pas connu cette vérité ne mérite pas d’examen sérieux (voir Pensées, éd. Ph. Sellier, Paris, Garnier, 2011, p. 158).
Les deux explications ne sont pas incompatibles : on observe que les deux fragments de la liasse Dossier de travail ont surtout trait à la personne de Jésus-Christ, et à ce qu’il révèle de la nature corrompue de l’homme. La présence de Jésus-Christ dans la liasse Fausseté des autres religions est en revanche moins marquante, en dehors des fragments Fausseté 7 (Laf. 209, Sel. 241-242), et Fausseté 10 (Laf. 212, Sel. 245), qui sont plutôt consacrés à la comparaison du Christ avec Mahomet, qu’au fait que sans Jésus-Christ l’homme ne connaît rien de sa propre nature.
Dans cette hypothèse, on peut envisager que Pascal a en effet unifié les deux liasses primitives La nature est corrompue et Fausseté des autres religions et mis à part dans le Dossier de travail deux fragments d’une liasse initialement consacrée à la nature corrompue. Cette dernière est principalement liée à la liasse A P. R., pour montrer que seule la religion chrétienne, à l’exclusion des autres, peut répondre au conditions posées dans A P. R., que doit remplir toute religion qui prétend apporter une vraie explication aux contrariétés de la nature humaine et rendre compte de leur origine et de leur fondement.
Cette opération a nécessairement été effectuée après le classement de 1658, et correspond à une des dernières phases du travail que Pascal n’a jamais achevé.
Fausseté des autres religions
Les arguments que Pascal oppose aux « autres religions » sont principalement concentrés contre l’islam. Il s’est essentiellement inspiré du De veritate religionis christianae de Grotius, qui lui fournit l’essentiel de sa documentation, mais il emprunte aussi sans doute à d’autres sources. Il se contente d’indiquer le principe de sa démonstration, de manière brève et parfois sommaire : voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, 1993, p. 238 sq. Mais l’idée d’ensemble en était suffisamment claire pour inspirer la Préface de la Genèse dans la traduction de Port-Royal, où Sacy fait explicitement allusion à Pascal dans sa conclusion de la comparaison du Christ et de Mahomet.
Il ne pousse en revanche pas très loin l’étude des « autres religions ». On ne trouve dans cette liasse aucun fragment relatif à la Chine. C’est que si Pascal disposait d’une bonne source d’information sur l’islam par le livre de Grotius, il n’avait qu’à peine entamé sa recherche sur les religions de l’extrême orient : les fragments relatifs à la Chine sont tous, semble-t-il, de rédaction très tardive : voir Laf. 822, Sel. 663, et Preuves par les Juifs VI (Laf. 481, Sel. 716). Il lui restait donc encore d’importants terrains à explorer.
Les religions d’Amérique sont encore plus absentes des Pensées : un seul fragment, sans doute inspiré de Montaigne, fait allusion à Mexico : Preuves par les Juifs VI (Laf. 481, Sel. 716).
L’intérêt de la liasse Fausseté est donc autant dans ce qu’elle nous apprend du travail de Pascal sur un lieu nodal de son argumentation que sur son contenu proprement dit.

