Dossier de travail - Fragment n° 26 / 35 – Papier original : RO 487-2
Copies manuscrites du XVIIe s. : C1 : n° 23 p. 197 / C2 : p. 8
Éditions savantes : Faugère II, 391 / Havet XXV.109 bis / Brunschvicg 74 / Tourneur p. 305-1 / Le Guern 387 / Lafuma 408 / Sellier 27
______________________________________________________________________________________
Bibliographie ✍
CARRAUD Vincent, Pascal. Des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, Paris, Vrin, 2007. CARRAUD Vincent, Pascal et la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 1992. CROQUETTE Bernard, Pascal et Montaigne. Étude des réminiscences des Essais dans l’œuvre de Pascal, Genève, Droz, 1974, p. 44. MAEDA Yoichi, Les arguments apologétiques chez Montaigne et chez Pascal, 2e éd., Tokyo-Sogenka, 1989 (en japonais). MESNARD Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., Paris, SEDES-CDU, Paris, 1993. MESNARD Jean, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ?”, in La culture du XVIIe siècle, Paris, P. U. F., 1992, p. 363-370. SELLIER Philippe, “Indications d’ordre et dossiers pascaliens”, Les Pensées de Pascal : interprètes et éditeurs en débat, Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 93, n° 1, janvier-mars 2009, Paris Vrin, 2009, p. 145-154. SELLIER Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., Paris, Champion, 2010. |
✧ Éclaircissements
Une lettre de la folie de la science humaine et de la philosophie.
Le mot philosophe est à prendre partout dans le même sens. Dans la liasse Philosophes, le mot est pris au sens particulier des philosophes stoïciens. On suppose aussi que « le plus grand philosophe du monde » que Pascal imagine placé au-dessus d’un précipice, est un stoïcien.
Dans le présent fragment, il s’agit de la philosophie considérée de manière plus générale. Faut-il l’opposer à la science, dont il est aussi question ? Il ne faut sans doute pas prendre le mot science au sens actuel, mais plutôt au sens de ce que nous entendrions en général par savoir. Dans ce passage, en fait, l’accent n’est ni sur philosophie, ni sur science, mais sur humaine. La philosophie est humaine par nature. Il fallait en revanche préciser humaine pour la science, car il existe une science divine.
Le manuscrit montre que le thème de la folie de la science et de la philosophie a été trouvé le premier. L’idée de composer une lettre vient en deuxième temps : la forme dans laquelle ce thème doit être formulé s’est imposée ensuite. L’expression De la folie semble indiquer que Pascal a d’abord pensé à recourir à la forme du traité ou de l’essai. Pascal a trouvé les citations qui suivent dans Montaigne, Essais, III, 10 et II, 12. On peut supposer qu’il a pensé à un pastiche de Montaigne.
Mais peut-être Pascal pense-t-il aussi à l’Éloge de la folie d’Érasme. Celui-ci ne se contente pas en effet de railler la folie ordinaire du peuple, il s’en prend aussi aux savants, grammairiens, poètes, rhéteurs, jurisconsultes, sophistes, qui tous autant qu’ils sont cherchent la gloire dans la publication de leurs livres. Les philosophes « qui se proclament les seuls sages », qui « prétendent tout savoir », mais « ne savent rien du tout » (§ LII), viennent à la fin avec les théologiens.
Cette lettre avant le divertissement.
Cette lettre avant le divertissement : troisième préoccupation de Pascal, la place de l’idée dans l’ordre relatif. Il ne s’agit pas de la place du thème dans l’ensemble de l’ouvrage, mais de la situation relative de certains arguments particuliers. L’ordre est d’abord envisagé de manière régionale, et non pas globale.
Sellier Philippe, “Indications d’ordre et dossiers pascaliens”, Les Pensées de Pascal : interprètes et éditeurs en débat, Revue des sciences philosophiques et théologiques, tome 93, n° 1, janvier-mars 2009, Paris Vrin, 2009, p. 145-154. Sur les indications d’ordre dans les Pensées. ✍
Mesnard Jean, “Pourquoi les Pensées de Pascal se présentent-elles sous forme de fragments ?”, in La culture du XVIIe siècle, p. 363-370. ✍
Sur le mode de composition de Pascal « par noyaux assemblés », voir Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, p. 403 sq. ✍
Sellier Philippe, Port-Royal et la littérature, I, Pascal, 2e éd., p. 173, remarque qu’en fait, l’ordre de classement des liasses est inverse : Philosophes vient après Divertissement. Il faut ajouter qu’a fortiori, il est surprenant que Souverain bien aussi, qui traite bien du problème dont il est question ici, vienne après Divertissement. Pascal n’était donc pas encore entièrement fixé sur le plan de son ouvrage.
Felix qui potuit...
Felix qui potuit : « Heureux qui peut (pénétrer les causes des choses) » : Virgile, Géorgiques, II, 90.
« Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque metus omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari.
Fortunatus et ille, Deos qui novit agrestes,
Panaque, Sylvanumque senem, Nymphasque sorores »
Ces vers sont cités dans Montaigne, Essais, III, X, De ménager sa volonté, in Essais, éd. Balsamo, Pléiade, p. 1066. Mais le contexte ne correspond pas exactement.
Il s’agit d’une référence à Épicure.
Mesnard Jean, Les Pensées de Pascal, 2e éd., p. 228, renvoie aux Textes barrés situés sur les mêmes papiers que Misère n° 9 (Laf. 76, Sel. 111). Mais peut-être que ce sujet passe la portée de la raison. Examinons donc ses inventions sur les choses de sa force. S’il y a quelque chose où son intérêt propre ait dû la faire appliquer de son plus sérieux, c’est à la recherche de son souverain bien. Voyons donc où ces âmes fortes et clairvoyantes l’ont placé et si elles en sont d’accord.
L’un dit que le souverain bien est en la vertu, l’autre le met en la volupté, l’autre à suivre la nature, l’autre en la vérité, Felix qui potuit rerum cognoscere causas, l’autre à l’ignorance tranquille, l’autre en l’indolence, d’autres à résister aux apparences, l’autre à n’admirer rien, Nihil mirari prope res una quae possit facere et servare beatum, et les braves pyrrhoniens en leur ataraxie, doute et suspension perpétuelle, et d’autres plus sages, qu’on ne le peut trouver, non pas même par souhait. Nous voilà bien payés !
Si faut-il voir si cette belle philosophie n’a rien acquis de certain par un travail si long et si tendu. Peut-être qu’au moins l’âme se connaîtra soi-même. Écoutons les régents du monde sur ce sujet.
Voir Souverain bien 2 (Laf. 148, Sel. 181). Les uns le [sc. le souverain bien] cherchent dans l’autorité, les autres dans les curiosités et dans les sciences, les autres dans les voluptés.
Felix nihil admirari...
Felix nihil admirari : Horace, Épîtres, I, VI, 1. Voir ci-dessus, Laf. 76, Sel. 111, Nihil mirari...
Cette citation, comme l’allusion aux 280 souverains biens, vient de Montaigne, Essais, II, XII, éd. Balsamo et alii, p. 613.
« Il n’est point de combat si violent entre les philosophes, et si âpre, que celui qui se dresse sur la question du souverain bien de l’homme : duquel par le calcul de Varro, naquirent deux cent quatre vingt sectes. Qui autem de summo bono dissentit, de tota philosophiæ ratione disputat.
Tres mihi convivæ prope dissentire videntur,
Poscentes vario multum diversa palato :
Quid dem ? quid non dem ? renvis tu quod jubet alter,
Quod petis, id sanè est invisum acidumque duobus.
Nature devrait ainsi répondre à leurs contestations, et à leurs débats.
Les uns disent notre bien être loger en la vertu : d’autres en la volupté : d’autres au consentir à nature ; qui en la science ; qui à n’avoir point de douleur ; qui à ne se laisser emporter aux apparences ; et à cette fantaisie semble retirer cet autre, de l’ancien Pythagoras :
Nil admirari prope res est una, Numici,
Soláque quæ possit facere et servare beatum,
qui est la fin de la secte pyrrhonienne. Aristote attribue à magnanimité, rien n’admirer. »
Plutarque, Œuvres morales, 44 b, Comment il faut ouïr, XIII : « Pythagoras, qui disait que de l’étude de la philosophie, il lui était demeuré ce fruit qu’il n’avait rien en admiration. »
Voir Aristote, Éthique à Nicomaque, IV, III, 1125 a.
L’ataraxie des pyrrhoniens consiste à n’être troublé par rien.
Y a-t-il un rapport entre ces deux citations, en dehors du mot felix ? Felix qui potuit semble faire allusion au bonheur qui vient de la science des causes cachées. Felix nihil admirari renvoie à l’idée que le philosophe ne doit s’étonner de rien. Le point commun, c’est la notion d’étonnement devant les effets : en physique, on cherche les causes quand les effets sont étonnants ; Pascal pouvait penser à ses propres travaux sur le vide, la colonne de mercure et les effets de la pression atmosphérique. Au contraire, celui qui ne s’étonne pas accepte de vivre dans une sorte d’ignorance qui lui évite une recherche inquiète des causes. Les deux citations ne sont donc pas redondantes : elles définissent deux attitudes symétriques et contraires.
280 sortes de souverain bien dans Montaigne.
Preuves par les Juifs VI (Laf. 479, Sel. 714). Pour les philosophes, deux cent quatre-vingts souverains biens.
Le chiffre de 288 sectes est évoqué par Varron, De philosophia, I, § 2-9. Ce texte est perdu.
GEF XII, p. 95, indique que le texte de Varron est cité dans saint Augustin, La cité de Dieu, XIX, 1, Bibliothèque augustinienne, Desclée de Brouwer, 1960, 37, p. 40-46.
« De finibus enim bonorum et malorum multa et multipliciter inter se philosophi disputarunt ; quam quaestionem maxima intentione versantes invenire conati sunt, quid efficiat hominem beatum. Illud enim est finis boni nostri, propter quod appetenda sunt cetera, ipsum autem propter se ipsum ; et illud finis mali, propter quod vitanda sunt cetera, ipsum autem propter se ipsum. Finem boni ergo nunc dicimus, non quo consumatur, ut non sit, sed quo perficiatur, ut plenum sit ; et finem mali, non quo esse desinat, sed quo usque nocendo perducat. Fines itaque isti sunt summum bonum et summum malum. De quibus inveniendis atque in hac vita summo bono adipiscendo, vitando autem summo malo, multum, sicut dixi, laboraverunt, qui studium sapientiae in saeculi hujus vanitate professi sunt ; nec tamen eos, quamvis diversis errantes modis, naturae limes in tantum ab itinere veritatis deviare permisit, ut non alii in animo, alii in corpore, alii in utroque fines bonorum ponerent et malorum. Ex qua tripertita velut generalium distributione sectarum Marcus Varro in libro De philosophia tam multam dogmatum varietatem diligenter et subtiliter scrutatus advertit, ut ad ducentas octoginta et octo sectas, non quae jam essent, sed quae esse possent, adhibens quasdam differentias facillime perveniret.
Ex qua tripertita velut generalium distributione sectarum Marcus Varro in libro De philosophia tam multam dogmatum varietatem diligenter et subtiliter scrutatus advertit, ut ad ducentas octoginta et octo sectas, non quae jam essent, sed quae esse possent, adhibens quasdam differentias facillime perveniret.
Quod ut breviter ostendam, inde oportet incipiam, quod ipse advertit et posuit in libro memorato, quatuor esse quaedam, quae homines sine magistro, sine ullo doctrinae adminiculo, sine industria vel arte vivendi, quae virtus dicitur et procul dubio discitur, velut naturaliter appetunt, aut voluptatem, qua delectabiliter movetur corporis sensus, aut quietem, qua fit ut nullam molestiam corporis quisque patiatur, aut utramque, quam tamen uno nomine voluptatis Epicurus appellat, aut universaliter prima naturae, in quibus et haec sunt et alia, vel in corpore, ut membrorum integritas et salus atque incolumitas ejus, vel in animo, ut sunt ea, quae vel parva vel magna in hominum reperiuntur ingeniis. Haec igitur quatuor, id est voluptas, quies, utrumque, prima naturae, ita sunt in nobis, ut vel virtus, quam postea doctrina inserit, propter haec appetenda sit, aut ista propter virtutem, aut utraque propter se ipsa ; ac per hoc fiunt hinc duodecim sectae ; per hanc enim rationem singulae triplicantur ; quod cum in una demonstravero, difficile non erit id in ceteris invenire. Cum ergo voluptas corporis animi virtuti aut subditur aut praefertur aut jungitur, tripertita variatur diversitate sectarum. Subditur autem virtuti, quando in usum virtutis adsumitur. Pertinet quippe ad virtutis officium et vivere patriae et propter patriam filios procreare, quorum neutrum fieri potest sine corporis voluptate ; nam sine illa nec cibus potusque sumitur, ut vivatur, nec concumbitur, ut generatio propagetur. Cum vero praefertur virtuti, ipsa appetitur propter se ipsam, virtus autem adsumenda creditur propter illam, id est, ut nihil virtus agat nisi ad consequendam vel conservandam corporis voluptatem ; quae vita deformis est quidem, quippe ubi virtus servit dominae voluptati (quamvis nullo modo haec dicenda sit virtus) ; sed tamen etiam ista horribilis turpitudo habuit quosdam philosophos patronos et defensores suos. Virtuti porro voluptas jungitur, quando neutra earum propter alteram, sed propter se ipsas ambae appetuntur. Quapropter sicut voluptas vel subdita vel praelata vel juncta virtuti tres sectas facit, ita quies, ita utrumque, ita prima naturae alias ternas inveniuntur efficere. Pro varietate quippe humanarum opinionum virtuti aliquando subduntur, aliquando praeferuntur, aliquando junguntur, ac sic ad duodenarium sectarum numerum pervenitur. Sed iste quoque numerus duplicatur adhibita una differentia, socialis videlicet vitae, quoniam, quisquis sectatur aliquam istarum duodecim sectam, profecto aut propter se tantum id agit aut etiam propter socium, cui debet hoc velle quod sibi. Quocirca duodecim sunt eorum, qui propter se tantum unamquamque tenendam putant, et aliae duodecim eorum, qui non solum propter se sic vel sic philosophandum esse decernunt, sed etiam propter alios, quorum bonum appetunt sicut suum. Hae autem sectae viginti quatuor iterum geminantur addita differentia ex Academicis novis et fiunt quadraginta octo. Illarum quippe viginti quatuor unamquamque sectarum potest quisque sic tenere ac defendere ut certam, quem ad modum defenderunt Stoici quod hominis bonum, quo beatus esset, in animi tantummodo virtute consisteret ; potest alius ut incertam, sicut defenderunt Academici novi, quod eis etsi non certum, tamen veri simile videbatur. Viginti quatuor ergo fiunt per eos, qui eas velut certas propter veritatem, et aliae viginti quatuor per eos, qui easdem quamvis incertas propter veri similitudinem sequendas putant. Rursus, quia unamquamque istarum quadraginta octo sectarum potest quisque sequi habitu ceterorum philosophorum, itemque alius potest habitu Cynicorum, ex hac etiam differentia duplicantur et nonaginta sex fiunt. Deinde quia earum singulas quasque ita tueri homines possunt atque sectari, ut aut otiosam diligant vitam, sicut hi, qui tantummodo studiis doctrinae vacare voluerunt atque valuerunt, aut negotiosam, sicut hi, qui cum philosopharentur tamen administratione reipublicae regendisque rebus humanis occupatissimi fuerunt, aut ex utroque genere temperatam, sicut hi, qui partim erudito otio partim necessario negotio alternantia vitae suae tempora tribuerunt ; propter has differentias potest etiam triplicari numerus iste sectarum et ad ducentas octoginta octo perduci. »
Tr. : « Sur les fin des biens et des maux, les philosophes ont abondamment et diversement disputé, et ils ont examiné avec une attention extrême ce qui rend l’homme heureux. Car la fin suprême de notre bien, c’est l’objet pour lequel on doit rechercher toutes les autres choses, mais qui ne doit être recherché que pour lui-même ; et quant à notre mal, c’est ce pour quoi il faut éviter tout le reste, mais qui doit être évité pour lui-même. Ainsi, nous appelons la fin du bien, non une fin où il se consume jusqu’à ne plus exister, mais ce par quoi il s’accomplit pour atteindre sa plénitude ; et par la fin du mal, nous entendons non ce par quoi il cesse d’être, mais ce qui le porte à son extrémité. C’est pourquoi ces deux fins sont le souverain bien et le souverain mal. C’est pour les trouver, pour atteindre en cette vie le souverain bien, et éviter le souverain mal, que, comme je l’ai dit, se sont beaucoup tourmentés ceux qui, parmi les vanités du siècle, ont fait profession de rechercher la sagesse ; mais, quoiqu’ils aient erré de plusieurs façons, les bornes de la nature ne leur ont pas permis de s’écarter de la vérité au point de ne pas mettre le souverain bien et le souverain mal, les uns dans l’âme, les autres dans le corps, et les autres dans les deux. De cette tripartition générale des sectes, Varron, qui l’a examinée avec soin et finesse dans son livre De la Philosophie, a distingué une si grande variété de doctrines, qu’avec quelques distinctions, il parvient facilement jusqu’à deux cent quatre-vingt-huit sectes, sinon réelles, du moins possibles.
Pour le montrer brièvement, il faut commencer par ce qu’il a remarqué et proposé dans le livre en question, qu’il y a quatre choses que, sans besoin de maître ni d’enseignement, sans industrie ni art de vivre, qui est appelé vertu et peut sans aucun doute être enseignée, les hommes recherchent naturellement : la volupté par laquelle le sens corporel est mû agréablement, ou le repos par lequel l’on ne souffre aucune souffrance du corps, soit les deux à la fois, ce que Épicure appelle pourtant du seul nom de volupté, soit les principes de la nature, parmi lesquels se trouvent tout cela et d’autres choses encore, soit dans le corps comme l’intégrité des membres, la santé et la sécurité, soit pour l’esprit, les qualités petites ou grandes qu’on trouve dans le génie humain.
Or, ces quatre choses, volupté, repos, et les deux ensemble, et principes de la nature, sont en nous de telle sorte qu’il faut de trois choses l’une : ou que la vertu soit recherchée pour elle-même, que la doctrine inculque ensuite, ou qu’elles soient recherchées pour la vertu, ou les deux pour elles-mêmes ; et de là viennent douze sectes ; selon ce calcul en effet, chacune est triplée, comme je le démontrerai pour l’une d’elles, après quoi il ne sera pas difficile de la comprendre pour les autres. Que la volupté du corps soit soumise, préférée ou associée à la vertu, cela fait trois sectes différentes. Or elle est soumise à la vertu, quand elle est prise pour instrument de la vertu. Ainsi, il appartient au devoir de la vertu de vivre pour la patrie et de lui procréer des enfants, deux choses qui ne peuvent se faire sans volupté du corps : car sans cela on ne mange ni ne boit pour vivre, ni on ne couche pour développer la génération. Mais quand on préfère la volupté du corps à la vertu de l’âme, on recherche la volupté pour elle-même, et on estime que la vertu doit être cherchée pour elle, c’est-à-dire que la vertu ne fait rien si ce n’est pour poursuivre et conserver la volupté du corps : vie affreuse, où la vertu sert la volupté dominatrice (quoiqu’en aucune façon on ne puisse l’appeler vertu) ; pourtant cette horrible infamie a eu certains philosophes pour auteurs et défenseurs. Enfin, la volupté est associée à la vertu, quand on ne les recherche pas l’une pour l’autre, mais chacune pour elle-même.
C’est pourquoi, comme la volupté, soumise, préférée ou associée à la vertu, a fait trois sectes, ainsi le repos, la volupté avec le repos, et les principes de la nature, en produisent aussi un nombre égal. Selon la variété des opinions humaines, tantôt elles sont soumises, tantôt préférées ou tantôt associées à la vertu, et ainsi on arrive au nombre de douze sectes. Mais ce nombre aussi est doublé lorsqu’on y ajoute une différence, qui est la vie sociale, car quiconque embrasse quelqu’une de ces sectes, le fait ou seulement pour soi, ou pour un autre compagnon et à qui il doit souhaiter le même avantage. Il y aura donc douze sectes de philosophes qui ne professeront leur doctrine que pour eux-mêmes, et autrement douze de ceux qui pensent qu’ils doivent philosopher en un sens ou en l’autre pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres dont ils cherchent le bien comme le leur.
Or ces vingt-quatre sectes se doublent encore en ajoutant la distinction de la nouvelle Académie, et s’élèvent à quarante-huit. De ces vingt-quatre sectes, en effet, l’un peut soutenir l’une et la défendre comme certaine, comme les stoïciens ont soutenu que le bien de l’homme qui le rend heureux ne consiste que dans la vertu, et un autre la trouver incertaine, comme les nouveaux académiciens, parce qu’elle semble non pas certaine, mais vraisemblable. Vingt-quatre sectes de philosophes en viennent, qui défendent la vérité de leur opinion comme assurée, et vingt-quatre autres qui soutiennent que l’on doit suivre ces opinions, quoique incertaines, à cause de leur vraisemblance. De plus, comme chacun peut observer et suivre chacune de ces quarante-huit sectes ou en suivant le mode de vie des autres philosophes, ou en suivant celui des cyniques, cette différence les double encore et en fait quatre-vingt-seize. Enfin comme on peut observer chacune d’elles, ou en menant une vie tranquille, soit parce qu’on aime une vie de loisir comme ceux qui ont voulu et pu se consacrer exclusivement à l’étude de la philosophie, soit qu’on préfère une vie active comme ceux qui tout en philosophant ont été occupés par l’administration de l’État et le gouvernement des affaires humaines, soit qu’on combine les deux genres comme ceux qui alternent les moments de la vie entre le loisir savant et les affaires indispensables, il résulte de ces différences que ce nombre de sectes peut être triplé et s’élever à deux cent quatre-vingt-huit ».
Voir un résumé plus clair que l’original des divisions de Varron telles que saint Augustin les rappelle, dans la note de Vincent Carraud, Pascal. Des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 69-70 : « le quatuor des choses recherchées : plaisir, repos, les deux (soit la volupté selon Épicure), les biens de la nature (prima naturae) (4) se trouve multiplié par le rapport que ces choses entretiennent à la vertu : les rechercher pour la vertu ou pour elles, ou celle-là et celles-ci pour elles-mêmes (3) ; les douze sectes ainsi produites peuvent être alors considérées selon que l’on agit pour soi ou pour d’autres aussi (2) ; les vingt-quatre sectes se dédoublent de nouveau selon un critère épistémique emprunté aux nouveaux académiciens, celui de la certitude ou de l’incertitude de l’opinion suivie (2) ; le dédoublement suivant est dû à deux habitus possibles, celui des cyniques ou celui des autres philosophes (2) ; enfin chacune des quatre-vingt-seize sectes peut être adoptée par choix soit d’une vie de loisir, soit d’affaires, soit mixtes (3) ».
Sur les prima bona naturae dans le texte d’Augustin, voir la note de La cité de Dieu, XIX, 1, Bibliothèque augustinienne, Desclée de Brouwer, 1960, 37, p. 727.
Yoichi Maeda, Les arguments apologétiques chez Montaigne et chez Pascal, p. 284-285 (en japonais), puis Vincent Carraud, Pascal et la philosophie, p. 103-104, et Pascal. Des connaissances naturelles à l’étude de l’homme, p. 69-70, signalent que si Varron, au rapport de saint Augustin, La Cité de Dieu, XIX, 1, atteint par des divisions successives le nombre de 288 sectes philosophiques possibles, Pascal n’en mentionne que 280 (sans remarquer d’ailleurs qu’il s’agit de sectes possibles, et non pas nécessairement de sectes réelles).
Il faut revenir à l’indication que Pascal donne lui-même : ce n’est pas dans La cité de Dieu qu’il a trouvé le nombre de 280, mais dans Montaigne (voir Essais, II, 12, Apologie de Raymond Sebond, éd. Balsamo et alii, Pléiade, p. 613). Les Essais donnent le texte suivant : « Il n’est point de combat si violent entre les philosophes, et si âpre, que celui qui se dresse sur la question du souverain bien, duquel par le calcul de Varro, naquirent 288 sectes ». Mais l’édition de 1652 des Essais, p. 424, porte par erreur le nombre 280.
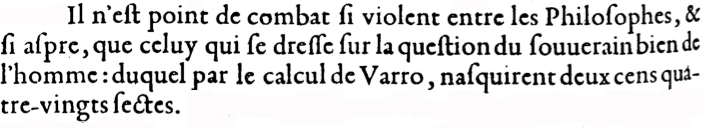
Ce n’est donc pas Pascal, mais Montaigne qui est, involontairement dans ce cas, responsable de la perte de 8 unités. Le texte de Montaigne ne comportait d’ailleurs pas de renvoi à saint Augustin.
La lecture du texte d’Augustin n’est cependant pas inutile. Pascal y aurait probablement constaté qu’il enfermait un véritable calcul, mais il y aurait à coup sûr vu l’une de ces divisions à la manière de Charron, dont il dit dans le fragment Laf. 780, Sel. 644 qu’elles ennuient, et surtout qu’elles peuvent se poursuivre à l’infini (Misère 14 - Laf. 65, Sel. 99). En d’autres termes, pour Pascal, il n’est pas vrai, comme il aurait pu le lire dans saint Augustin, que Varron fournissait la liste complète de toutes les sectes philosophiques possibles : rien n’empêchait de poursuivre indéfiniment à l’aide d’autres divisions. Ces listes débouchent du reste en général sur des effets de diversité dont Pascal souligne ironiquement la confusion :
Voir Souverain bien 2 (Laf. 148, Sel. 181) : Qu’est‑ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est‑à‑dire que par Dieu même. Lui seul est son véritable bien. Et depuis qu’il l’a quitté, c’est une chose étrange qu’il n’y a rien dans la nature qui n’ait été capable de lui en tenir la place : astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vices, adultère, inceste. Et depuis qu’il a perdu le vrai bien, tout également peut lui paraître tel, jusqu’à sa destruction propre, quoique si contraire à Dieu, à la raison et à la nature tout ensemble. Les uns le cherchent dans l’autorité, les autres dans les curiosités et dans les sciences, les autres dans les voluptés.
La prétention d’établir une liste complète n’aurait pu être satisfaite qu’au moyen d’un procédé combinatoire, capable d’épuiser effectivement toutes les possibilités. Pascal de son côté procède tout autrement dans les premières liasses de son projet, en distinguant deux catégories principales de philosophes, les partisans de la grandeur de l’homme (dont Épictète est un type) et les partisans de sa misère (représentés par Montaigne), qui comprennent la diversité des doctrines moins radicales : il peut ainsi raisonner universellement sur la diversité des philosophes, sans avoir à se perdre dans des computations interminables.

